27 septembre 2007
Une gourmandise
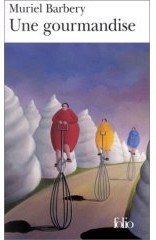 Un homme se tient par le ventre et le bas ventre. [Proverbe ivoirien]
Un homme se tient par le ventre et le bas ventre. [Proverbe ivoirien]
Si j’ai évoqué le pouvoir du plaisir dans une de mes anciennes notes et notamment le pouvoir du plaisir sexuel - le pouvoir du bas ventre - je ne me suis jamais étendu sur les plaisirs du ventre. Il faut dire que dans mes textes, il est plus question de chair que de bonne chair : lorsque j’ouvre la bouche pour savourer l’onctuosité de chairs humides, c’est rarement pour gober une huître ; lorsque la paume de ma main flatte une chaude rotondité, ce n’est pas souvent celle d’une miche de pain ; lorsque je plonge un appendice dans un calice parfumé, ce n’est généralement pas mon nez. Alors si je vous dis que j’ai découvert un roman dont la sensualité m’a mis l’eau à la bouche, dont les mots m’ont plongé dans une joie jubilatoire, sans doute penserez-vous que j’ai découvert une fine fleur de l’érotisme. Il n’en est rien. Une gourmandise de Muriel Barbery est à l’encyclopédie de cuisine ce que le cantique des cantiques est à la Bible : une subtile prose dont la poésie enchante l’âme jusqu’aux muqueuses.
Lire Une gourmandise, c’est goûter la saveur des mots : « Les mots : écrins qui recueillent une réalité esseulée et la métamorphosent en un moment d’anthologie, magiciens qui changent la face de la réalité en l’embellissant du droit de devenir mémorable, rangée dans la bibliothèque des souvenirs. Toute vie ne l’est que par l’osmose du mot et du fait où le premier enrobe le second de son habit de parade. »
Lire Une gourmandise, c’est déguster les mots de la saveur, ou plutôt les mots des saveurs, car les aliments les plus simples passés au crible de sa plume fantastique ne sont pas froidement disséqués, mais ils sont révélés toute leur puissance évocatrice.
Une pâtisserie marocaine après les boulettes de viande ? « Elles ne sont appréciables dans toute leur subtilité que lorsque nous ne les mangeons pas pour apaiser la faim et que cette orgie de douceur sucrée ne comble pas un besoin primaire mais nappe notre palais de la bienveillance du monde. »
Une tomate dans un verger ? « La tomate crue, dévorée dans le jardin sitôt récoltée, c’est la corne d’abondance des sensations simples, une cascade qui essaime dans la bouche et en réunit tous les plaisirs. La résistance de la peau tendue, juste un peu, juste assez, le fondant des tissus, de cette liqueur pépineuse qui s’écoule au coin des lèvres et qu’on essuie sans crainte d’en tacher ses doigts, cette petite boule charnue qui déverse en nous des torrents de nature : voilà la tomate, voilà l’aventure. »
Le poisson cru dans un restaurant japonais ? « Le vrai sashimi ne se croque pas plus qu’il ne fond sur la langue. Il invite à une mastication lente et souple, qui n’a pas pour fin de faire changer l’aliment de nature mais seulement d’en savourer l’aérienne moellesse. Oui, la moellesse : ni mollesse ni moelleux ; le sashimi, poussière de velours aux confins de la soie, emporte un peu des deux et, dans l’alchimie extraordinaire de son essence vaporeuse, conserve une identité laiteuse que les nuages n’ont pas. »
Lire Une gourmandise, c’est retrouver des accents de Delerm, mais les plaisirs de Barbery n’ont pas pour vocation de rester minuscules, ils gonflent, ils enflent, ils explosent de lyrisme, et ils nous emportent comme la toute première gorgée de whisky : « Telle une marquise éthérée, je trempai précautionneusement mes lèvres dans le magma tourbeux et… ô violence de l’effet ! C’est une déflagration de piment et d’éléments déchaînés qui détonne soudain dans la bouche ; les organes n’existent plus, il n’y a plus ni palais, ni joues, ni muqueuses : juste la sensation ravageuse qu’une guerre tellurique se déroule en nous-mêmes. »
Mais je me relis et je réalise qu’emporté par les saveurs et les mots, j’ai oublié de mentionner l’intrigue. Tant pis, j’ai déjà épuisé mon « crédit mot ». Sachez seulement que c’est amusant et drôlement bien mené. Je voudrais juste abuser de votre patience d’ami lecteur pressé pour en venir enfin au fait : Un homme se tient aussi par le ventre. Cela est admirablement développé par Barbery lorsqu’un des protagonistes, un jeune critique gastronomique interrogé le maître au sujet d’un sorbet (« le sorbet est aérien, presque immatériel, il mousse juste un peu au contact de notre chaleur puis, vaincu, pressé, liquéfié, s’évapore dans la gorge et ne laisse à la langue que la réminiscence charmante du fruit et de l’eau qui ont coulé par là ») le qualifie de sorbet de grand-mère. Dans sa bouche et aux oreilles du maître, c’est le plus beau des qualificatifs, et le voilà à parler de la cuisine de grand-mère…
Je crois qu’elles avaient conscience, sans même se le dire, d’accomplir une tâche noble en laquelle elles pouvaient exceller et qui n’était qu’en apparence subalterne, matérielle ou bassement utilitaire. Elles savaient bien, par-delà toutes les humiliations subies, non en leur nom propre mais en raison de leur condition de femmes, que lorsque les hommes rentraient et s’asseyaient, leur règne à elle pouvait commencer. Et il ne s’agissait pas de mainmise sur « l’économie domestique » où, souveraines à leur tour, elles se seraient vengées du pouvoir que les hommes avaient à « l’extérieur ». Bien au-delà de cela, elles savaient qu’elles réalisaient des prouesses qui allaient directement au cœur et au corps des hommes et leur conféraient aux yeux de ceux-ci plus de grandeur qu’elles mêmes n’en accordaient aux intrigues du pouvoir et de l’argent ou aux arguments de la force sociale. Elles les tenaient, leurs hommes, non pas par les cordons de l’administration domestique, par les enfants, la respectabilité ou même le lit – mais par les papilles, et cela aussi sûrement que si elles les avaient mis en cage et qu’ils s’y fussent précipités d’eux-mêmes.[…]
Que ressentaient-ils, ces hommes imbus d’eux-mêmes, ces « chefs » de famille, dressés depuis l’aurore, dans une société patriarcale, à devenir les maîtres, lorsqu’ils portaient à leur bouche la première bouchée des mets simples et extraordinaires que leurs femmes avaient préparés dans leurs laboratoires privés ? Que ressent un homme dont la langue jusqu’alors saturée d’épices, de sauce, de viande, de crème, de sel, se rafraîchit subitement au contact d’une longue avalanche de glace et de fruit, juste un peu rustique, juste un peu grumeleuse, afin que l’éphémère le soit un peu moins, retardé par la déliquescence plus lente des petits glaçons fruités qui se disloquent doucement… Ces hommes ressentaient le paradis, tout simplement, et même s’ils ne pouvaient se l’avouer, ils savaient bien qu’eux-mêmes ne pouvaient le donner ainsi à leurs femmes, parce que avec tout leur empire et toute leur arrogance, ils ne pouvaient les faire se pâmer comme elles les faisaient jouir en bouche !
07:35 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : Une gourmandise, Livres, Muriel Barbery, Littérature






