08 mai 2014
Proposition délicieuse - 2
A 15h31, je n'étais toujours pas à l'horizon. Il était maintenant temps d'ouvrir le paquet. Sylvie en déchira délicatement l'extrémité, d'une main légèrement tremblante, au beau milieu de la gare. Le paquet rouge contenait un livre érotique dont la couverture suggérait la nature du contenu. Et puis une lettre:
Bonne année ma belle !
Je te souhaite une bonne année, pleine d'orgasmes débridés dont j'espère être un des premiers instigateurs ! Et oui, je compte bien gagner ce défi, celui de te faire jouir malgré tous tes efforts pour résister au plaisir !
J'aime bien ce petit roman érotique de Françoise Rey. Presque un classique. Je te défie de le lire ouvertement dans le TGV 6624 qui part pour paris à 16h. En matière de défi impudique, avoue que tu craignais pire ! Un message secret y est caché. Si tu me décris cette contrainte, tu augmenteras tes chances de gagner la seconde partie du défi !
Arrivée à Paris, tu iras à l'hôtel selon le plan ci joint.
Baisers dévorant,
Vagant
 Sylvie découvrit dans l'enveloppe un plan de Paris annoté et un billet de train, départ pour Paris à 16 h, retour le soir même à 23h59, juste avant que son carrosse ne se transforme en citrouille. Si quelqu'un lui avait dit une minute auparavant qu'elle allait monter dans un train pour Paris, elle ne l'aurait jamais cru. Quelques minutes plus tard, elle y était pourtant confortablement installée. Le train s'ébranla doucement, et elle plongea dans ce roman. A côté d'elle, un homme jetait régulièrement un coup d'œil indiscret sur ce livre érotique qu'elle lisait ouvertement, conformément à mes instructions. En face, un jeune homme charmant lui adressait des sourires complaisants. Sylvie se demanda si je n'avais pas tout mis en œuvre pour qu'elle se fasse draguer dans le train ?
Sylvie découvrit dans l'enveloppe un plan de Paris annoté et un billet de train, départ pour Paris à 16 h, retour le soir même à 23h59, juste avant que son carrosse ne se transforme en citrouille. Si quelqu'un lui avait dit une minute auparavant qu'elle allait monter dans un train pour Paris, elle ne l'aurait jamais cru. Quelques minutes plus tard, elle y était pourtant confortablement installée. Le train s'ébranla doucement, et elle plongea dans ce roman. A côté d'elle, un homme jetait régulièrement un coup d'œil indiscret sur ce livre érotique qu'elle lisait ouvertement, conformément à mes instructions. En face, un jeune homme charmant lui adressait des sourires complaisants. Sylvie se demanda si je n'avais pas tout mis en œuvre pour qu'elle se fasse draguer dans le train ?
Comme elle me le dit plus tard, jamais Sylvie ne m'aurait fait l'affront de ne pas venir. Elle avait en moi une confiance aveugle, même si je lui demandais de foncer dans le noir avec un roman érotique en guise de canne blanche. D'ailleurs, cette histoire torride au vocabulaire bien salé lui faisait craindre le pire. Avais-je eu l'idée d'adapter un épisode de cette chronique sulfureuse ? Soudain, l'histoire érotique que j'avais moi-même récemment postée sur un forum féminin s'imposa à son esprit. Une histoire d'exhibition au bois de Boulogne, dont elle ne s'était pas du tout imaginée pouvoir en être l'héroïne lorsqu'elle l'avait lue. L'aurais-je fait venir à Paris pour ça ? Avais-je déjà écrit tout le scénario qu'elle était en train de vivre sur un forum public, parmi les autres fictions que je commettais de temps en temps ? J'en aurais été bien capable ! Sans parler de cette histoire de pièces d'identité que j'avais évoquée voici quelques jours sur MSN ! Sylvie plongea alors dans le roman à la recherche d'un indice. Enfin un mot souligné, et puis une lettre un peu plus loin, et encore un mot. Sylvie repéra tous les passages concernés:
Je dois bredouiller des trucs incompréhensibles au téléphone car on me demande de répéter. On ne joue pas comme çà avec une femme toute tendue, toute mouillée et qui se donne si fort ! Je vais te dire comment çà s'est passé.[...] Je ne me toucherai pas une seule seconde. Tu veux des images, des paroles, des histoires qui te feront d'autant plus bander que tu en connaîtras l'auteur ? [...] Toi, tu semblais amusé, peut-être un peu attendri. J'ai écarté d'une main la fente complaisante du sous-vêtement pour bien tout te faire voir, et, du bout des doigts, j'ai écarté aussi celle, plus intime, qui partage le bas de mon ventre. Et tu as contemplé, déjà allumé, ce jeu télescopique et voluptueux de failles, la blanche autour de la noire, et la noire servant d'écrin à la rose, plus vivante, plus nacrée, plus palpitante. Mes doigts ouvraient pour toi un passage dans un fruit délicat et juteux, accueillant comme une pêche qui vient d'éclater au soleil, vibrant comme un coquillage dont on a forcé le secret [...] Je me branle le con avec cette putain de bougie qui tombait à pic, et je m'applique à bouleverser le sens de cette ridicule expression "tenir la chandelle", qui voudrait dire qu'on assiste sans participer [...] Parce qu'elle t'avait manifesté clairement un intérêt plus que flatteur, et parce qu'elle ne te laissait pas indifférent non plus, je me retrouvai, ce fameux mercredi, seule avec elle pour t'attendre.[...] J'éprouvais un plaisir double, et quelque part très ambigu : celui de te sucer, et celui de manger après elle.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Le début de cette histoire vraie...
08:51 Publié dans Défis (suite) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sylvie, expériences, proposition délicieuse, erotisme, livres
15 août 2008
Mon plus secret conseil…
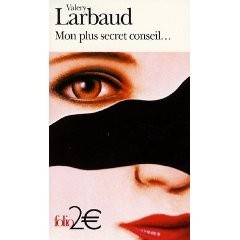 Ce titre est épatant, n’est-ce pas ? Moi en tous cas, c’est épaté que je me suis fait appâter par ce roman de Valéry Larbaud publié aux éditions folio, d’autant plus qu’il ne coûtait que deux petits euros. Le prix d’un café. Je croyais ne faire qu’une gorgée de sa centaine de pages, mais j’ai eu bien du mal à avaler cette prose décousue qui serpente au fil des pensées de Lucas Letheil, jeune héritier prétentieux jusqu’aux prétentions littéraires. Il envisage de quitter sa maîtresse colérique. Il ne sait pas que c’est imminent lorsqu’il s’éloigne de leur résidence Napolitaine au cours de sa promenade matinale, qu’il pousse jusqu’à sauter dans le premier train venu. Larbaud y embarque aussi le pauvre lecteur contraint de passer du Français à l’Italien dans cette aventure intérieure. On ne sait d’ailleurs pas trop si l’auteur parle de lui ou de son anti-héros puisqu’il utilise tantôt « je », tantôt « il » et parfois « nous ». Nous en sommes d’ailleurs là dans cet extrait plus que représentatif puisque c’est, à mon humble avis, la meilleure page :
Ce titre est épatant, n’est-ce pas ? Moi en tous cas, c’est épaté que je me suis fait appâter par ce roman de Valéry Larbaud publié aux éditions folio, d’autant plus qu’il ne coûtait que deux petits euros. Le prix d’un café. Je croyais ne faire qu’une gorgée de sa centaine de pages, mais j’ai eu bien du mal à avaler cette prose décousue qui serpente au fil des pensées de Lucas Letheil, jeune héritier prétentieux jusqu’aux prétentions littéraires. Il envisage de quitter sa maîtresse colérique. Il ne sait pas que c’est imminent lorsqu’il s’éloigne de leur résidence Napolitaine au cours de sa promenade matinale, qu’il pousse jusqu’à sauter dans le premier train venu. Larbaud y embarque aussi le pauvre lecteur contraint de passer du Français à l’Italien dans cette aventure intérieure. On ne sait d’ailleurs pas trop si l’auteur parle de lui ou de son anti-héros puisqu’il utilise tantôt « je », tantôt « il » et parfois « nous ». Nous en sommes d’ailleurs là dans cet extrait plus que représentatif puisque c’est, à mon humble avis, la meilleure page :
On dira que nous sommes bien difficile ; mais c’est que, si nous sommes repu de scènes de ménage et de tempêtes domestiques, nous sommes aussi repu
Persano.
d’amour. Onze heure moins dix. On va s’arrêter partout maintenant. La ligne monte. Il n’y a plus que de petites gares jusqu’à Potenza ; pas de voyageurs de première. Et les monts de la Lucanie en vue. Des arrêts de trois secondes ; le temps de dire pronti et partenza. – Oui, repu d’amour, malgré l’insensibilité croissante. Et c’est cela qui retarde la rupture, qui nous fait espérer, contre toute espérance, que la dernière crise sera vraiment la dernière. Nous sommes fidèle, aussi. Voici une bien jolie femme ; sans doute, mais nous avons mieux, ou aussi bien à la maison. Des Challettes, lui, court toujours ; il a une liste de formules d’abordage, pour la rue, le théâtre, la plate-forme du tramway… ; a des cartes de visite, avec cette anticipation : « Avocat à la Cour », qu’il glisse, pliées en quatre, dans les mains des jeunes filles et des jeunes femmes accompagnées. J’ai fait ça, autrefois, par esprit d’imitation, quand je sortais avec… Chose… de Louis-Le-Grand. Nous avions l’air de deux agents matrimoniaux, de deux délégués à l’amour. Les premiers venus offrant leurs services aux premières venues. Quelle fatigue !... Quel ennui !... Pourtant si on m’avait demandé ce que je cherchais pendant mes promenades du matin dans Naples, une fois le contact bien établi avec les aspects intimes de la ville, j’aurais – paresse, peur de paraître compliqué – répondu : des femmes.
Enfin, lorsque ce roman s'achève sur l’assoupissement de Lucas, on comprend que sa vocation était sans doute d’être un livre de chevet.
23:09 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Mon plus secret conseil, Larbaud, Livres, Littérature, rupture
19 juin 2008
La brioche de Tolstoï
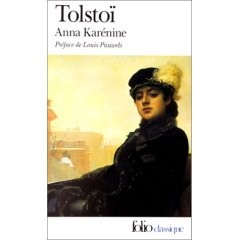 - Vois-tu, mon ami, les femmes sont le ressort qui fait tout mouvoir en ce monde… Tu me demandes où en sont mes affaires ? En fort mauvais point, mon cher… Et tout cela à cause des femmes… Donne-moi franchement ton avis, continua-t-il en tenant un cigare d’une main et son verre de l’autre.
- Vois-tu, mon ami, les femmes sont le ressort qui fait tout mouvoir en ce monde… Tu me demandes où en sont mes affaires ? En fort mauvais point, mon cher… Et tout cela à cause des femmes… Donne-moi franchement ton avis, continua-t-il en tenant un cigare d’une main et son verre de l’autre.
- Sur quoi ?
- Voici, supposons que tu sois marié, que tu aimes ta femme, et que tu te sois laissé entraîné par une autre femme.
- Excuse-moi, mais je ne comprends rien à pareille affaire ; c’est pour moi, comme si tout à l’heure en sortant de dîner j’allais voler une brioche dans une boulangerie.
Les yeux de Stépane Arcadiévitch [Oblonski] pétillèrent.
- Pourquoi pas ? Certaines brioches sentent si bon qu’on ne saurait résister à la tentation : « Je suis ravi quand j’ai pu vaincre le désir de ma chair ; mais si je n’y réussis pas, j’ai au moins le plaisir pour moi. »
Ce disant, Oblonski sourit malicieusement ; Levine ne put se retenir de l’imiter.
- Trêve de plaisanteries, continua Oblonski. Il s’agit d’une femme charmante, modeste, aimante, sans fortune et qui vous a tout sacrifié : faut-il l’abandonner, maintenant que le mal est fait ? Mettons qu’il soit nécessaire de rompre, pour ne pas troubler la vie de famille, mais ne doit-on pas avoir pitié d’elle, lui adoucir la séparation, assurer son avenir ?
- Pardon, mais tu sais que pour moi les femmes se divisent en deux classes… ou pour mieux dire, il y a les femmes et les… Je n’ai jamais vu et ne verrai jamais de belles repenties ; mais des créatures comme cette Française du comptoir avec son fard et ses frisons ne m’inspirent que du dégoût, comme d’ailleurs toutes les femmes tombées.
- Même celle de l’Évangile ?
- Ah ! Je t’en prie… Le Christ n’aurait jamais prononcé ces paroles, s’il avait su le mauvais usage qu’on en ferait : c’est tout ce qu’on a retenu de l’Évangile. Au reste, c’est plutôt une affaire de sentiments que de raisonnement. J’ai une répulsion pour les femmes tombées, comme tu en as une pour les araignées. Nous n’avons pas eu besoin pour cela d’étudier les mœurs ni des unes ni des autres.
- Tu me rappelles ce personnage de Dickens qui rejetait de la main gauche par-dessus l’épaule droite toutes les questions embarrassantes. Mais nier un fait n’est pas répondre. Que faire, voyons, que faire ? Ta femme vieillit tandis que la vie bouillonne encore en toi. Tu te sens tout d’un coup incapable de l’aimer d’amour, quelque respect que tu professes d’ailleurs pour elle. Sur ces entrefaites l’amour surgit à l’improviste et te voilà perdu ! s’exclama pathétiquement Stépane Arcadiévitch.
Lévine eut un sourire sarcastique.
- Oui, oui, perdu ! répétait Oblonski. Eh bien, voyons, que faire ?
- Ne pas voler de brioche.
Stépane Arcadiévitch se dérida.
- Ô moraliste !... Mais comprends donc la situation. Deux femmes s’affrontent. L’une se prévaut de ses droits, c'est-à-dire de l’amour que tu ne peux lui donner ; l’autre sacrifie tout et ne te demande rien. Que doit-on faire ? Comment se conduire ? Il y a là un drame effrayant.
- Si tu veux que je te confesse ce que j’en pense, je ne vois pas là de drame. Voici pourquoi. Selon moi l’amour… les deux amours tels que tu dois t’en souvenir, Platon les caractérise dans son Banquet, servent de pierre de touche aux hommes, qui ne comprennent que l’un ou l’autre. Ceux qui comprennent uniquement l’amour non platonique n’ont aucune raison de parler de drame, car ce genre d’amour n’en comporte point. « Bien obligé pour l’agrément que j’ai eu » : voilà tout le drame. L’amour platonique ne peut en connaître davantage, parce que là tout est clair et pur, parce que…
À ce moment Levine se rappela ses propres péchés et la lutte intérieure qu’il avait subie. Il termina donc sa tirade d’une manière imprévue :
- Au fait, peut-être as-tu raison. C’est bien possible… Mais je ne sais pas, non, je ne sais pas.
- Vois-tu, dit Stépane Arcadiévitch, tu es un homme tout d’une pièce. C’est ta grande qualité mais aussi ton défaut. Parce que ton caractère est ainsi fait, tu voudrais que la vie fût constituée de même façon. Ainsi tu méprises le service de l’État, parce que tu voudrais que toute occupation humaine correspondît à un but précis – et cela ne saurait être. Tu voudrais également un but dans chacun de nos actes, tu voudrais que l’amour et la vie conjugale ne fissent qu’un – cela ne saurait être. Le charme, la variété, la beauté de la vie tiennent précisément à des oppositions de lumière et d’ombre.
Anna Karénine, Première partie, chapitre XI
~~~~~~~~~~~~~~
Ami lecteur, ce n’est pas vous qui me féliciterez d’avoir résisté à la tentation. Car pendant plus d’un mois, j’ai résisté à celle d’écrire sur ce blog. Rien, même pas un commentaire ni un regard aux statistiques, l’abstinence complète afin d’échapper à ce qui m’était apparu devenir une addiction. J’aurais pu vous prévenir de ma résolution, mais non, silence radio, et sans le moindre scrupule. Quand je vous disais que je suis infidèle…
Je suis aussi opportuniste. J’ai lâchement profité d’un surcroît de travail auquel je me suis assidûment consacré, ainsi que d’un bon roman qui m’a tenu éloigné de toute velléité littéraire. Il faut dire que face à un monument comme Anna Karénine, l’écrivaillon ne peut que faire taire son clavier. Je ne vous ferai pas l’offense supplémentaire de vous apprendre ce qu’est, selon Louis Pauwels, « ce grand roman de l’adultère, au souffle beaucoup plus grand que Madame Bovary ». J’ai bien une prédilection naturelle pour m’étendre - et même me vautrer - sur ce thème, mais c’est plutôt l’intrication du roman avec la vie personnelle de son auteur dont j’ai envie de vous parler.
Anna Karénine s’inscrit à un tournant de la vie de Lev Nicolaievitch Tolstoï. Guerre et paix lui a déjà apporté la renommée, il n’en est pas moins déchiré entre sa vie littéraire mondaine et sa religiosité puritaine. Un soir de 1873, après avoir relu Pouchkine, le bouillant Tolstoï se lance dans ce roman comme sous l’effet d’une impulsion créatrice incontrôlable - pour ainsi dire libidinale au sens psychologique du terme. Il croit alors pouvoir le terminer en deux semaines, et le publier sous forme de feuilleton dans le messager russe. Quatre ans plus tard, il y est toujours. Après avoir touché 20000 roubles – la somme la plus importante jamais versée pour un roman à cette époque – Tolstoï ne parvient pas à accorder le démon littéraire qui l’aiguillonne, avec ses méditations existentielles au thème récurrent : « Quel est le sens de la vie ». Partagé entre l’envie de peaufiner son chef d’œuvre et celle d’en finir, il en multiplie les plans et les variantes qui finissent par compter autant de pages que l’énorme roman final, soit plus de 850 pages dans l’édition de poche.
La chronologie de ces variantes montre que l’intrigue initiale entre Anna Karenine et son amant le prince Vronski, s’est peu à peu enrichie d’une histoire parallèle : celle du couple vertueux Lévine – Kitty, largement autobiographique. En traversant ce roman de part en part, Lévine-Tolstoi semble donner le contrepoint moraliste de la chute d’Anna Karénine, et remplir ainsi sa mission prosélyte comme le souligne la citation Biblique de la préface « À moi la vengeance et la rétribution » - ce qui prête à sourire quand on réfléchit à l’ambiguïté du mot « moi ». Néanmoins, il ne se départit pas d’une certaine sincérité, notamment lorsqu’il décrit comment Lévine confie son journal intime à sa jeune épouse pour lui avouer son « impureté sexuelle » au soir de sa nuit de noce, épisode autobiographique qui torturera Tolstoi jusqu’à son lit de mort.
C’est cette sincérité là qui désarçonne Lévine dans ce dialogue avec Oblonski, qui incarne le jouisseur opportuniste, le terrien sympathique, aux préoccupations prosaïques étriquées comparées aux élans passionnés d’Anna Karénine. C’est pourtant ce personnage attachant, dépeint par l’auteur avec tout l’amour du Seigneur envers le pêcheur à convertir, qui balaye les arguties du moraliste. Comme un clin d’œil à la vie terrestre avant que Tolstoï n’embrasse la blancheur immaculée où il se perdra.
23:10 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : livres, tolstoï, anna karénine, adultère
21 février 2008
Copenhague
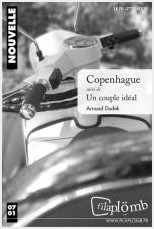 Non, je ne vais pas vous ennuyer avec une note touristique sur cette ville ennuyeuse qui ne peut faire rêver que ceux qui n’y sont jamais allés ( si vous tenez vraiment à partir dans le coin, traversez le pont et visitez Malmö qui est tout aussi bien et beaucoup moins cher ), mais avec une note sur une nouvelle intitulée Copenhague publiée aux éditions filaplomb.
Non, je ne vais pas vous ennuyer avec une note touristique sur cette ville ennuyeuse qui ne peut faire rêver que ceux qui n’y sont jamais allés ( si vous tenez vraiment à partir dans le coin, traversez le pont et visitez Malmö qui est tout aussi bien et beaucoup moins cher ), mais avec une note sur une nouvelle intitulée Copenhague publiée aux éditions filaplomb.
Après avoir sciemment massacré le petit suspens que j’escomptais vous servir aujourd’hui, je n’insisterai pas trop sur mon étonnement lorsque j’ai reçu dans ma boite au lettre en fer et qui couine, une enveloppe manuscrite à la vraie main et à mon nom bien réel. Il faut dire que pour le monde commun et trivial, je ne suis qu’un patronyme imprimé à la chaîne pour le compte d’une banque, d’une assurance ou d’une caisse de retraite, et les seules enveloppes manuscrites qu’il m’arrive d’ouvrir contiennent des faire part de mariage ( de moins en moins) de naissance ( le pic est passé aussi ) et plus rarement de décès ( mais c’est en croissance ), c’est-à-dire le lot commun de la boite aux lettres du cadre moyen déjà plus tout jeune…
Bref, il y a quelques semaines, je reçois une enveloppe manuscrite que ma femme n’a pas osée ouvrir. « Tu es sur que ce n’est pas une lettre piégée » qu’elle me dit sans rire. « Mais qui pourrait bien m’en vouloir ? » que je réponds en décachetant l’enveloppe sans penser aux quelques cocus qui pourraient me trucider s’ils retrouvaient ma trace. Et là, qu’est-ce que je trouve ? Vous le savez déjà : Copenhague suivi de Un couple idéal d’Arnaud Dudek, un recueil de deux nouvelles de 10 pages chacune au format 10 x 15. Le papier - recyclé avec des encres végétales sans solvant - est de bonne qualité ainsi que l’impression et la mise en page, même si on aurait apprécié une couverture un petit peu plus épaisse. Mais pour 4,20 € frais de port compris - le prix d’un café sur une terrasse parisienne - je n’ai pas boudé le quart d’heure de plaisir que la lecture de ces nouvelles m’a procuré. Je connaissais déjà Dudek pour son excellent blog littéraire, mais le lire allongé dans son lit, c’est tout de même mieux qu’assis devant un écran.
Cela suffit pour la forme, venons en au fond : deux nouvelles sur les solitudes qui s’ajoutent pour composer un couple. J’ai toujours pensé qu’un texte devait se défendre tout seul, alors je vous en livre un petit extrait :
Il aimerait découvrir l’Europe du Nord, il ne connaît pas. Copenhague, pourquoi pas ? Ce sera difficile d’imposer cette idée. Sylvia voudra de la chaleur. Siroter des cocktails à base de jus d’ananas en regardant des bellâtres transpirer autour d’un filet de volley-ball. Allongée sur une serviette de plage à fleurs, vêtue d’un maillot de bain une pièce assez terne, à compléter les cases d’un Sudoku.
Au poignet, un bout de plastique jaune digne des meilleurs Clubs Mickey indiquera son rattachement à un club de vacances situé à Hammamet.
Son visage outrageusement bronzé fera pâlir les collègues de jalousie lors du premier café de septembre, celui où l’on montre des vestiges de coups de soleil soignés à la Biafine comme autant de blessures de guerre.
Copenhague, ça risque de la mettre en rogne.
J’espère vous avoir donné envie de découvrir Arnaud Dudek auquel je souhaite le succès qu’il mérite. Quant à son éditeur, je lui souhaite d’attraper une bonne crampe à écrire les noms des lecteurs auxquels il envoie un peu de bonheur.
07:00 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : Livres, Arnaud Dudek, Copenhague, Filaplomb, Littérature
24 janvier 2008
La nuit de Valognes
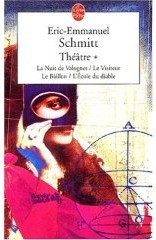 Dans un château perdu de Normandie, plusieurs femmes attendent un homme. Elles l'ont aimé ; elles le haïssent. Il les a trahies, elles vont le punir. Cet homme, c'est Don Juan... Mais grand sera leur étonnement lorsque le séducteur arrivera au rendez-vous. Pourront-elles lui pardonner de ne plus être celui qu'elles ont tant aimé ?
Dans un château perdu de Normandie, plusieurs femmes attendent un homme. Elles l'ont aimé ; elles le haïssent. Il les a trahies, elles vont le punir. Cet homme, c'est Don Juan... Mais grand sera leur étonnement lorsque le séducteur arrivera au rendez-vous. Pourront-elles lui pardonner de ne plus être celui qu'elles ont tant aimé ?
Après Le bal des mots dits et Le libertin réconcilié, voici mon analyse de « La nuit de Valognes » d’Eric-Emmanuel Schmitt, et c’est chez Ysé…
PS: Je viens de découvrir une note brillante sur le Don Juan de Molière, qui éclaire le mythe sous un jour bien moins agnostique que ne le font les analyses habituelles... décapant !
09:25 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : La nuit de Valognes, Livres, Eric Emmanuel Schmitt, Don Juan, Théâtre, Littérature
13 décembre 2007
Le bal des mots dits... (par Ysé)
Tout commence par un coup de foudre. Un coup de foudre, ça s'abat sur des coeurs prompts à aimer aussi violemment que ça libère les relents de vengeance et de haine. Mais il n'y a pas que le ciel qui déchaîne son courroux...
Cinq femmes se retrouvent une nuit dans le manoir de la duchesse de Vaubricourt. Un lourd secret, une question de vie ou de mort, voilà ce qui pouvait les réunir.
Qu'ont en commun une châtelaine rancunière, une comtesse frivole, une religieuse gentiment sotte, une intello revêche se piquant d'écrire des bluettes et une jeune mariée ? Rien, si ce n'est que jadis, elles ont été séduites et abandonnées par Don Juan. Mais ces victimes n'ont rien à voir avec les mille e tre espagnoles que le "vil séducteur" connut au sens biblique du terme. Ces femmes-là ont résisté, et ont ainsi offert à Don Juan ses plus éclatantes conquêtes, tout au moins à en croire le carnet tenu par Sganarelle oscillant entre le livre de comptes et le récit des amours de son maître.
Bien vite, les victimes, vêtues de blanc et non de candeur, vont troquer leur tunique de martyr contre la robe de juge, et elles sortiront si besoin est, la hâche du bourreau. Ce soir, elles vont sceller le destin du séducteur qui devra épouser et être fidèle à sa dernière conquête en date, Angélique, qui n'est autre que la nièce de la comtesse. S'il refuse, c'est une affaire de duel qui mènera le plus célèbre des sentimenteurs en prison. Lui qui croyait se rendre à un bal, ne sera pas le seul à mener la danse.
 On rit, jaune parfois, on se laisse toucher par les escarmouches et l'on se laisse prendre par ce qui est représenté sur scène. Le spectateur ne peut demeurer passif tant la première pièce d'Eric-Emmanuel Schmitt regorge de joutes verbales et autres stichomythies enlevées. Bref, cette pièce nous interpelle, bouscule valeurs moralistes et idées préconçues tandis qu'elle pose les questions les plus audacieuses avec un cynisme résolument provocant. Si le public ne fait pas de catharsis, du moins voit-il les passions, qu'il s'efforce de museler, se déchaîner : amour égoïste propre aux enfants, vengeance, trahison, jalousie, tout y est ! Chacun détient une part de vérité, nul n'a entièrement tort. Qui pourrait se vanter de ne s'être jamais trompé ? Don Juan lui-même, n'a pas su reconnaître l'amour véritable qui ne saute pas toujours aux yeux quand il prend une forme inattendue.
On rit, jaune parfois, on se laisse toucher par les escarmouches et l'on se laisse prendre par ce qui est représenté sur scène. Le spectateur ne peut demeurer passif tant la première pièce d'Eric-Emmanuel Schmitt regorge de joutes verbales et autres stichomythies enlevées. Bref, cette pièce nous interpelle, bouscule valeurs moralistes et idées préconçues tandis qu'elle pose les questions les plus audacieuses avec un cynisme résolument provocant. Si le public ne fait pas de catharsis, du moins voit-il les passions, qu'il s'efforce de museler, se déchaîner : amour égoïste propre aux enfants, vengeance, trahison, jalousie, tout y est ! Chacun détient une part de vérité, nul n'a entièrement tort. Qui pourrait se vanter de ne s'être jamais trompé ? Don Juan lui-même, n'a pas su reconnaître l'amour véritable qui ne saute pas toujours aux yeux quand il prend une forme inattendue.
La mise en scène de Régis Santon est magistrale de simplicité et d'efficacité. Le procès de Don Juan se tient à huit clos entre les murs étouffants du château de la duchesse de Vaubricourt. A n'en pas douter, l'auteur de la pièce n'aurait pas renié la scénographie, ni même la musique accompagnant la perte de Don Juan ; car qui mieux que Mozart et son Requiem aurait pu illustrer la force de ce destin ?
Quant aux acteurs, ils ont campé avec conviction des personnages pouvant paraître, à première vue, caricaturaux. Mais derrière les masques, restent égratignures et plaies loin d'être refermées.
Le Don Juan d'Eric-Emmanuel Schmitt, tout en étant caustique, toujours aussi libre envers Dieu et les choses de l'amour, accepte son destin, et en cela, il est radicalement différent de celui de Molière qui toisait la statue du Commandeur, avec une effronterie presque puérile. Ici, Don Juan a gagné en sagesse et il lève enfin le voile sur le mystère de sa vie : qu'est-ce qui faisait courir Don Juan ? Fuyait-il ou cherchait-il quelque chose ? Vous aurez la réponse en lisant la pièce ou en allant voir la représentation au théâtre Silvia Monfort, ce que je vous recommande.
Tout a une fin et le malheur des uns fait le bonheur des autres, et ce n'est pas Sganarelle qui démentirait, lui qui perçoit enfin ses gages !
_________________________________________
note : Une stichomythie est une partie de dialogue d'une pièce de théâtre versifiée où se succèdent de courtes répliques, de longueur à peu près égale, n'excédant pas un vers, produisant un effet de rapidité, qui contribue au rythme du dialogue.
07:10 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : Don Juan, Théâtre, La nuit de Valognes, Livres, Eric Emmanuel Schmitt, Ysé, Littérature
02 novembre 2007
De la morale et de la liberté (2)
Attention. Cette note cite une scène particulièrement violente qui risque de heurter votre sensibilité.
 « L’ouvrage n’étant pas massicoté, il est préférable, pour l’ouvrir, d’user d’un instrument plutôt que de son doigt. » Vendu sous blister avec cet avertissement collé sur sa couverture, Un roman sentimental est une magnifique opération commerciale. Pensez donc : Alain Robbe-Grillet, académicien de 85 ans, laisse à la postérité un sulfureux roman érotique ! Erotique, vraiment ? Si aucun avatar mercantile n’est épargné au lecteur pour aiguillonner son excitation, qu’en reste-t-il après avoir eu le supposé plaisir de démassicoter ce livre ? Voici une des premières scènes qui compose ce fameux roman et qui vous permettra d’apprécier son style si délicat…
« L’ouvrage n’étant pas massicoté, il est préférable, pour l’ouvrir, d’user d’un instrument plutôt que de son doigt. » Vendu sous blister avec cet avertissement collé sur sa couverture, Un roman sentimental est une magnifique opération commerciale. Pensez donc : Alain Robbe-Grillet, académicien de 85 ans, laisse à la postérité un sulfureux roman érotique ! Erotique, vraiment ? Si aucun avatar mercantile n’est épargné au lecteur pour aiguillonner son excitation, qu’en reste-t-il après avoir eu le supposé plaisir de démassicoter ce livre ? Voici une des premières scènes qui compose ce fameux roman et qui vous permettra d’apprécier son style si délicat…
5
Vers le mur du fond, celui sur lequel mes yeux alanguis errent avec le plus de facilité, je distingue, en premier plan d’un dessin dont l’évidence se confirme rapidement, perspective forestière aux troncs verticaux et rectilignes, une sorte de bassin d’eau si claire qu’elle en devient presque immatérielle, élargissement oblong d’une source limpide, aussi profond qu’une baignoire ou même davantage, entre des roches grises aux formes arrondies, douces au toucher, accueillantes. Une jeune fille est assise là, sur la pierre polie par l’usure qui représente pour elle une banquette idéale au ras de l’eau, où ses longues jambes remuent avec abandon dans les remous aux reflets bleus de l’aimable nymphée, naturelle autant que pittoresque, dont la température doit être identique à celle de l’air ambiant, ainsi que des charmes féminins eux-mêmes qui ondulent, déjà liquides, au dessus du miroir mouvant aux frémissements imprévus.
.
C’est après que ça se gâte. Invité chez Taddeï le 24 Octobre dernier pour la présentation de son roman, Alain Robbe-Grillet nous apprend qu’il y raconte les pérégrinations sexuelles de petites filles supplicées à mort dans un français irréprochable, avec un luxe de détails Flaubertien mais aussi la distanciation nécessaire et assez d’invraisemblances pour créer une atmosphère onirique, fantasmagorique, théâtrale qui situerait son roman dans le cadre de la catharsis. Voici quelques extraits de cette interview :
FT : Pensez-vous qu’on était plus tolérant à l’époque [ en 1974 ]
ARG : Oui car de plus en plus on confond le fantasme et la réalisation du fantasme. Or c’est exactement le contraire. Quelqu’un qui écrit, en général, est quelqu’un qui se soigne lui-même, qui soigne sa perversion en l’écrivant.
FT : C’est l’impression que vous avez, vous ?
ARG : Je ne sais pas mais… j’ai Aristote avec moi pour défendre cette thèse, dite de la catharsis. Et néanmoins, il y a quand même à l’heure actuelle un envahissement par le bien pensé. C'est-à-dire que ce soit politiquement correct, sexuellement correct, littérairement correct, racialement correct, etc… Il semble maintenant que quand on écrit quelque chose d’incorrect, c’est comme si on le commettait. C’est une méconnaissance totale de ce que c’est que l’écriture.
[…]
FT: Là vous faites monter, monter les fantasmes, et à partir du moment où il y a des enfants ça devient très différent. Vous vous attendez à quoi ?
ARG : Comme on le disait tout à l’heure, ce sont des écrits intimes, que j’écrivais pour moi, et celui là qui est rédigé avec un très grand soin, qui est quand même fait selon le même souci de représenter ce que j’ai dans la tête, un souci autobiographique pour ainsi dire, et il est évident que depuis que j’ai douze ans, j’ai toujours aimé les petites filles, c'est-à-dire que je pense qu’il y a des quantités de gens qui sont dans la même situation. L’amour pour les jeunes, les petits garçons pour les homosexuels et les petites filles pour les hétéros, c’est quelque chose d’extrêmement répandu, mais qui se domine très facilement, qui ne se réalise pas quoi ! Mais le penser ne fait de mal à personne.
[Reportage présentant les associations de défense de l’enfance qui s’étaient insurgées lors de la parution du livre rose bonbon, parce qu’il véhiculait l’idée que les enfants victimes des crimes pédophiles sont consentants.]
ARG : Ces gens qui se plaignent sont des pervers, visiblement !
FT : Pourquoi ?
ARG : Ils ont lu ça, et ils ont tout de suite gommé le fait que c’est un écrit littéraire, et ils ont réalisé le fantasme eux même dans leur tête ! À ce moment là ils se sont gendarmés contre qui ? Contre eux même ! Ces gens devraient être tous en prison ! Parce que c’est eux qui ont effectué la réalisation dans leurs cerveaux malades !
[…]
ARG : Puisque je parlais d’Aristote tout à l’heure, il a bien précisé dans la poétique que l’effet de catharsis ne jouait que selon certaines règles de distanciation par rapport au sujet. C'est-à-dire que si le fantasme est raconté de façon trop… Il ne parlait pas de fantasmes sexuels, Aristote, mais si l’idée est racontée avec trop de passion sensuelle alors, à ce moment là, on risque de provoquer ce que qu’Aristote appelle la mimésis, c'est-à-dire que le lecteur a tendance à vouloir réaliser lui-même ce qu’il est en train de lire. Alors que au contraire, avec cet effet Brechtien de distanciation, c’est l’effet inverse : la catharsis, c'est-à-dire que le lecteur va être purgé de ses passions, grâce à mon livre !
Voici les passions en question…
229
Quant aux trois plus jeunes des petites filles, Crevette, Nuisette et Lorette, qui ont sept, huit et neuf ans, elles se sont beaucoup amusées pendant leur service. Ramenées à leur dortoir J1, elles en parlent ensemble avec émerveillement. On leur a permis de goûter à toutes les liqueurs qu’elles devaient servir à genoux. Elles ont sucé des messieurs vigoureux et de jeunes dames parfumées. On les a caressées, embrassées, léchées. On a bourré des crèmes excitantes dans leurs orifices trop enfantins, avant de les branler de façon très douce. Elles ont admiré une adolescente qui flambait comme une torche. Elles ont vu couler le sperme et le sang, mais aussi les pleurs des collégiennes que l’on torturait. Vers la fin de la nuit, elles sont descendues dans les caves pour assister au supplice d’une servante de treize ans (vendue par sa famille) qui s’était enivrée. Après l’avoir violée de toutes les façons, des messieurs ont procédé à son écartèlement sur une machine spéciale, pendant qu’ils lui enfonçaient des aiguilles à travers tout le corps, dont les quatre membres se sont désarticulés peu à peu. Pour finir, on lui a arraché complètement l’une des cuisses, en tirant la jambe par le pied, et on l’a laissée se tordre dans un flot de sang pour mourir comme ça sans secours. Oui, c’était vraiment formidable.
J’ai choisi cette scène parce qu’elle est assez représentative de l’ensemble de « l’ouvrage » et assez courte pour être citée. Je vous laisse imaginer les 200 scènes intermédiaires où Robbe-Grillet raconte avec bien plus de détails les démembrements dont il semble si friand. Vous trouvez ça érotique, vous ? Si la catharsis a pour objet de purger le lecteur de pulsions communes, voire même fondamentales dans la construction du psychisme de chacun mais néanmoins réprimées par la loi ou la morale, comme l’interdit de l’inceste mis en scène - et puni – dans Oedipe Roi de Sophocle , qu’en est-il des pulsions criminelles d’Alain Robbe-Grillet ? La majorité de l’humanité partage-t-elle, à l’instar de cet auteur, le fantasme de découper un nouveau né au hachoir sous les yeux de sa mère elle-même torturée à mort ? Qui pourrait donc avoir besoin de lire un tel livre – si tant est que la supposée catharsis soit plus efficace que celle mise en scène dans L’orange mécanique ? De surcroît, Sophocle ne décrit pas les égarements d’Oedipe dans ses détails charnels avec la complaisance de Robbe-Grillet à l’égard de ses bourreaux d’enfants. Chez Sophocle, la mise à distance n’est pas qu’une vague atmosphère onirique : c’est une véritable tragédie qui donne du sens à la pulsion libidinale, qui la « corticalise » en l’inscrivant dans un mythe fondateur.
En vérité, le supposé effet cathartique de Un roman sentimental n’est qu’un misérable cache misère philosophique pour permettre la publication d’abominations qui n’auraient jamais dû franchir les portes d'un cabinet psychiatrique. Il ne s’agit pas de l’éventuelle purge du lecteur mais de celle bien réelle de l’auteur. Que les boyaux de son cortex incontinent défèquent des fantasmes abjects sur un bout de papier, soit. Qu’il les dore au subjonctif, pourquoi pas : c’est bien la moindre des choses de la part d’un académicien. Mais qu’il nous les donne à lire donne envie de vomir. Robbe-Grillet est comme un vieillard sénile qui exhibe son pot de chambre après une nuit de fièvre diarrhéique.
Voilà sa place :

Mais ne tirons pas la chasse trop vite !
Primo, il ne faudrait pas jeter l’anathème contre toute sorte de libertinage comme le fait Thierry Giaccardi chez Stalker, et je ne m’associerai certainement pas à ceux qui militent pour le retour du puritanisme. Je regrette d’ailleurs que l’adjectif « libertin » soit associé aux noms de Sade et de Robbe-Grillet, et je ne suis pas le premier à le faire. En 1798, Restif de la Bretonne, libertin s’il en est, publia Anti-Justine avec pour préface : « Personne n'a été plus indigné que moi des sales ouvrages de l'infâme de Sade [….] Ce scélérat ne présente les délices de l'amour qu'accompagnées de tourments, de la mort même pour les femmes. Mon but est de faire un livre plus savoureux que les siens et que les épouses pourront faire lire à leurs maris, pour en être mieux servies ; un livre où les sens parleront au cœur ; où le libertinage n’ait rien de cruel pour le sexe des grâces, et lui rende plutôt la vie, que de lui causer la mort ; où l’amour ramené à la nature, exempt de scrupules et de préjugés, ne présente que des images riantes et voluptueuses. On adorera les femmes en le lisant ; on les chérira en les enconnant : mais l’on en abhorrera davantage le vivodisséqueur […] »
Secundo, Un roman sentimental a tout de même une vertu, celle de remettre la question de la morale sexuelle au goût du jour. Honnêtement, Robbe-Grillet n’a rien inventé comme le souligne Pierre Assouline : il n’a fait qu’écrire une nouvelle version de Justine, et il va moins loin que Pasolini et son insoutenable Salo , ou les 120 jours de Sodome qui avait osé mettre en images de semblables abominations – avec au moins l’intention (ou le faux prétexte ?) de les dénoncer en les attribuant au fascisme. C’est sans doute au niveau de l’image que devrait se situer aujourd’hui le débat.
Dans un monde où on dispose des moyens techniques pour créer des images de toutes sortes, où la réalité virtuelle permet même d’envisager une seconde vie, rien n’empêche de mettre à la disposition du public des logiciels permettant de réaliser des images pédocriminelles plus vraies que nature. Alors que le fait de détenir des images « pédophiles » est sévèrement puni par la loi, on pourrait gagner « honnêtement » de l’argent en vendant des logiciels permettant de produire des images pédophiles virtuelles réalistes ? La frontière entre la légalité et le crime ne se jouerait alors qu’à quelques pixels près, ou bien il serait interdit de représenter graphiquement des scènes décrites avec tous les détails nauséeux (in)imaginables ? On retrouve curieusement le paradoxe de Robbe-Grillet qui veut enfermer ceux qui imaginent la mise en scène de ce qu’il écrit, et on peut légitimement se demander si l’arsenal législatif est vraiment adapté à ce type de question.
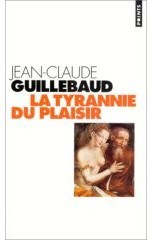 La question de la morale sexuelle, toujours d’actualité, est épineuse mais remarquablement traitée par Jean-Claude Guillebaud dans un de ses essais, La tyrannie du plaisir : N’y aurait-il donc pas d’autres choix possibles qu’entre permissivité claironnante ou moralisme nostalgique ?
La question de la morale sexuelle, toujours d’actualité, est épineuse mais remarquablement traitée par Jean-Claude Guillebaud dans un de ses essais, La tyrannie du plaisir : N’y aurait-il donc pas d’autres choix possibles qu’entre permissivité claironnante ou moralisme nostalgique ?
Dans une tentative de remise à plat, Jean-claude Guillebaud prend d’abord un recul historique qui permet de tordre le cou à bien des idées préconçues dont la liberté sexuelle de l’antiquité, l’austérité du moyen âge ou celle du Christianisme, pour nous rappeler la répétition de l’histoire à laquelle nous croyons avoir échappé du haut de notre courte vue. Il convie au débat historiens, philosophes, sexologues et sociologues pour aborder le sujet sous tous ses aspects, dont l’individualisme à outrance qui appauvrit l’échange qui devrait résulter du rapport sexuel où chacun des acteurs instrumentalise l’autre afin de parvenir à l’autosatisfaction motivée par l’acte en tant que fonction, et non plus en tant que moyen de communication privilégié : Le plaisir devient pure affaire anatomique, marchande et sportive (en attendant d’être cybernétique !) Il est prestation, rassasiement ou performance".
Face à la complexité de ces questions, Jean-Claude Guillebaud examine la démission de la société qui relègue les questions de société aux experts médicaux impuissants et aux juristes partagés entre deux logiques contradictoires de l’individualisme contemporain, celle de la revendication infinie de droits et celle de la demande de protection…
Comment ne serait-on pas troublés, dès qu’on se ressouvient du passé, par cette singulière situation ?
Vers le milieu des années 60, nous avions congédié le prêtre, le moraliste, le politique en charge du bien commun. Nous nous sentions la capacité - historiquement sans précédent - d’accorder à l’individu une primauté définitive sur le groupe. Nous pensions être investis du pouvoir de récuser ces prudences immémoriales, concessions aux contraintes, ruses collectives infinies et transactions de toutes sortes par lesquelles les sociétés humaines conjuguaient tant bien que mal l’aspiration au plaisir et l’impératif communautaire.
Voilà trente-cinq ans, nous fûmes, en matière de sexualité, plus intrépidement constructivistes qu’aucune société ne l’avait jamais été avant nous. L’apothéose de l’individu, son émancipation parachevée figuraient les vraies conquêtes de la modernité occidentale. Nous étions désormais assez riches, assez savants, assez raisonnables pour rejeter les superstitions du passé. Et assez libres, enfin, pour en dénoncer les tyrannies intimes.
La raison ne disqualifiait-elle pas la religion ? La démocratie ne rendait-elle pas inopérante la perpétuation politique des contraintes ? La connaissance ne nous assurait-elle pas la maîtrise des anciennes fatalités de l’espèce ? La science ne nous livrait-elle pas les clés de la procréation elle-même ? La certitude du progrès ne nous dispensait-elle pas de cette fidélité peureuse aux traditions ? La foi en l’universel, enfin, ne nous autorisait-elle pas à toiser le « pathos spécifique » des cultures humaines comme s’il s’agissait d’aimables folklores, avec leurs tabous et leurs précautions holistes ? Ce droit au plaisir, nous nous l’accordions comme une extraordinaire récompense historique. Il l’était en effet. On aurait bien tort de sourire rétrospectivement de cet optimisme.
Si l’on est troublé, aujourd’hui, c’est en voyant ce projet grandiose se heurter finalement aux mêmes obstacles, aux mêmes contradictions, aux mêmes risques mortels, surtout, que toutes les utopies qui l’avaient précédé. Le " climat " du moment, ces périls qui affleurent et ces peurs qui rôdent nous renvoient, au détail près, à des situations déjà vécues dans l’Histoire.
Cette violence polymorphe qu’à tort ou à raison nous sentons autour de nous, ce vertige sécuritaire qui nous empoigne au point de nous pousser à la panique juridique, ce sont précisément - on l’a vu dans les chapitres qui précèdent - ce que s’entêtèrent à conjurer les sociétés du passé. Il faudra nous résoudre à admettre que ces cultures traditionnelles, dont nous voulions orgueilleusement nous démarquer, n’avaient pas si mal compris l’intrication indissociable entre la sexualité et la violence.
J.C. Guillebaud : La tyrannie du plaisir, p. 379-381
Aujourd’hui, l’appareil judiciaire et les dispositifs pénaux nous tiennent lieu de directeur de conscience. Je crois que Un roman sentimental n’est qu’une grotesque provocation à leur endroit : je soupçonne que Robbe-Grillet a pour dernière ambition de se faire censurer afin de siéger aux côtés d’un Sade au panthéon des célébrités sulfureuses, lui qui a toujours méprisé « l’immortalité » bien pensante de l’académie Française. Ce vieillard n’a plus grand-chose à perdre. Nous, nous risquons de perdre encore un peu de liberté d’expression à cause de nouvelles législations réactionnaires qui pourraient être appliquées à tort et à travers. Le mieux que nous puissions faire est bien de laisser Un roman sentimental partir au pilon et de s'en convaincre en lisant La tyrannie du plaisir.
10:25 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (24) | Tags : De la morale et de la liberté, Alain Robbe-Grillet, Un roman sentimental, Jean-claude Guillebaud, La tyrannie du plaisir, Agrafe, Livres
01 novembre 2007
De la morale et de la liberté (1)
MME THERBOUCHE. Ne vous compromettez pas. N’écrivez pas sur la morale. Tout le monde attend de vous que vous affirmiez le règne de la liberté, que vous nous libériez de la tutelle des prêtres, des censeurs, des puissants, on attend de vous des lumières, pas des dogmes. Surtout, n’écrivez pas sur la morale.
DIDEROT. Mais si, il le faut.
MME THERBOUCHE. Non, s’il vous plaît. Au nom de la liberté.
DIDEROT. C’est que je ne sais pas si j’y crois, moi, à la liberté ! Je me demande si nous ne sommes pas simplement des automates réglés par la nature. Regardez tout à l’heure : je croyais venir ici me livrer à une séance de peinture, mais je suis un homme, vous êtes une femme, la nudité s’en est mêlée, et voilà que nos mécanismes ont eu un irrésistible besoin de se joindre.
MME THERBOUCHE. Ainsi, vous prétendez que tout serait mécanique entre nous ?
DIDEROT. En quelque sorte. Suis-je libre ? Mon orgueil répond oui mais ce que j’appelle volonté, n’est-ce pas simplement le dernier de mes désirs ? Et ce désir, d’où vient-il ? De ma machine, de la vôtre, de la situation créée par la présence trop rapprochée de nos deux machines. Je ne suis donc pas libre.
MME THERBOUCHE. C’est vrai.
DIDEROT. Donc je ne suis pas moral.
MME THERBOUCHE. C’est encore plus vrai.
DIDEROT. Car pour être moral, il faudrait être libre, oui, il faudrait pouvoir choisir, décider de faire ceci plutôt que cela… La responsabilité suppose que l’on aurait pu faire autrement. Va-t-on reprocher à une tuile de tomber ? Va-t-on estimer l’eau coupable du verglas ? Bref, je ne peux être que moi. Et, en étant moi et seulement moi, puis-je faire autrement que moi ?
MME THERBOUCHE. Que la plupart des hommes soient ainsi, je vous l’accorde. Vous êtes persuadés de vous gouverner par le cerveau alors que c’est votre queue qui vous mène. Mais nous, les femmes, nous sommes beaucoup plus complexes, raffinées.
DIDEROT. Je parle des hommes et des femmes.
MME THERBOUCHE. Ce n’est pas possible.
DIDEROT. Mais si.
MME THERBOUCHE. Vous ne connaissez rien aux femmes.
DIDEROT. Vous êtes des animaux comme les autres. Un peu plus charmants que les autres, je vous l’accorde, mais animaux quand même.
MME THERBOUCHE. Quelle sottise ! Savez-vous seulement ce qu’une femme éprouve pendant l’amour ?
DIDEROT. Oui. Euh… non. Mais qu’importe ?
MME THERBOUCHE. Savez-vous ce qu’une femme ressent lorsqu’elle s’approche d’un homme ? Ainsi, par exemple, moi, en ce moment, qu’est-ce que je peux sentir ? Oui, et si moi, en ce moment, je feignais…
DIDEROT. Pardon ?
MME THERBOUCHE. Si je n’avais pas de désir pour vous ? Si je mimais la tentation ? Si je tombais dans vos bras avec tout autre intention que celle que vous imaginez ?
DIDEROT. Et laquelle, s’il vous plaît ?
MME THERBOUCHE. Hypothèse d’école, nous discutons. Supposons que je n’aie pas de désir pour vous mais que j’essaie simplement d’obtenir quelque chose de vous.
DIDEROT. Et quoi donc ?
MME THERBOUCHE. Hypothèse, vous dis-je. Imaginez que je sois perverse. Il faut bien être libre pour se montrer pervers. Le vice ne serait-il pas la démonstration de notre liberté ?
DIDEROT. Non, car vous seriez une machine perverse, naturellement, physiologiquement perverse, mais une machine.
MME THERBOUCHE. Passionnant. Et tellement judicieux.
DIDEROT. Bref, votre objection ne change absolument rien à ma théorie. S’il n’y a point de liberté, il n’y a point d’action qui mérite la louange ou le blâme. Il n’y a ni vice ni vertu, rien dont il faille récompenser ou punir.
MME THERBOUCHE. Bravo ! Mais alors, comment édifier une morale ? Je me demande bien ce que vous allez pouvoir écrire.
_____________________________________
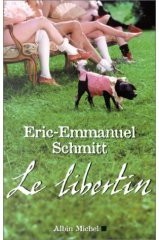 Cette note clôt ma série sur Diderot selon Eric Emmanuel Schmitt dans « Le libertin », et introduit la question de la morale sexuelle. C’est un sujet qui m’a longtemps travaillé, et qui est même au cœur de mon existence puisqu’il stigmatise mon pêché « mignon » : la luxure ! Je l’avais esquissé avec une note humoristique il y a près d’un an, mais il me va bien falloir l’aborder de front d’autant plus que l’actualité littéraire s’y prête merveilleusement bien !
Cette note clôt ma série sur Diderot selon Eric Emmanuel Schmitt dans « Le libertin », et introduit la question de la morale sexuelle. C’est un sujet qui m’a longtemps travaillé, et qui est même au cœur de mon existence puisqu’il stigmatise mon pêché « mignon » : la luxure ! Je l’avais esquissé avec une note humoristique il y a près d’un an, mais il me va bien falloir l’aborder de front d’autant plus que l’actualité littéraire s’y prête merveilleusement bien !
07:05 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Le libertin, Livres, Eric Emmanuel Schmitt, morale, liberté, Diderot, Littérature
27 octobre 2007
De la débauche et de la volupté
Moi : la Débauche / Elle : la Volupté
Devinez qui a gagné ? La volupté bien sûr !
11:30 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : débauche, Livres, volupté, diderot, le libertin, Ysé, Littérature
23 octobre 2007
Du mariage et de la postérité
Ami lecteur, je vous propose de poursuivre la réflexion entamée dans ma précédente note à propos de la pièce d’Eric Emmanuel Schmitt : « Le libertin ». Résumons la situation : dans le pavillon de chasse du baron d’Holbach, Diderot pose à demi-nu pour Mme Therbouche tout en marivaudant quand son secrétaire interrompt leurs jeux amoureux pour lui demander d’écrire au plus vite l’article sur la morale de l’Encyclopédie. Après avoir défendu ardemment la liberté individuelle auprès de son épouse dans la scène 8, Diderot change de discours dans la scène 13 avec sa fille qui lui annonce vouloir un enfant hors mariage et l’élever seule…

DIDEROT. « Moi » ! « Je » ! Cesse de te mettre au début, au centre et à la fin de tes phrases. Cet enfant doit avoir une famille, même si tu ne veux pas encore en fonder une. L’intérêt de l’espèce doit l’emporter sur celui de l’individu. Oublie pour un moment le point que tu occupes dans l’espace et dans la durée, étends ta vue sur les siècles à venir, les régions les plus éloignées et les peuples à naître, songe à notre espèce. Si nos prédécesseurs n’avaient rien fait pour nous, et si nous ne faisions rien pour nos neveux, ce serait presque en vain que la nature eût voulu que l’homme fût perfectible. Après moi, le déluge ! C’est un proverbe qui n’a été fait que par des âmes petites, mesquines et personnelles. La nation la plus vile et la plus méprisable serait celle où chacun le prendrait étroitement pour la règle de sa conduite. « Moi, moi » ! L’individu passe mais l’espèce n’a point de fin. Voilà ce qui justifie le sacrifice, voilà ce qui justifie l’homme qui se consume, voilà ce qui justifie l’holocauste du moi immolé sur les autels de la postérité.
[…]
MME THERBOUCHE. Dites-moi, étiez-vous sincère, là, à l’instant avec votre fille ?
DIDEROT. Oui. D’ailleurs, je le note immédiatement. L’Encyclopédie se doit d’aider les pères.
MME THERBOUCHE. C’est étonnant. Comment pouvez-vous à la fois défendre le plaisir individuel et dire que l’individu doit renoncer au plaisir pour le bien de l’espèce ?
DIDEROT. C’est une contradiction ?
MME THERBOUCHE. Ça y ressemble.
DIDEROT. Et pourquoi une morale ne serait-elle pas contradictoire ?
MME THERBOUCHE. Parce que, dans ce cas-là, ça ne fait pas une morale mais deux. La morale de l’individu, la morale de l’espèce. Et elles n’ont rien à voir l’une avec l’autre.
DIDEROT. C’est ennuyeux…
Il regarde ses feuillets et se met à barrer ce qu’il vient d’écrire avec un soupir.
07:15 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : Le libertin, Eric Emmanuel Schmitt, mariage, philosophie, Livres, Diderot
20 octobre 2007
Du mariage et du libertinage
MME DIDEROT. Tu fais ce que tu veux mais je ne veux plus que tu me trompes autant. Nous sommes mariés ! L’oublies-tu ?
DIDEROT. Le mariage n’est qu’une monstruosité dans l’ordre de la nature.
MME DIDEROT. Oh !
DIDEROT. Le mariage se prétend un engagement indissoluble. Or l’homme sage frémit à l’idée d’un seul engagement indissoluble. Rien ne me paraît plus insensé qu’un précepte qui interdit le changement qui est en nous. Ah, je les vois les jeunes mariés qu’on conduit devant l’autel : j’ai l’impression de contempler une couple de bœufs que l’on conduit à l’abattoir ! Pauvres enfants ! On va leur faire promettre une fidélité qui borne la plus capricieuse des jouissances à un même individu, leur faire promettre de tuer leur désir en l’étranglant dans les chaînes de la fidélité !
MME DIDEROT. Je ne t’écoute plus.
DIDEROT. Ah, les promesses de l’amour ! Je le revois, le premier serment que se firent deux êtres de chair, devant un torrent qui s’écoule, sous un ciel qui change, au bas d’une roche qui tombe en poudre, au pied d’un arbre qui se gerce, sur une pierre qui s’émousse. Tous passait en eux et autour d’eux et ils se faisaient des promesses éternelles, ils croyaient leurs cœurs affranchis des vicissitudes. Ô enfants, toujours enfants…
MME DIDEROT. Que c’est laid ce que tu dis !
DIDEROT. Les désirs me traversent, les femmes me croisent, je ne suis qu’un carrefour de forces qui me dépassent et qui me constituent.
MME DIDEROT. De bien belles phrases pour dire que tu es un cochon !
DIDEROT. Je suis ce que je suis. Pas autre. Tout ce qui est ne peut être ni contre nature, ni hors nature.
MME DIDEROT. On te traite partout de libertin.
DIDEROT. Le libertinage est la faculté de dissocier le sexe et l’amour, le couple et l’accouplement, bref, le libertinage relève simplement du sens de la nuance et de l’exactitude.
MME DIDEROT. Tu n’as pas de morale !
DIDEROT. Mais si ! Seulement, je tiens que la morale n’est rien d’autre que l’art d’être heureux. Tiens, regarde, c’est d’ailleurs ce que j’étais en train d’écrire pour l’article « Morale » de l’Encyclopédie : « Chacun cherche son bonheur. Il n’y a qu’une seule passion, celle d’être heureux ; il n’y a qu’un devoir, celui d’être heureux. La morale est la science qui fait découler les devoirs et les lois justes de l’idée du vrai bonheur. »
MME DIDEROT. Oui, mais enfin, monsieur le penseur, ce qui te rend heureux ne me rend pas toujours heureuse, moi !
DIDEROT. Comment peux-tu croire que le même bonheur est fait pour tous ! « La plus plupart des traités de morale ne sont d’ailleurs que l’histoire du bonheur de ceux qui les ont écrits. »
_______________________________
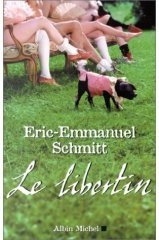 Ce délicieux dialogue est issu d’une pièce de théâtre d’Eric Emmanuel Schmitt : « Le libertin ». Je l’ai lue, que dis-je lue, je l’ai dévorée en quelques heures avec une délectation telle que je n’ai pas pu résister au plaisir de vous en faire partager quelques extraits. Car l’auteur a eu le génie d’aborder la problématique philosophique du libertinage avec la légèreté supposée caractériser cette « pratique », et de synthétiser dans un même ouvrage la philosophie et la sensualité qui la fondent : Les mot et la chose enfin réconciliés dans le fond et sur la forme…
Ce délicieux dialogue est issu d’une pièce de théâtre d’Eric Emmanuel Schmitt : « Le libertin ». Je l’ai lue, que dis-je lue, je l’ai dévorée en quelques heures avec une délectation telle que je n’ai pas pu résister au plaisir de vous en faire partager quelques extraits. Car l’auteur a eu le génie d’aborder la problématique philosophique du libertinage avec la légèreté supposée caractériser cette « pratique », et de synthétiser dans un même ouvrage la philosophie et la sensualité qui la fondent : Les mot et la chose enfin réconciliés dans le fond et sur la forme…
Je n’en dirai pas plus sur ce livre pour l’instant, mais j’aimerais réfléchir avec vous sur le thème de ce dialogue de la scène 8 entre le philosophe et sa femme : Le bonheur peut-il être au détriment d’autrui ? Est-ce une problématique exclusivement personnelle comme semble l’affirmer Françoise Simpère dans son excellente note intitulée « Y A PAS QUE NICOLAS ET CECILIA » ?
10:40 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : Le libertin, Eric Emmanuel Schmitt, mariage, libertinage, Livres, Diderot, Adultère
27 septembre 2007
Une gourmandise
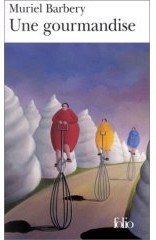 Un homme se tient par le ventre et le bas ventre. [Proverbe ivoirien]
Un homme se tient par le ventre et le bas ventre. [Proverbe ivoirien]
Si j’ai évoqué le pouvoir du plaisir dans une de mes anciennes notes et notamment le pouvoir du plaisir sexuel - le pouvoir du bas ventre - je ne me suis jamais étendu sur les plaisirs du ventre. Il faut dire que dans mes textes, il est plus question de chair que de bonne chair : lorsque j’ouvre la bouche pour savourer l’onctuosité de chairs humides, c’est rarement pour gober une huître ; lorsque la paume de ma main flatte une chaude rotondité, ce n’est pas souvent celle d’une miche de pain ; lorsque je plonge un appendice dans un calice parfumé, ce n’est généralement pas mon nez. Alors si je vous dis que j’ai découvert un roman dont la sensualité m’a mis l’eau à la bouche, dont les mots m’ont plongé dans une joie jubilatoire, sans doute penserez-vous que j’ai découvert une fine fleur de l’érotisme. Il n’en est rien. Une gourmandise de Muriel Barbery est à l’encyclopédie de cuisine ce que le cantique des cantiques est à la Bible : une subtile prose dont la poésie enchante l’âme jusqu’aux muqueuses.
Lire Une gourmandise, c’est goûter la saveur des mots : « Les mots : écrins qui recueillent une réalité esseulée et la métamorphosent en un moment d’anthologie, magiciens qui changent la face de la réalité en l’embellissant du droit de devenir mémorable, rangée dans la bibliothèque des souvenirs. Toute vie ne l’est que par l’osmose du mot et du fait où le premier enrobe le second de son habit de parade. »
Lire Une gourmandise, c’est déguster les mots de la saveur, ou plutôt les mots des saveurs, car les aliments les plus simples passés au crible de sa plume fantastique ne sont pas froidement disséqués, mais ils sont révélés toute leur puissance évocatrice.
Une pâtisserie marocaine après les boulettes de viande ? « Elles ne sont appréciables dans toute leur subtilité que lorsque nous ne les mangeons pas pour apaiser la faim et que cette orgie de douceur sucrée ne comble pas un besoin primaire mais nappe notre palais de la bienveillance du monde. »
Une tomate dans un verger ? « La tomate crue, dévorée dans le jardin sitôt récoltée, c’est la corne d’abondance des sensations simples, une cascade qui essaime dans la bouche et en réunit tous les plaisirs. La résistance de la peau tendue, juste un peu, juste assez, le fondant des tissus, de cette liqueur pépineuse qui s’écoule au coin des lèvres et qu’on essuie sans crainte d’en tacher ses doigts, cette petite boule charnue qui déverse en nous des torrents de nature : voilà la tomate, voilà l’aventure. »
Le poisson cru dans un restaurant japonais ? « Le vrai sashimi ne se croque pas plus qu’il ne fond sur la langue. Il invite à une mastication lente et souple, qui n’a pas pour fin de faire changer l’aliment de nature mais seulement d’en savourer l’aérienne moellesse. Oui, la moellesse : ni mollesse ni moelleux ; le sashimi, poussière de velours aux confins de la soie, emporte un peu des deux et, dans l’alchimie extraordinaire de son essence vaporeuse, conserve une identité laiteuse que les nuages n’ont pas. »
Lire Une gourmandise, c’est retrouver des accents de Delerm, mais les plaisirs de Barbery n’ont pas pour vocation de rester minuscules, ils gonflent, ils enflent, ils explosent de lyrisme, et ils nous emportent comme la toute première gorgée de whisky : « Telle une marquise éthérée, je trempai précautionneusement mes lèvres dans le magma tourbeux et… ô violence de l’effet ! C’est une déflagration de piment et d’éléments déchaînés qui détonne soudain dans la bouche ; les organes n’existent plus, il n’y a plus ni palais, ni joues, ni muqueuses : juste la sensation ravageuse qu’une guerre tellurique se déroule en nous-mêmes. »
Mais je me relis et je réalise qu’emporté par les saveurs et les mots, j’ai oublié de mentionner l’intrigue. Tant pis, j’ai déjà épuisé mon « crédit mot ». Sachez seulement que c’est amusant et drôlement bien mené. Je voudrais juste abuser de votre patience d’ami lecteur pressé pour en venir enfin au fait : Un homme se tient aussi par le ventre. Cela est admirablement développé par Barbery lorsqu’un des protagonistes, un jeune critique gastronomique interrogé le maître au sujet d’un sorbet (« le sorbet est aérien, presque immatériel, il mousse juste un peu au contact de notre chaleur puis, vaincu, pressé, liquéfié, s’évapore dans la gorge et ne laisse à la langue que la réminiscence charmante du fruit et de l’eau qui ont coulé par là ») le qualifie de sorbet de grand-mère. Dans sa bouche et aux oreilles du maître, c’est le plus beau des qualificatifs, et le voilà à parler de la cuisine de grand-mère…
Je crois qu’elles avaient conscience, sans même se le dire, d’accomplir une tâche noble en laquelle elles pouvaient exceller et qui n’était qu’en apparence subalterne, matérielle ou bassement utilitaire. Elles savaient bien, par-delà toutes les humiliations subies, non en leur nom propre mais en raison de leur condition de femmes, que lorsque les hommes rentraient et s’asseyaient, leur règne à elle pouvait commencer. Et il ne s’agissait pas de mainmise sur « l’économie domestique » où, souveraines à leur tour, elles se seraient vengées du pouvoir que les hommes avaient à « l’extérieur ». Bien au-delà de cela, elles savaient qu’elles réalisaient des prouesses qui allaient directement au cœur et au corps des hommes et leur conféraient aux yeux de ceux-ci plus de grandeur qu’elles mêmes n’en accordaient aux intrigues du pouvoir et de l’argent ou aux arguments de la force sociale. Elles les tenaient, leurs hommes, non pas par les cordons de l’administration domestique, par les enfants, la respectabilité ou même le lit – mais par les papilles, et cela aussi sûrement que si elles les avaient mis en cage et qu’ils s’y fussent précipités d’eux-mêmes.[…]
Que ressentaient-ils, ces hommes imbus d’eux-mêmes, ces « chefs » de famille, dressés depuis l’aurore, dans une société patriarcale, à devenir les maîtres, lorsqu’ils portaient à leur bouche la première bouchée des mets simples et extraordinaires que leurs femmes avaient préparés dans leurs laboratoires privés ? Que ressent un homme dont la langue jusqu’alors saturée d’épices, de sauce, de viande, de crème, de sel, se rafraîchit subitement au contact d’une longue avalanche de glace et de fruit, juste un peu rustique, juste un peu grumeleuse, afin que l’éphémère le soit un peu moins, retardé par la déliquescence plus lente des petits glaçons fruités qui se disloquent doucement… Ces hommes ressentaient le paradis, tout simplement, et même s’ils ne pouvaient se l’avouer, ils savaient bien qu’eux-mêmes ne pouvaient le donner ainsi à leurs femmes, parce que avec tout leur empire et toute leur arrogance, ils ne pouvaient les faire se pâmer comme elles les faisaient jouir en bouche !
07:35 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : Une gourmandise, Livres, Muriel Barbery, Littérature
19 septembre 2007
Le jeu
 Il faut atteindre les dernières pages de Hors jeu, le premier roman de Bertrand Guillot alias SecondFlore, pour comprendre véritablement son sujet : Le Jeu. C’était pourtant dans le titre, me direz-vous judicieusement, mais il m’aura fallu du temps pour comprendre combien ce titre a été bien choisi. Car Hors jeu a pour ambition de traiter du jeu sous tous ses aspects : de la cruauté du jeu de la drague à la vacuité du jeu social, de l’aliénation du jeu vidéo à la folie du jeu de casino, en passant par le jeu télévisé qui en synthétise toutes les tares, omniprésent sur nos écrans et dans ce roman où il nous apparaît plus que jamais comme la caricature grossière des jeux sociaux insidieux. Bien des auteurs ont traité divers aspects du jeu, Dostoïevski avec Le joueur bien sûr, mais aussi Houellebecq, Beigbeder, Kundera, et on les perçoit entre les lignes de Hors jeu, que ce soit pour le fond ou sous la forme. Dans l’ombre de ces monuments contemporains, traiter un sujet aussi vaste est probablement une gageure.
Il faut atteindre les dernières pages de Hors jeu, le premier roman de Bertrand Guillot alias SecondFlore, pour comprendre véritablement son sujet : Le Jeu. C’était pourtant dans le titre, me direz-vous judicieusement, mais il m’aura fallu du temps pour comprendre combien ce titre a été bien choisi. Car Hors jeu a pour ambition de traiter du jeu sous tous ses aspects : de la cruauté du jeu de la drague à la vacuité du jeu social, de l’aliénation du jeu vidéo à la folie du jeu de casino, en passant par le jeu télévisé qui en synthétise toutes les tares, omniprésent sur nos écrans et dans ce roman où il nous apparaît plus que jamais comme la caricature grossière des jeux sociaux insidieux. Bien des auteurs ont traité divers aspects du jeu, Dostoïevski avec Le joueur bien sûr, mais aussi Houellebecq, Beigbeder, Kundera, et on les perçoit entre les lignes de Hors jeu, que ce soit pour le fond ou sous la forme. Dans l’ombre de ces monuments contemporains, traiter un sujet aussi vaste est probablement une gageure.
Bertrand s’en sort bien avec un roman accrocheur, au style résolument moderne qui nous entraîne dans les tribulations de Jean-Victor Assalti, héros creux dont le vernis craquelle au point que sa vaniteuse puérilité finit par nous être sympathique. Tombé au chômage après une ascension aussi fulgurante qu’éphémère, il cherche à rebondir dans un jeu télé dont il veut rafler le gros lot avec panache. Il me semble que le tournant du roman se situe à la fin de la troisième partie - lorsque Jean-Victor retrouve une des candidates du jeu - au cours d’un paragraphe que je vous livre in extenso :
Prenant mon courage à une main, ma rose dans l’autre, j’ai avancé. Doucement. En passant, j’ai repéré une table où deux filles lookées Vogue buvaient de grands verres de vin blanc. « Même sur Meetic je ne suis tombée que sur des caves », disait Marie-Claire à Isa.
J’ai tout juste eu le temps de cacher la fleur sous la chaise. Emma a posé son livre, relevé la tête, m’a vu. Sourire d’ange.
- Bonjour !
- Et dire que j’ai cru ne jamais revoir ce sourire…
- On trouve toujours quand on sait chercher, Monsieur le Conseiller…
Ai-je rêvé ou elle avait rapproché sa main sur la table ? J’ai préféré parler de son livre.
- Risibles amours, donc. Tu aimes ?
- Oui. C’est un recueil de nouvelles. Je viens d’en finir une qui m’a fait penser à toi.
- Ah, oui ?
- C’est l’histoire d’un jeune couple. Le Jeu de l’auto-stop. Elle est timide et jalouse, lui est amoureux mais maladroit. L’his…
- Pardon, mais… Tu es timide, toi ?
- Idiot ! Donc l’histoire commence dans la voiture : ils partent en vacances. Ils parlent des auto-stoppeuses frivoles qui courent les routes tchèques, la fille imagine toutes les aventures qu’il a pu avoir, loin d’elle, dans sa voiture. Quand il s’arrête dans une station-service pour faire le plein, elle s’en va toute seule, à pied. Il la retrouve un peu plus loin, pouce levé comme une auto-stoppeuse. Il s’arrête à sa hauteur, la laisse monter…
- Un apéritif peut-être ?
La serveuse était arrivée à notre table, discrète comme une coupure publicitaire. Emma a fini son verre, m’a interrogé du regard.
- Bien sûr, j’ai dit. Tu reprends la même chose ?
- Ah non ! Varions les plaisirs.
Elle a tenté un merlot chilien, le moins cher de la carte, j’ai commencé par un bourgueil. La serveuse m’a demandé si nous voulions des grands verres. Bien sûr, j’ai répondu, et discrètement je lui ai demandé en bonus une chope de bière remplie d’eau.
- Les voilà sur la route, donc…
- Oui. Mais la situation a complètement changé. Un jeu s’est instauré : ils jouent a être deux inconnus qui vont finir la nuit ensemble. Libérée de sa timidité, elle joue la fille facile et y prend goût, elle le provoque et ça l’excite.
- Et alors ?
- Alors, le jeu les dépasse tous les deux. Prisonniers de leur scénario, ils ne peuvent pas éviter l’escalade. Quand ils arrivent à l’hôtel, il finit par la traiter de pute, littéralement je veux dire, il lui fait l’amour comme une brute, elle veut sortir du jeu mais n’y arrive pas, et elle finit par jouir comme jamais, mais en pleurant.
- Et elle le quitte ?
- On ne sait pas. Le garçon essaie de la consoler, sans succès. Tout ce que nous dit Kundera, c’est qu’il leur reste treize jours de vacances. J’aime quand les histoires n’ont pas de fin…
Son émotion était visible. Elle venait de loin, bien plus loin que nous deux. Je me suis retourné pour voir où en étaient nos apéritifs.
- Et quel rapport avec moi ? j’ai demandé.
- Le jeu !
 Risibles amours est, à mon avis aussi, le meilleur livre de Kundera. Loin d’être une œuvre de jeunesse immature, chacune de ses nouvelles préfigure les romans de sa postérité. Ainsi Le jeu de l’auto-stop est une merveille d’engrenage psychologique initié par les règles d’un jeu imbécile qui mène un jeune couple au désastre en révélant la part d’ombre de chacun, la part de l’autre. Le jeu agit comme un révélateur de l’âme en bâillonnant la raison avec ses règles ad-hoc:
Risibles amours est, à mon avis aussi, le meilleur livre de Kundera. Loin d’être une œuvre de jeunesse immature, chacune de ses nouvelles préfigure les romans de sa postérité. Ainsi Le jeu de l’auto-stop est une merveille d’engrenage psychologique initié par les règles d’un jeu imbécile qui mène un jeune couple au désastre en révélant la part d’ombre de chacun, la part de l’autre. Le jeu agit comme un révélateur de l’âme en bâillonnant la raison avec ses règles ad-hoc:
Et il ne servait à rien d’appeler au secours la raison et d’avertir l’âme étourdie d’avoir à garder ses distances et de ne pas prendre le jeu au sérieux. Justement parce que c’était un jeu, l’âme n’avait pas peur, ne se défendait pas et s’abandonnait au jeu comme à une drogue […] dans le jeu, on n’est pas libre, pour le joueur le jeu est un piège.
J’ai plus d’une fois pu constater combien cette phrase est vraie et comment le jeu pouvait exercer son emprise jusqu'à déborder ses protagonistes, comme ce fut le cas ici.
En conclusion, ne choisissez pas un de ces deux livres : ouvrez les deux comme les paupières sur la mécanique des jeux qui nous submergent.
10:00 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Livres, Agrafe, Hors jeu, Bertrand Guillot, Kundera, Risibles amours, Le jeu de l'auto-stop
31 mai 2007
Quand je faisais du X (2)
B*** fût satisfait de ma première histoire malgré son second degré humoristique, et il me proposa de me les payer quelques euros chacune, par chèque bancaire lorsque j’atteindrai le solde de 50 euros. Cela ne m’arrangeait pas trop. D’une part parce que je serais obligé de lui révéler ma véritable identité et d’autre part j’ai beau avoir de l’imagination, je ne voyais pas comment expliquer à mon épouse l’encaissement de chèques bancaires sur notre compte commun. Il m’envoya en même temps une nouvelle série de photos où deux femmes s’enfilaient des godes. J’ai rapidement torché une petite histoire intitulée « La démonstration » - qui fût publiée sous le titre grotesque de « Une démonstration godesque » - dont voici une version avec quelques coquilles en moins et la concordance des temps en plus :
Cela faisait une heure que je cherchais en vain un bon plan de razzia, lorsque je suis tombé par hasard sur un de mes vieux carnets d'adresse. Je l'ai ouvert machinalement, j'ai égrené quelques prénoms oubliés avant de tomber sur celui que je cherchais inconsciemment. Mina ! Ce nom a aussitôt exhumé quelques vieux souvenirs, si doux que j'en ai eu la larme à l'œil et l’érection violente. Mina ! Il fallait absolument que je la contacte pour avoir de ses nouvelles après... après... si longtemps !
Par une chance inouïe, elle répondait toujours à son ancien numéro : « Allô, Mina ? C'est chris, le photographe, tu sais celui qui t'avait pris en stop sur la côte il y a euh... quelques années.
- Je ne me souviens pas...
- Moi je reconnais ta voix Mina, et ton délicieux accent slave. Tu travailles toujours dans le prêt à porter ?
- Ah non, moi ça serait plutôt le prêt à enfiler. Ecoutez, vous avez une voix sympathique, alors je vous propose de me rafraîchir la mémoire. Venez avec votre appareil photo, je présente ma nouvelle collection à une très bonne cliente, vos photos seront les bienvenues. »Et me voici lancé sur mon scooter, espérant arriver à temps pour pouvoir voler quelques photos d'essayage, bien que je n'avais jamais entendu parler de « prêt à enfiler » Enfin, Mina était si imaginative qu'elle pouvait bien avoir inventé une nouvelle mode probablement aussi déshabillée que la jeune fille de mes souvenirs, du moins l'espérais-je. J’ai donc monté quatre à quatre les escaliers qui m’ont mené jusqu'à chez elle et j’ai frappé haletant à sa porte. Elle s'est ouverte toute seule, alors j’ai pénétré dans un appartement aux allures orientales, et j’ai entendu des gloussements provenant de la chambre à coucher.
« Entre Chris, Entre ! Et prépare ton matériel, je viens de commencer la démonstration ». J’ai du saisir le chambranle de la porte pour ne pas vaciller sous l'effet de la surprise. Mina, entièrement nue, caressait sa cliente avec lubricité tout en lui enfilant un gode en caoutchouc et aluminium dans la chatte. C'est en voyant tous les godemichés, vibromasseurs, boules de geisha et autres gadgets que j’ai compri le sens de "prêt à enfiler". Mina n'avait pas changé. Rousse, le visage allongé, un nez un peu long, elle avait toujours une ligne impeccable et cette lueur taquine dans les yeux. Quant à la cliente, jolie petite blonde aux yeux bleus, elle ne cachait pas son émerveillement face aux gadgets de Mina qui en faisait l'article : « Voyez-vous Mlle Lesly, vous permettez que je vous appelle Lesly ?
- Ouiiiiiiiiii allez-y....
- Ce vibromasseur glisse très bien dans votre intimité, on dirait qu'il a été fait pour vous.
- Aaaaaaaaah en effet
- Ni trop étroit, ni trop large, on peut l'enfoncer à fond pour un maximum de sensations vaginales
- Ooooooooh je le sens ouiiiiii, mais est-ce qu'il prend bien le clitoooooo...
- Oui, car le gland en aluminium vibre sur la verge en caoutchouc, voyez-vous...
- Arrrrrgh comme ça c'est si bon...
- Mais pour obtenir un effet maximum, je vous conseille d'en prendre deux, un devant, un derrière. Laissez vous faire.
- Oh ! Allez-y doucement, dans l'anus, je n'ai pas l'habitude. Hummmmmm...
- Alors qu'en pensez-vous, cela vous plait il ?
- Oooaaaoooaoaoaoao... »J'ai eu bien du mal à déballer mon appareil face à ce spectacle délirant. Jamais je n'avais imaginé pareil essayage, et cela dépassait de très loin mes espérances. Mon minolta a crépité sur la blonde en plein orgasme qui se faisait bourrer par tous les trous, avant que Mina retire les godemichés de ses orifices dilatés. Elle a ajouté, en me faisant un clin d'œil : « Et vous avez remarqué, chère mademoiselle, la fine texture de ces phallus encore plus vrais que nature ». Mlle Lesly m'a alors adressé un sourire carnassier. « Je ne demande qu’à voir », a-t-elle répondu. À vrai dire, je ne demandais pas mieux non plus.
C'est avec le plus grand plaisir que j'ai payé de ma personne ces 23 photos, où Mina et Lesly font une démonstration qui ne vous laissera pas de bois.
B*** en fût moyennement satisfait, ce qui ne l’empêcha pas de m’envoyer deux nouvelles séries de clichés. À la différence des gentillettes photos pornographiques précédentes, ces dernières photos me posèrent un cas de conscience : Non pas qu’elles étaient particulièrement osées, mais elles semblaient manifestement volées. Cela cadrait certes bien avec le thème de site voyeur, mais je n’eu pas envie de participer à ce qui pouvait être une basse vengeance envers des jeunes femmes véritablement innocentes. Ainsi, décidai-je d’arrêter là ma brève collaboration avec paparazzix.
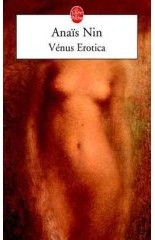 Depuis quelques jours, j’ai commencé la lecture de Vénus Erotica d’Anaïs Nin. Le contexte dans lequel ont été écrites ces nouvelles est en fin de compte assez voisin de celui de ma collaboration avec paparazzix : rémunérée 1 dollar la page d’érotisme par un mystérieux collectionneur, elle dût se concentrer sur l’aspect sexuel de ses nouvelles et y gommer toute poésie afin de satisfaire les désirs pornographiques du collectionneur, ce qui lui avait causé une certaine frustration. Mais lorsqu’elle s’est replongée dans ces textes quelques années plus tard, elle y retrouva son style - pour ainsi dire son âme - entre les lignes de "lubricité" imposée, et elle décida de les publier. De la même manière, Ysé a perçu l’humour et le second degré dont je n’avais pu me départir en écrivant ces deux pauvres récits. N’est pas John Flaherty Cox qui veut !
Depuis quelques jours, j’ai commencé la lecture de Vénus Erotica d’Anaïs Nin. Le contexte dans lequel ont été écrites ces nouvelles est en fin de compte assez voisin de celui de ma collaboration avec paparazzix : rémunérée 1 dollar la page d’érotisme par un mystérieux collectionneur, elle dût se concentrer sur l’aspect sexuel de ses nouvelles et y gommer toute poésie afin de satisfaire les désirs pornographiques du collectionneur, ce qui lui avait causé une certaine frustration. Mais lorsqu’elle s’est replongée dans ces textes quelques années plus tard, elle y retrouva son style - pour ainsi dire son âme - entre les lignes de "lubricité" imposée, et elle décida de les publier. De la même manière, Ysé a perçu l’humour et le second degré dont je n’avais pu me départir en écrivant ces deux pauvres récits. N’est pas John Flaherty Cox qui veut !
07:30 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : Quand je faisais du X, Erotisme, Expériences, Livres, Nin, Vénus Erotica, paparazzix
17 mai 2007
La première gorgée…
 Il faut commencer par La première gorgée de bière. Dans son fameux recueil de nouvelles où il exalte les plaisirs minuscules, Philippe Delerm poursuit: « C’est la seule qui compte. Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu’un empâtement tiédasse, une abondance gâcheuse. La dernière, peut-être, retrouve avec la désillusion de finir un semblant de pouvoir… ». Cette phrase caractérise bien l’œuvre de Delerm placée sous le signe de la parcimonie. Chez lui, le bonheur se cache dans les infimes détails du quotidien qu’il glorifie d’une poésie prosaïque. Delerm encense l’humilité jusqu’à l’ostentatoire. De son regard contemplatif sur son microcosme, Delerm n’évoque pas les trépidances qui secouent le monde en dehors de la sphère de son jardin provincial, mais éclaire le quotidien avec la tendresse bienveillante d’une mamie sirupeuse.
Il faut commencer par La première gorgée de bière. Dans son fameux recueil de nouvelles où il exalte les plaisirs minuscules, Philippe Delerm poursuit: « C’est la seule qui compte. Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu’un empâtement tiédasse, une abondance gâcheuse. La dernière, peut-être, retrouve avec la désillusion de finir un semblant de pouvoir… ». Cette phrase caractérise bien l’œuvre de Delerm placée sous le signe de la parcimonie. Chez lui, le bonheur se cache dans les infimes détails du quotidien qu’il glorifie d’une poésie prosaïque. Delerm encense l’humilité jusqu’à l’ostentatoire. De son regard contemplatif sur son microcosme, Delerm n’évoque pas les trépidances qui secouent le monde en dehors de la sphère de son jardin provincial, mais éclaire le quotidien avec la tendresse bienveillante d’une mamie sirupeuse.
Avec la banana-split au comble de ses excès, inutile de dire que qu’il ne faut pas chercher des délires sexuels chez Delerm. À peine évoquée dans le bonheur avec une petite fable sur les souris anglaises, il faut bien ma perversité pour deviner du sexe entre les lignes de ce recueil : « Une pression du pouce sur la fente de la gousse et elle s’ouvre, docile, offerte. Quelques-unes, moins mûres, sont plus réticentes – une incision de l’ongle de l’index permet alors de déchirer le vert, et de sentir la mouillure et la chair dense, juste sous la peau faussement parcheminée. Après, on fait glisser les boules d’un seul doigt. La dernière est si minuscule. Parfois, on a envie de la croquer […] C’est facile d’écosser les petits pois. »
Avec La première gorgée de sperme, Fellacia Dessert joue le contre-pied. Sous ce pseudonyme facétieux, un écrivain célèbre à la plume acérée à écrit un hilarant pastiche dont on appréciera pleinement la malice en alternant sa lecture avec le recueil de Delerm. La succession des titres croisés est éloquente :
- Le paquet de gâteau du dimanche matin
- Les gâteries du dimanche matin
- Aider à écosser les petits pois
- Aider à exaucer ses petites ouailles
- Apprendre une nouvelle en voiture
- En prendre une nouvelle en voiture
- L’odeur des pommes
- L’odeur des hommes
- On pourrait presque manger dehors
- Pour un peu, on baiserait sur la terrasse
etc…
Un meilleur exemple valant mieux qu’un long discours, voici un extrait d’un texte de Delerm intitulé « Le croissant du trottoir »:
« On s’est réveillé le premier. Avec une prudence de guetteur indien on s’est habillé, faufilé de pièces en pièce. On a ouvert et refermé la porte d’entrée avec une méticulosité d’horloger. Voilà. On est dehors, dans le bleu du matin ourlé de rose : un mariage de mauvais goût s’il n’y avait pas le froid pour tout purifier. […] Il faut ce qu’il faut de buée sur la vitre quand on s’approche, et l’enjouement de ce bonjour que la boulangère réserve aux seuls premiers clients – complicité de l’aube.[…] On le sent bien : La marche du retour ne sera pas la même. Le trottoir est moins libre, un peu embourgeoisé par cette baguette coincée sous un coude, par ce paquet de croissants tenu de l’autre main. Mais on prend un croissant dans le sac. La pâte est tiède, presque molle. Cette petite gourmandise dans le froid, tout en marchant : c’est comme si le matin d’hiver se faisait croissant de l’intérieur, comme si l’on devenait soi-même four, maison, refuge. On avance plus doucement, tout imprégné de blond pour traverser le bleu, le gris, le rose qui s’éteint. Le jour commence, et le meilleur est déjà pris. »
Avec Fellacia Dessert, cela devient « le travelo du trottoir » :
« On a attendu que l’autre s’endorme. En silence on s’est alors levé, on s’est rhabillé, on a traversé l’appartement et on est descendu, sans claquer la porte. Ce ne sera pas long.
Dehors, on est cueilli par le froid, mais on a le sang si chaud qu’on le sent à peine. Pourvu qu’elle soit là. On marche jusqu’au bout du trottoir, le cœur battant, la main dans la poche serrée sur les billets.
Elle est là, juste derrière le mur. En guêpière, bas, talons vertigineux. Plus belle que n’importe quelle vraie femme. Plus belle que celle qui dort, là-haut. Les billets changent de main, les corps s’enfoncent sous la porte cochère. La nuit commence à peine, et le meilleur reste à prendre. »
Mais sous l’apparente plaisanterie se cache l’affrontement de deux visions du monde résumé par les deux dernières phrases de ces extraits, aussi symétriques qu’opposées. Delerm, c’est l’adulte mélancolique, le regret de l’enfance : le meilleur est déjà pris. Il ne reste donc plus qu’à poursuivre mollement sa vie adulte au risque de ne pas l’investir pleinement. Pour le jouisseur au ça bouillonnant, gorgé d’énergie libidinale, excessif par nature, le meilleur reste à prendre, à investir, à conquérir. On ne s’y trompe pas lorsque Fellacia Dessert crache son venin dans « La première gorgée de sperme », véritable pamphlet hédoniste qui oppose ses excès au pusillanime Delerm :
« Un faire-part de décès leur tiendrait lieu de carte de visite. En deuil des jours anciens, de ce qui aurait pu être et même de ce qui sera, en deuil d’eux-mêmes et de leur propre vie, ils poussent en pleurnichant leurs chants aussi exaltants que ceux des messes du dimanche matin.
Ah, vieille et douce France, tout embaumée dans ses plaisirs de retraités ! France des petites joies sans joie, de la délectation morose et du repli sur soi ! Fière France craintive ! Continuons à t’exalter, France routinière, nostalgique, passéiste ! Encore un peu, et tes adeptes des plaisirs minuscules te laisseront glisser vers l’ordre des bons vieux temps, vieux et increvables règnes des pleutres et des conformistes ! Temps du renoncement, et donc de toutes les compromissions ! Continuons à t’exalter, France immobile, débile, ringarde, impuissante, vieille, hypocrite, dégueulasse ! Qui cache sa bêtise crasse et son aigreur sous une modestie de petite-bourgeoise toute boursouflée de vanités ! »
Je ne sais pas ce que vous en pensez, ami lecteur, mais pour moi, ça sent le règlement de comptes !
07:55 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : Agrafe, Livres, Delerm, fellacia Dessert, La première gorgée de bière, La première gorgée de sperme, Littérature
07 mai 2007
Style blog
 Microfictions de Thierry Jauffret a peut-être été encensé par la presse mais moi, je n’ai pas pu le terminer. Ce n’est pas à cause de son épaisseur même s’il fait tout de même plus de 1000 pages, ni de son style à la fois percutant et recherché mais qui reste bien loin des arcanes grammaticales Proustiennes, ni même de sa forme narrative originale, non, ce que je n’ai pas supporté, c’est le fond.
Microfictions de Thierry Jauffret a peut-être été encensé par la presse mais moi, je n’ai pas pu le terminer. Ce n’est pas à cause de son épaisseur même s’il fait tout de même plus de 1000 pages, ni de son style à la fois percutant et recherché mais qui reste bien loin des arcanes grammaticales Proustiennes, ni même de sa forme narrative originale, non, ce que je n’ai pas supporté, c’est le fond.
Microfictions n’est pas un roman puisqu’il n’y pas d’unité de lieu ni d’action, mais un recueil de courtes nouvelles qui pourraient avoir été autant de notes d’un blog exclusivement dédié au cynisme le plus désabusé. Chacune de ces 500 nouvelles classées par ordre alphabétique fait exactement deux pages et elles partagent toutes une identique inhumanité. Jauffret jette un regard bienveillant sur les atrocités du monde, au travers des yeux du protagoniste principal de chacune de ses histoires sordides racontées à la première personne, que ce soit le point de vue de la victime ou celui du bourreau. Ce parti pris récurrent de l’immoralité, non pas au sens pudibond du 19ème siècle mais au sens humaniste actuel, devient rapidement si nauséeux que la lecture de chaque nouvelle nécessite un véritable effort de volonté. Pour illustrer ma pensée, voici la première page de ce livre, c'est-à-dire la moitié de la nouvelle intitulée Albert Londres assez représentative des autres:
Nous avons filmé ces scènes de torture et de meurtre afin d’en dénoncer le caractère intolérable et la barbarie. Vous ne pouvez pas reprocher à une chaîne d’information de montrer la réalité. S’il est bien évident que nous blâmons leur conduite, nous devons aussi rendre hommage à ces tortionnaires de nous avoir permis d’apprécier à sa juste valeur le prix du bien être de la vie. Il est vrai que nous nous sommes rapprochés d’eux peu à peu.
- Ils sont devenus pour ainsi dire des relations de travail.
Et en définitive nous avons noué avec certains des liens d’amitié. Ils nous ont aidé dans notre tâche, évitant par exemple de faire exploser les otages, ce qui se serait traduit à l’image par une épaisse fumée monochrome peu propice à l’accroissement de l’audimat.
- L’exécution des enfants apitoyait les classes supérieures comme les plus mal lotis.
Nous allions jusqu’à drainer plusieurs millions de téléspectateurs en plein milieu de la nuit . Mais ces pratiques déplaisaient aux annonceurs, qui redoutaient notamment une atteinte à l’image de marque de leurs produits pour bébés.
- Nous leur avons donc demandé de les épargner.
Nombre de gamins nous doivent la vie, même s’ils restent toujours détenus dans des caves et des carrières désaffectées dont par déontologie nous refuserons toujours de révéler l’emplacement aux services de police […]
À propos de police, j’ai été faire un tour à la Fnac pour changer d’air et devinez sur qui je suis tombé : Bénédicte en tête de gondole ! Du coup, je l’ai prise sur place, enfin, j’ai pris son bouquin et aussi un génialissime Kundera que je n’avais pas encore lu mais c’est une autre histoire. Comment ? Vous ne connaissez pas Bénédicte, ami lecteur ? Ben moi non plus à vrai dire. Lib m’en avait parlé, j’avais été voir son blog démantelé par nécessité commerciale, et les quelques notes survivantes m’avaient bien plu. Police, le blog d’un flic, n’est donc plus un blog mais un site web promotionnel du premier roman de Bénédicte Desforges, FLIC, dont la forme est similaire à Microfictions : Une succession de nouvelles brèves dont chacune raconte une anecdote issue du quotidien d’un policier, à la première personne du singulier dans un style simple et percutant. Et dans l’horreur, cette réalité là dépasse largement la fiction.
Toute la différence se situe dans le regard de Desforges: le parti pris du narrateur protagoniste est résolument humain. Il ne s’agit pas là d’humanisme institutionnel, ni d’une profusion de bons sentiments, mais de véritable compassion. Et cette compassion passe aussi par le jugement, par le choix du bien contre le mal avec son lot d’arbitraire:
J’ai menotté des gens qui avaient battu, volé ou tué, j’ai menotté des toxicos en manque qui avaient tout cassé dans leur propre maison, pour ne pas qu’ils finissent par se faire mal, j’ai menotté des cambrioleurs en flagrant délit en train de dépouiller plus pauvres qu’eux, j’ai menotté des gens violents pour qu’ils me foutent la paix et pour ne pas m’en prendre une, j’ai menotté un père qui avait violé sa fille, et un collègue a menotté la mère qui ne voulait pas qu’on menotte le père pour « ça », j’ai menotté des gens qui avaient comme seul tort d’être là au mauvais moment, j’ai menotté par erreur, j’ai menotté des vrais cons et des braves cons, j’ai menotté vraiment plein de gens.
Ses récits embrassent toute la palette des couleurs de la vie, du rire aux larmes, loin de l’uniforme gris sinistre de Microfictions. Résultat, j’ai dévoré FLIC en deux jours avec un vif plaisir. Je ne résisterai donc pas a celui de recopier l’hilarante anecdote du jeune policier enthousiaste :
Il était parti passer le week-end chez sa grand-mère, fier de pouvoir exhiber son enthousiasme et son matériel rutilant tout juste sorti de l’emballage. D’un air malin, il avait sorti les menottes de sa poche. « Mémé, je vais te montrer comment ça marche… ». Il l’a menottée, et en même temps qu’il serrait les bracelets sur les poignets de l’ancêtre, il s’est rappelé que la clef était restée dans son placard.[...]
J’espère qu’on ne me passera pas les menottes pour cette petite entorse aux droits d’auteur…
07:00 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : Agrafe, Livres, Microfictions, FLIC, Jauffret, Desforges, Littérature
27 avril 2007
L'insoutenable légèreté de l'être (2)

"D'un côté, il y a les maisons et, derrière les grandes fenêtres du rez-de-chaussée qui ressemblent à des vitrines de magasin, on aperçoit les minuscules chambrettes des putains. Elles sont en sous-vêtements, assises contre la vitre, dans de petits fauteuils agrémentés d'oreillers. Elles ont l'air de gros matous qui s'ennuient. L'autre côté de la rue est occupé par une gigantesque église gothique du XIVe siècle.
Entre le monde des putes et le monde de Dieu, comme un fleuve séparant deux royaumes s'étend une âcre odeur d'urine."
J'étais au beau milieu de "L'insoutenable légèreté de l'être" de Kundera et je n'ai donc pas résisté au plaisir de recopier ce passage du roman pour vous décrire la vieille église calviniste, vierge de toute sculpture, dont je sortais. Comme toute église gothique, elle abritait à l'origine une orgie de décorations fastueuses, dont de nombreuses représentations du Christ, des saints, voire même des ecclésiastiques à la droite de Dieu au jour du jugement dernier - les prêtres avaient su appliquer le vieil adage: on n'est jamais aussi bien servi que par soi même. Le calvinisme, fidèle aux injonctions bibliques interdisant toute représentation divine, avait extirpé tout ce décorum de l'église, de sorte qu'elle n'était plus qu'un bâtiment pour abriter les fidèles qui ne risquaient plus d'adorer des idoles de pierre comme des fétichistes africains animistes. Face à ce monument de morale austère s'alignait la luxure drapée de pourpre lupanar, et mes pas me conduisirent presque malgré moi vers les vitrines obscènes. Des femmes y exhibaient des charmes usés, comme les pieds d'une vierge idolâtrée par de fervents catholiques. Il y en avait de toutes les couleurs, de toutes les tailles, plus ou moins jeunes, plus ou moins blondes, toutes désabusées. Certaines hissaient un rictus sur leurs lèvres alors que je jetais sur elles des regards équivoques. Derrière tous les simagrées commerciaux qu'elles m'adressaient, derrière leur maquillage qui craquelait déjà, je voyais apparaître leurs défauts distinctifs, leurs manies particulières, leur humanité sordide.
- L'unicité du "moi" se cache justement dans ce que l'être humain a d'inimaginable.
C'est ce qu'écrit Kundera, mais moi, je n'avais rien à faire de leur humanité misérable. Je ne voulais pas être désagréanblement surpris. Si je venais à pousser une de ces portes, je savais que leur masque dégoulinerait comme du mascara même si je n'imaginais pas exactement comment viendrait la désillusion. Je n'éprouverais plus alors que du dégoût pour ce qui était censé être des parangons de féminité, et qui n'en était que la mascarade. La féminité, la vraie, était ailleurs. C'est pourtant dans cette rue que je me suis arrêté. Non, c'est dans cette rue que je suis tombé en arrêt comme d'autres tombent amoureux. Derrière la vitrine embuée, elles ne semblaient attendrent que moi. Était-ce leur troublante gémellité, était-ce le reflet des spots de la vitrine sur leur peau tabac, satinée, d'une incroyable finesse, toujours est-il qu'après tant de laideur, elles m'ont immédiatement sauté aux yeux. Alors je me suis arrêté là, scotché à la vitrine, à les contempler sans bouger. Quelle ligne ! Quel affolant amalgame de galbes et de finesse, d'arrêtes émouvantes, de surplombs troublants !
- Depuis, elle sait que la beauté est un monde trahi. On ne peut la rencontrer que lorsque ses persécuteurs l'ont oubliée par erreur quelque part.
Oui, l'héroïne de Kundera avait raison, la beauté avait été oubliée là, et moi avec. Je les imaginais toutes les deux dans un autre contexte, avec des robes de soirée échancrées, des bas de soie délicats, dans l'intimité de ma chambre d'hôtel. Elles étaient si parfaites que tous les autres accessoires ne pourraient que les mettre en valeur. Et cette perfection là, ostensible jusqu'à l'ostentatoire, ne laissait rien au hasard. Je savais qu'elles seraient souples, maniables, malléables même, et que je pourrais en faire ce que bon me semblerait. C'était elles mon idéal féminin, elles deux identiquement parfaites, elles qui me permettaient d'envisager les plus folles combinaisons. Et plus je laissais vagabonder mon imagination, plus je sentais mon désir monter, irrépressible. J'imaginais déjà leur odeur, alors que je les disposerai sur le lit de ma chambre d'hôtel, leur douceur soyeuse sous mes doigts fiévreux, mon érection vibrante déjà. Je leur ouvrirai mon lit, je les glisserai l'une contre l'autre, je les regarderai dans toutes les positions, des plus naturelles aux plus perverses, dos à dos, face à face, sans dessus dessous, le talon de l'une dans la tige de l'autre. Je ne tiendrai pas bien longtemps, je ne résisterai au plaisir de sortir ma queue, ma verge rutilante d'excitation, de faire glisser mon gland sur elles, par-devant, par derrière. Et puis me déshabiller complètement, me rouler avec elles dans les draps parmi les robes et les bas, et finir par les prendre tour à tour, m'immiscer à l'intérieur de chacune d'entre elles, et jouir, jouir, jusqu'à les remplir de foutre toutes les deux. D'habitude, une seule me suffit, mais là, je savais qu'il me faudrait la paire. J'ai poussé la porte de la boutique et je suis entré.
- Et pour monsieur, qu'est-ce que ce sera ?
- Cette paire d'escarpins en vitrine s'il vous plait. En 36, je les préfère étroites.
07:55 Publié dans Fictions | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : Livres, fétichisme, Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être, Littérature
25 avril 2007
L'insoutenable légèreté de l'être (1)

Les hommes qui poursuivent une multitude de femmes peuvent aisément se répartir en deux catégories. Les uns cherchent chez toutes les femmes leur propre rêve, leur identité subjective de la femme. Les autres sont mus par le désir de s'emparer de l'infinie diversité du monde féminin objectif.
L'obsession des premiers est une obsession romantique: ce qu'ils cherchent chez les femmes, c'est eux-mêmes, c'est leur idéal, et ils sont toujours et continuellement déçus parce que l'idéal, comme nous le savons, c'est ce qu'il n'est jamais possible de trouver. Comme la déception qui les pousse de femmes en femmes donne à leur inconstance une sorte d'excuse mélodramatique, bien des dames sentimentales trouvent émouvante leur opiniâtre polygamie.
L'autre obsession est une obsession libertine, et les femmes n'y voient rien d'émouvant: du fait que l'homme ne projette pas sur les femmes un idéal subjectif, tout l'intéresse et rien ne peut le décevoir. Et précisément cette inaptitude à la déception a en soi quelque chose de scandaleux. Aux yeux du monde, l'obsession du baiseur libertin est sans rémission (parce qu'elle n'est pas rachetée par la déception).
07:55 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (24) | Tags : Livres, Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être, Littérature
09 avril 2007
Déclaration de guerre
Attention. Ce texte décrit une scène particulièrement violente et cette note risque de heurter votre sensibilité.
 « Tout commence par une déclaration de guerre : Je t’aime – et le reste en découle comme par une loi de chute des anges. Je t’aime. Tu es ce qui éveille en moi le sentiment d’amour, puisque tu peux l’éveiller c’est que tu peux le combler, puisque tu peux le combler c’est que tu dois le combler, tu es le complément en moi du verbe aimer, le complément d’objet direct de moi, j’aime qui, j’aime toi, tu es le complément de tout, le masque d’or du père ou de la mère, l’ombre nourricière penchée sur moi petit, tout petit qui crie sa faim, hurle sa misère, son droit sur terre, son droit souverain sur l’univers et donc sur toi, d’abord sur toi. »
« Tout commence par une déclaration de guerre : Je t’aime – et le reste en découle comme par une loi de chute des anges. Je t’aime. Tu es ce qui éveille en moi le sentiment d’amour, puisque tu peux l’éveiller c’est que tu peux le combler, puisque tu peux le combler c’est que tu dois le combler, tu es le complément en moi du verbe aimer, le complément d’objet direct de moi, j’aime qui, j’aime toi, tu es le complément de tout, le masque d’or du père ou de la mère, l’ombre nourricière penchée sur moi petit, tout petit qui crie sa faim, hurle sa misère, son droit sur terre, son droit souverain sur l’univers et donc sur toi, d’abord sur toi. »
Il lut ces mots d’une main tremblante. Ils n’étaient certes pas d'elle mais de Christian Bobin, un auteur qu’elle avait dû trouver à sa hauteur, lui qui l'impressionnait tant. Alors elle les lui avait recopiés sur un papier quadrillé, d’une calligraphie ronde et incertaine qui en ajoutait encore à l’émotion du texte, et qui faisait que ces mots là, c’était un peu les siens. Après tout, ne les avait-elle pas choisis avec amour - même s’il aurait sans doute préféré une déclaration moins fusionnelle ? Et puis elle lui donnait rendez-vous, une fois de plus, derrière l’église d'un village voisin, le soir même, à neuf heures. Il plia la feuille de papier, la porta à son nez, crut sentir le parfum de la belle malgré l’odeur âcre de l’eau de javel qui baignait l'hôpital. Il glissa ce mot sous sa blouse, entre sa peau noire et le coton blanc, juste là, dans l’espace ténu des désirs illicites. Il imagina que ce soir elle se donnerait à lui. Ils devraient se cacher. Il dut chasser à regret cette idée pour se concentrer sur le prochain patient.
Elle porta une petite robe de fête pour se rendre au rendez-vous, heureuse et la peur au ventre. Elle descendit les rues du village, s’efforçant d’ignorer les rideaux qu’on entrebâillait sur son passage, juste assez pour laisser passer des regards angoissés ou visqueux de haine, abîmes de vies désespérées. Elle redressa pourtant la tête, moins par fierté que pour se concentrer sur l’horizon, sur le soleil couchant qui enflammait sa Provence natale de rouge et de noir. Pour ne penser qu’à lui. Il faisait presque nuit lorsqu’elle arriva au lieu du rendez-vous. Ils n’auraient pas beaucoup de temps.
D’abord, elle ne le trouva pas. Et puis elle entendit du bruit, son nom murmuré, « Marie… Marie… » il s’était caché dans les fourrés. Elle s’y glissa en frissonnant, et il l’accueillit dans ses bras grands ouverts. Dans la pénombre, elle ne distinguait pas ses traits, elle n’entendait que sa voix, chaude et grave, sa voix si mâle et si aimante, sa voix qui l’envoûtait, et qui lui dit :
« Celle qu’on aime, on la voit s’avancer toute nue. Elle est dans une robe claire, semblable à celles qui fleurissaient autrefois le dimanche sous le porche des églises, sur le parquet des bals. Et pourtant elle est nue – comme une étoile au point du jour. À vous voir, une clairière s’ouvrait dans mes yeux. À voir cette robe blanche, toute blanche comme du ciel bleu.
Avec le regard simple, revient la force pure. »
Elle reconnut immédiatement le texte qui était sur la couverture de son livre de chevet, une petite robe de fête. Elle le lui avait prêté, non sans fierté. Pour elle, pour une petite caissière sans avenir, il les avait appris par cœur, lui, le médecin étranger. Il lui rendait un peu de sa culture - sa culture à elle, elle qui n'en avait jamais eue - qu’il embrassait malgré tout, malgré toutes les différences. Elle sentit les larmes couler sur ses joues pales. Il ne pouvait pas les voir, mais il en goutta la saveur salée lorsqu’il posa ses lèvres sur sa peau. Alors elle oublia tout. Elle s’abandonna à la chaleur de ses baisers, à la force de son étreinte, à la brûlure de ce corps chaud qui l’embrasait, elle oublia le danger et même le couvre feu. Comme pour être plus près de lui, elle ferma les yeux, pour mieux rejoindre son âme, l’essence de son odeur vanillée, avant de caresser sa peau nue pour la première fois. Leur peau que tout séparait.
Elle fit courir ses doigts blancs sur les épaules musclées de son amant, et puis sur sa nuque, et dans ses cheveux crépus, guidant son souffle ardent vers une gorge offerte. Son visage ouvrit la robe blanche comme un brise-glace déchire la banquise, dans le fracas des passions libérées et du mot d'amour froissé. Ses mains puissantes étreignirent ses seins alors qu’elle ouvrait les cuisses aux lèvres affamées, pour qu’elles la dévorent. La petite culotte arrachée, il embrassa éperdument la vulve offerte, se rassasia de la liqueur que son calice lui offrait, célébrant ainsi la messe de leur amour interdit. Elle ne parvint plus à étouffer ses râles de plaisir, et elle s’en mord encore les lèvres.
A peine savourait-elle sa jouissance qu’un rire gras la fit sursauter. On lui arracha son aimé. Lorsqu’elle sortit des fourrés, la gifle qui l’accueillit fût si forte qu’elle en tomba par terre. Lorsqu’elle leva les yeux sur son amour, il était écartelé par deux miliciens, alors qu’un troisième s’acharnait sur lui à coups de batte de base ball. Son visage n’était plus qu’une plaie. « Regardez-moi cette putain à négros, elle a même pas de culotte ! » Elle n’entendait pas les insultes, seulement les coups qui pleuvaient sur lui. Ils s’arrêtèrent un instant pour reprendre leur souffle et s’occuper d’elle. Ils la traînèrent aux pieds de son aimé et ils baissèrent son pantalon. « Montre-nous comment tu suces les blackos, salope ! » Ils la forcèrent à le prendre dans sa bouche. Il était presque évanoui. « Alors le bamboula, tu bandes mou ? » Ils éclatèrent de rire et ponctuèrent leur plaisanterie d’un mauvais coup de masse. Elle entendit un craquement sinistre. Elle en hurla. « Pleure pas ma jolie, nous on en a une bien dure ». Elle perdit connaissance lorsqu’ils lui enfoncèrent dans le ventre la batte de base-ball ensanglantée.
Lorsqu’elle revint à elle, elle était toute seule derrière l’église. Elle ramassa ses affaires. Sa petite robe de fête était déchirée, maculée de sang et de haine. Elle savait qu’elle ne le reverrait plus jamais, alors, lorsqu’elle retrouva par terre la feuille de papier quadrillée, elle crut y sentir l'odeur de son amant malgré l’odeur âcre du sang qui la tachait. Elle glissa le papier sur sa peau nue, tout contre son cœur. Certains racontent qu’il y est encore.
Cela s’est passé en Provence, en 2010. Ce ne fut jamais relaté par la presse de l’époque. Il faut dire qu’il y avait trois ans qu'un fascisme inavoué avait subtilisé la démocratie. On était en pleine guerre civile implicitement déclarée. Tout commence par une déclaration de guerre : Je t’aime.
07:45 Publié dans Fictions | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : racisme, Livres, Bobin, Littérature
26 mars 2007
Mon Delerm
Nous marchions dans une rue fatiguée du 18ème arrondissement, Mathilde et moi, une rue entre deux âges en manque de ravalement. Nous y marchions d'un pas alerte à la découverte d'être deux, d'être heureux à dénicher du voluptueux dans une petite librairie blasée. Nous avons fini par la trouver, cette librairie érotique étroite et courte, qui fleurait bon le papier jauni à l'encre indécente. Tous les bouquins s'y accouplaient dans un joyeux désordre, ils s'empilaient sans complexe, s'exhibaient toutes pages dehors: Pauline Réage turlupinait Apollinaire, Esparbec culbutait Verlaine, Milo Manara fessait françoise Rey, et Anaïs Nin cheikh Nefzaoui. Derrière sa caisse présidait le tenancier aux yeux usés. Il les connaissait tous, ses pensionnaires, des plus prudes aux plus lestes, et il ne se résignait à les laisser partir qu'après leur avoir caressé la tranche comme la croupe d'une pouliche. Mais du théâtre érotique du 19ème, non, vraiment, personne ne lui avait jamais demandé un truc pareil. Alors, pour Mathilde, j'ai pris un Gavalda en édition original: je l'aimais.
Nous sommes sortis bras-dessus bras-dessous, juste heureux même si le temps passe, et mes yeux se sont accrochés en haut d'une affiche: DELERM.
- Tiens, il chante maintenant, que je dis à Mathilde ?
- Qui ça, qu'elle me fait ?
- Mais Delerm, là bas !
- Mais oui, Vincent Delerm est un chanteur !
- Ah bon, je le connaissais écrivain.
- Mais l'écrivain, c'est le père: Philippe Delerm.
- Ah d'accord, je ne connaissais que lui, l'écrivain, mon Delerm.
Nous sommes passés devant un sex-shop à l'entrée béante, rouge sang, immense comme une bouche d'ogresse. J'ai poussé Mathilde à l'intérieur et la bête nous a avalés. Mathilde n'était pas fière. C'était sa première visite dans l'antre de la luxure commerciale. Nous ne nous sommes pas attardés sur les DVD et les godemichés, pour dévaler le boyau des escaliers qui menait au rayon lingerie. Nous avons choisi 3 ensembles, dont un bustier bleu-gris digne d'une chanteuse de cabaret dans le saloon d'un western spaghetti. Il me plaisait bien. Nous nous sommes engouffrés dans la cabine en espérant que la vendeuse ne vienne pas vérifier de trop près la nature de l'essayage. J'ai déshabillé Mathilde tout en commentant la lingerie alibi. Elle les a toutes essayées entre deux baisers, et lorsque j'ai mordillé ses fesses, Mathilde a gémi avant de me supplier d'arrêter. Finalement, on n'a rien pris.
Quand la bête nous a régurgités sur le trottoir, j'étais heureux comme un chenapan après un coup pendable. Il est comme ça, mon bonheur, fugace et dérisoire comme une fleur des champs arrachée aux herbes folles, dans l'instant de la vague au désir qui monte jusqu'au fracas du plaisir. Il ne s'inscrit pas dans le temps, dans la durée pérenne, dans la cuisine de mon Delerm. Chez Delerm, le bonheur est mélancolique, et se savoure simplement à l'horizon calme du présent au passé. Loin de ma fureur, Delerm écrit le bonheur, le bonheur quotidien d'un Sisyphe rêveur:
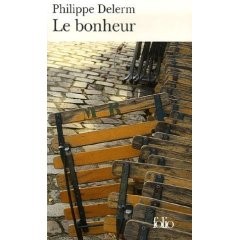 Prendre un grand cahier à carreaux d'écolier. Laisser tomber des mots qui rendent plus léger. Tout dire ligne à ligne, avec de l'encre bleu marine, de la souffrance et du bonheur...
Prendre un grand cahier à carreaux d'écolier. Laisser tomber des mots qui rendent plus léger. Tout dire ligne à ligne, avec de l'encre bleu marine, de la souffrance et du bonheur...
Que les mots viennent, trempés d'encre. À Chaponval, on remplissait de poudre et d'eau la bouteille mince au bec verseur. Mon père présidait à cette alchimie rituelle du savoir. Et puis un élève avait la mission délicate de verser la poudre diluée dans les encriers ronds d'un blanc épais, crémeux, si lisse sous le doigt qui en dessine le contour.
Que les mots viennent, et griffent le papier. Je n'ai plus la plume Sergent-major qui râpe un peu le long des pleins, des déliés. Je n'ai plus de lignes et de marges, de lettres à répéter en ronde sous le calcul mental. Mon stylo glisse sans effort sur la page banquise où rien ne le commande, ne l'arrête. Mais les mots griffent quelque part, s'accrochent à la violence du passé, commandent dans l'absence un travail rude d'écolier. J'inventerai les pleins, les déliés, le rêve dans la marge et le bonheur de l'interligne. Avec des mots de poudre et d'eau je plongerai dans le silence qui fait un peu mal, dans le silence fort de mes mélancolies d'école; un soir, assis tout seul dans la classe des petits, à rêver d'Elle qui n'existe pas, à rêver seul des mots de pierre et d'eau, de poudre et de lumière. Je mènerai mon chemin d'écolier, au delà de la vitre, à l'encre fraîche, avec des mots qui me blessent de loin, retrouvent un peu trop fortes les odeurs, les tilleuls dans la cour, la poudre d'encre dans la classe.
J'écris, voilà ma pierre.
07:30 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : Livres, Delerm, Expériences, mathilde, Littérature
12 mars 2007
Éloge des femmes mûres
Je les entends d'ici, celles qui grincent des dents, et j'imagine aussi le sourire esquissé sur le visage de celles qui ne s'avouent par encore mûres, mais qui apprécient déjà que je prenne leur parti. Stop ! Au royaume des amantes, la guerre des générations n'aura pas lieu, tout au moins pas dans ma province: chaque âge a ses charmes que je déguste assidûment. Éloge des femmes mûres est le titre du best-seller de Stephen Vizinczey, que vous avez probablement déjà lu. Inutile de dire combien je l'ai apprécié, avoir recopié une substantielle partie de son second chapitre - intitulé De la guerre et de la prostitution - est plus éloquent que toutes mes éloges. Laissez-moi vous en brosser rapidement le contexte: Au cœur de la Hongrie déchirée par de la seconde guerre mondiale, Andras Vajda se retrouve livré à lui-même après de douloureuses pérégrinations, et il est recueilli affamé par une caserne américaine en mai 1945. Adopté par les soldats, il apprend alors assez d'anglais pour devenir médiateur et interprète entre les GIs et les réfugiées hongroises qui en sont à se prostituer pour des pommes de terre ou des boites de corned-beef. Andras n'a pas encore douze ans...
"Le premier enseignement que je tirai de cette audacieuse activité fut que tout le discours moralisateur sur le sexe n'avait absolument aucun fondement dans la réalité. Ce fut aussi une révélation pour toutes ces bonnes petites bourgeoises étonnées, respectables, parfois même assez snob, que j'allais chercher dans le camp hongrois surpeuplé et misérable pour les amener à la caserne. À la fin de la guerre, alors que les Autrichiens eux-mêmes étaient dans un besoin extrême, les centaines de milliers de réfugiés arrivaient à peine à subsister - et leur situation était d'autant plus pitoyable que la plupart d'entre eux étaient habitués au confort d'un mode de vie bourgeois. La fierté et la vertu, qui avaient tant d'importance pour ces femmes dans leur ancien cadre de vie, n'avait plus aucun sens dans le camp des réfugiés. Elles me demandaient - en rougissant mais souvent en présence de leur mari muet et de leurs enfants - si les soldats avaient des maladies vénériennes et ce qu'ils avaient à offrir.
Je me souviens avec émotion d'une dame belle et bien née qui prenait la chose avec une dignité extraordinaire. C'était une femme brune avec de gros seins palpitants et un visage osseux rayonnant d'orgueil - tout juste la quarantaine dirais-je. Son mari était comte, chef d'une des familles les plus anciennes et les plus distinguées de Hongrie. Son nom et son grade dans l'armée, fût elle l'armée défaite de l'amiral Horthy, avaient encore assez de poids pour leur assurer une baraque en bois à l'écart des autres réfugiés. Ils avaient une fille d'environ dix-huit ans qui avaient de longs cheveux et ricanait sottement chaque fois que je pénétrais chez eux pour m'acquitter de ces missions relativement peu fréquentes, La comtesse S. n'acceptait le marché qu'avec un officier, et seulement à condition d'être payée deux ou trois fois le tarif habituel. Le comte détournait toujours la tête quand il me voyait. Il portait encore le bas de son uniforme d'apparat - un pantalon noir avec un large galon doré sur le côté -, mais par-dessus, au lieu de la veste à épaulettes frangée d'or, il mettait un vieux pull-over dépenaillé. [...] Il répondait rarement à mes salutations, et son épouse m'accueillait toujours comme une surprise désagréable - on n'aurait jamais cru que c'était elle-même qui me demandait de la prévenir chaque fois que j'avais des demandes de la part d'officiers bien propres n'ayant pas trop d'exigences.
"Encore lui!" s'écriait-elle d'une voix chagrine et exaspérée. Puis elle se tournait vers son époux avec un geste tragique. "Avons-nous absolument besoin de quelque chose aujourd'hui? Ne puis-je pas, pour une fois, envoyer au diable ce gamin immoral ? Sommes-nous vraiment si totalement démunis ?" En principe, le général ne répondait pas, il se contentait de hausser les épaules d'un air indifférent; mais il lui arrivait tout de même de répliquer sèchement: "C'est vous qui faites la cuisine, vous devriez savoir ce dont nous avons besoin.
- Si vous étiez passé du côté des russes avec vos troupes, je j'en serais pas réduite à cette souillure, à ce péché mortel, pour que nous puissions manger !" S'écria-t-elle un jour dans un soudain accès d'hystérie.
Je ne fais que traduire leur dialogue, mais c'est bien en ces termes désuets de "souillure", de "péché mortel", et de "gamin immoral" (ce qui me plaisait bien) que s'exprimait la comtesse. Outre le vocabulaire, elle avait aussi le maintien d'une dame formidablement vertueuse, et je la plaignais presque, devinant combien elle avait dû se faire violence pour s'abaisser à se "souiller". Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de trouver qu'elle exagérait quelque peu son malheur, d'autant plus qu'elle rejouait si fidèlement la scène que je croyais entendre une actrice dans une pièce de théâtre. Le mari ne relevait jamais le défi rituel qu'elle lui lançait, mais, curieusement, la fille était toute prête à décharger sa mère et à assurer elle-même une part du sacrifice. "Mère, laissez-moi y aller - vous semblez bien lasse", disait-elle. Mais la comtesse ne voulait rien entendre.
"Plutôt mourir de faim!" déclarait-elle rageusement. "Plutôt te voir morte qu'en train de te vendre!" Et parfois, avec l'humour du désespoir, elle ajoutait: "Rien ne peut plus me corrompre, j'ai passé l'âge; ce que je fais n'a plus d'importance."
Nous attendions tous en silence tandis qu'elle se reprenait, se maquillait, et puis se levait en observant son époux, ou simplement en promenant son regard autour de leur petite pièce. "Priez pour moi en mon absence", disait-elle habituellement quand nous sortions, et je la suivais, presque persuadé qu'elle aurait volontiers accepté de mourir pour échapper au supplice qui l'attendait.
Pourtant, quand nous arrivions à la voiture, elle parvenait à sourire courageusement, et parfois, quand c'était un certain jeune capitaine qui l'attendait, elle riait joyeusement et sans contrainte pendant le trajet jusqu'au camp militaire. Mais quand soudain son visage s'assombrissait et devenait pensif, il me semblait que j'allais prendre feu rien qu'à être assis auprès d'elle. À ces moments là il était visible qu'elle avait une bouche très sensuelle. J'ai souvent observé de ces changements d'humeur chez les femmes que j'accompagnais à la caserne: elles quittaient leur famille en déesse de vertu partant pour le sacrifice, et puis, sans aucun doute, elles prenaient du bon temps avec les Américains, souvent plus jeunes et plus beaux que leur mari. Un bon nombre d'entre elles, je crois bien, n'étaient pas fâchées de pouvoir se considérer comme de nobles et généreuses épouses et mères prêtes à tous les sacrifices, alors qu'en fait il leur plaisait assez d'échapper un moment à l'ennui conjugal.[...]
Plusieurs jours s'écoulèrent avant que je ne recommence à cogiter sur le moyen de faire l'amour avec une des dames qui profitaient de mes services.
Mes pensées tournaient autour de la comtesse. Elle avait beau me traiter de "gamin immoral", elle ne pouvait, me semblait-il, que me préférer à ce lieutenant - un type du Sud avec de fausses dents - qu'elle allait voir quelques fois. Je ne pouvais pas espérer rivaliser avec le jeune et beau capitaine, mais je me disais qu'après une nuit avec le lieutenant j'avais peut-être mes chances. Un matin, le voyant partir en voiture, je restai à roder autour de ses quartiers jusqu'au lever de la dame. Quand j'entendis qu'elle faisait couler la douche, j'entrais tout doucement. Elle ne m'entendit pas. Entrouvrant discrètement la porte de la salle de bains, je la vis sous le jet, nue - À vous couper le souffle ! À la caserne, j'avais vu de nombreuses photos de pin up sur les murs, mais c'était la première fois que je voyais une femme nue en chair et en os. Non seulement c'était différent, c'était miraculeux."
 Seriez-vous frustré, ami lecteur ? Vous aimeriez donc connaître la suite de l'aventure du petit Andras auprès de la comtesse S., dont il est si plaisant d'imaginer le nom d'origine hongroise... Alors faîtes un geste pour la littérature ! Quitte à acheter un roman érotique dans une gare, ce best-seller disponible dans tous les relais H vaut mieux qu'un JFC, non ?
Seriez-vous frustré, ami lecteur ? Vous aimeriez donc connaître la suite de l'aventure du petit Andras auprès de la comtesse S., dont il est si plaisant d'imaginer le nom d'origine hongroise... Alors faîtes un geste pour la littérature ! Quitte à acheter un roman érotique dans une gare, ce best-seller disponible dans tous les relais H vaut mieux qu'un JFC, non ?
08:10 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : Livres, Vizinczey, Éloge des femmes mûres, Erotisme, prostitution, Littérature
21 février 2007
Étienne
"John Flaherty-Cox est l'auteur de trois romans érotiques publiés aux éditions Blanche", apprenons-nous dans la biographie de l'auteur, dont Diane qui avait fait l'objet d'une note sur NOLDA. "Traduite dans plusieurs langues, cette trilogie est résolument moderne. Elle s'intéresse aux multiples formes de sexualité d'aujourd'hui, notamment celle des couples libérés qui distinguent très bien les plaisirs du sexe et ceux du cœur.". J'ai donc lu Étienne, le second ouvrage de la trilogie centrée sur le couple que forment Étienne et Diane. Selon moi, la seule modernité de ce roman est celle de sa pornographie très contemporaine: indigence de l'intrigue ponctuée de scènes pornographiques explicites, pauvreté psychologique des personnages inversement proportionnelle à leur richesse matérielle, infaillibilité des protagonistes auxquels tout réussi, festival de poncifs ethniques... Cela confère à ce livre quelques avantages: on peut le lire d'une main en enfilant les chapitres dans le désordre sans perdre le fil de l'histoire.
Prenons-en donc un ensemble, au hasard, le chapitre 10 par exemple, mais en défilement rapide pour ne pas trop vous lasser:
- Etienne est invité à dîner chez Sophie et Alan. (p. 171)
- Leur appartement est somptueux. (p.171)
- Ils ont une jeune soubrette asiatique: Sue. (p.172)
- Sophie a la taille fine et les seins des gros. (p.172)
- Sophie exhibe son porte-jarretelles. (p.172)
- Etienne danse langoureusement avec Sophie. (p.173)
- Alan va chercher du cognac. (p.173)
- Sophie embrasse Etienne. (p.173)
- Sue déshabille et lèche Sophie, et puis Etienne. (p.174)
- Sophie, Etienne, Sue, Alan et le cognac vont dans la chambre. (p.174)
- Sophie suce Etienne dans un bassin saupoudré de pétales de rose au milieu de la chambre (p.175)
- Sue suce Alan dans le bassin. (p.175)
- Etienne et Alan jouissent tour à tour. (p.175) - Première éjaculation d'Etienne.
- Sue quitte temporairement la scène. (p. 176)
- Alan enlace Sophie qui se fait prendre par Etienne dans le lit. (p. 176)
- Etienne apprend à Alan et Sophie qu'il est lui aussi libertin. (p.176)
- Sue revient en nuisette noire. (p. 177)
- Etienne fouette Sophie. (p. 178)
- Etienne sodomise Sophie. (p. 179)
- Alan et Sophie quittent la scène. (p. 179)
- Sue suce Etienne. (p.179)
- L'auteur assène au lecteur le poncif de la jeune asiatique soumise et heureuse. (p. 179)
- Etienne éjacule au visage de Sue. (p. 180) - Seconde éjaculation d'Etienne
- Etienne sodomise Sue. (p. 181) - Troisième éjaculation d'Etienne
- Etienne sodomise encore Sue. (p. 182) - Quatrième éjaculation d'Etienne
- Sue quitte définitivement la scène. (p. 182)
- Sophie revient en nuisette noire, avec Alan. (p. 183)
- Alan et Etienne administrent une double pénétration à Sophie. (p. 183)
- Alan et Etienne prennent Sophie dans tous les sens toute la nuit. (p. 184) - Nième éjaculation d'Etienne ?
- Etienne s'en va au petit matin. (p. 185)
Raconté comme ça, ce n'est pas très excitant, et pourtant ça m'a fait bander. Un peu comme ces films pornos qui vous excitent malgré vous, parce qu'ils s'adressent à votre cerveau reptilien plus qu'à votre cortex.
J'ai acheté ce roman dans une gare. Je crois que je vais le ranger dans mes toilettes.
08:35 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (31) | Tags : Livres, Flaherty-Cox, Littérature
26 janvier 2007
La planète échangiste
 La libertine est l'otage du désir masculin et fait l'objet d'un troc qui ne dit pas son nom. Tel est le credo de "la planète échangiste" de Daniel Welzer-Lang, devenu depuis sa parution l'ouvrage de référence sur l'échangisme. Fort de ses quatre années d'enquête sur le terrain, DWL en est devenu le théoricien incontesté. Cette légitimité est-elle bien justifiée ? C'est pour tenter de répondre à cette question que j'ai ingurgité les 570 pages de cet ouvrage. Permettez-moi de régurgiter mon analyse.
La libertine est l'otage du désir masculin et fait l'objet d'un troc qui ne dit pas son nom. Tel est le credo de "la planète échangiste" de Daniel Welzer-Lang, devenu depuis sa parution l'ouvrage de référence sur l'échangisme. Fort de ses quatre années d'enquête sur le terrain, DWL en est devenu le théoricien incontesté. Cette légitimité est-elle bien justifiée ? C'est pour tenter de répondre à cette question que j'ai ingurgité les 570 pages de cet ouvrage. Permettez-moi de régurgiter mon analyse.
La couverture est sensationnaliste: "Ce livre est un événement. Pour la première fois, toute la lumière est faite sur la "planète" échangiste [...] L'immense enquête de terrain menée pendant quatre ans par Daniel Welzer-Lang [...] n'avait jamais été publiée.". L'introduction resitue le contexte. Dans les années 1995, DWL et son équipe ont enquêté sur l'échangisme avec pour louable objectif la prévention du SIDA. Son rapport de recherche qui s'est achevé en 1997 n'avait jamais quitté les rayons des bibliothèques universitaires. 8 ans plus tard, le voilà opportunément publié avec peu de remaniements, ce qui explique un chapitre obsolète consacré au minitel. Une étude qui date d'une décennie peut-elle être l'ouvrage de référence d'une pratique en pleine évolution ? La question mérite d'être posée d'autant plus que ce livre est pour le moins subjectif.
Ce rapport obéit à une hypothèse qui transparaît à toutes les pages, dès le début (p 13): "Les gens touchent, se touchent, font l'amour, échangent les partenaires féminines[...]" (p. 13). On comprend vite que selon DWL, l'échangisme consiste à échanger des femmes plus ou moins consentantes, plus ou moins contraintes, pour le bonheur de la libido masculine à l'image de la pornographie. Il faut cependant attendre le chapitre 6 (L'entrée dans l'échangisme) pour lire explicitement cette hypothèse: "Les pratiques non conformistes correspondent en premier lieu au désir des hommes de vivre des relations sexuelles avec plusieurs femmes de manière successive et/ou simultanée. L'échangisme est une forme contemporaine de polygamie masculine. (p. 153)" Le raisonnement historique qui permet d'aboutir à cette hypothèse n'est pas dénué d'intérêt. Je vous le livre donc in extenso (pp 154 & 155):
"De tous temps, les sociétés patriarcales et viriarcales ont appris à certains hommes un mode de gestion polygame du désir. Philippe Ariès écrit: "Aujourd'hui, nos réflexions escamotent souvent un phénomène, absolument capital et quasi permanent jusqu'au 18ème siècle [...] : La différence que les hommes d'à peu près toutes les sociétés et de tous les temps (sauf les nôtres aujourd'hui) ont observé entre l'amour dans le mariage et l'amour hors du mariage." Jean-Louis Flandrin rappelle, quant à lui, les débats en cours au Moyen age: malgré la doctrine officielle de l'église, il était considéré comme normal qu'un homme ait des amours hors mariage. Et des codes relativement précis réglaient la nature des rapports sexuels que l'homme devait entretenir avec son épouse et avec les autres femmes. On ne prend pas sa femme comme on prend sa maîtresse, telle semblait être la topique de l'époque. Les hommes partageaient leur vie sexuelle entre maîtresses, prostituées, amantes et épouses. Et des lieux spécifiques permettaient et/ou structuraient cette polygamie.
Jusqu'à une époque récente, les constructions sociales différenciées de l'amour et de la conjugalité organisaient les pratiques féminines et masculines. Quand les femmes, dans l'amour, cherchaient un "tout en un" où le même homme devait être à la fois bon père, mari attentionné et bon amant (pour celles qui avaient accès à leurs désirs sexuels), les hommes distinguaient l'amour dans la relation conjugale et l'amour dans les pratiques sexuelles. Il y avait les femmes qu'ils aimaient, qui élevaient leurs enfants, qui s'occupaient de leur foyer, et les femmes qu'ils aimaient et avec lesquelles ils pouvaient vivre leur sexualité. Pratiques et représentation de la sexualité des femmes étaient "sous contrôle" des hommes et l'objectif in fine était une maîtrise stricte de la reproduction : "deux hommes ne partagent pas le même vagin", explique Françoise Héritier.
Puis vint la contraception féminine hormonale, beaucoup plus fiable que les méthodes empiriques précédentes; vint aussi la possibilité légale d'avortement dans des conditions d'hygiène acceptables. Les femmes et leurs conjoints disposent alors de moyens efficaces pour contrôler la reproduction. Dès les années 1970, le féminisme promoteur de cette révolution scientifique, les mouvements gais et les groupes militants de toutes sortes font vaciller l'édifice des sexualités. Les certitudes s'effondrent, les conduites libertines, jusqu'alors réservées à quelques cabarets clos, se diffusent massivement. "Pourquoi pas" traduit parfaitement cette époque de remise en cause des modèles. Communisme sexuel dans certains groupes communautaires, relations extraconjugales ou multirelationnalité sérielle : les modèles sont divers, mais ils ont tous en commun de remettre en cause les valeurs traditionnelles liées au mariage, du moins de le revendiquer haut et fort.
Ce qui ne veut pas dire que les "nouvelles pratiques" conjugales ne soient pas, elles aussi, normatives. L'égalité est posée en absolu, voire, à cette époque, entre 1970 et 1985, en dogme arithmétique. L'époque impose sur le plan de la sexualité, du moins dans les discours des "spécialistes", des relations sexuelles qualifiées d'égalitaires entre hommes et femmes. L'orgasme de l'un doit répondre à l'orgasme de l'autre dans un ensemble parfait. Tout décalage, toute désynchronisation est suspectée de cacher des problèmes sexuels qu'il faut s'empresser de soigner. Les rapports à la séduction évoluent également. Un jeu doit s'établir entre les deux partenaires afin de permettre à chacun d'exprimer ses désirs : "Il est donc prescrit de produire des orgasmes, et, d'une façon générale, de "s'éclater", c'est à dire d'être des stakhanovistes de l'hédonisme. Mais attention! Sans goujaterie (apparente) ! Respectez vos partenaires ! Aidez les à fonctionner !" dit André Béjin. La réalité n'est pas aussi simple et nous avons montré comment certains client des prostitué-e-s semblent évacuer ce malaise dans leur rapport aux femmes pour obtenir des services sexuels auxquels ils ne peuvent accéder autrement.
Une de mes hypothèses centrales est que la fréquentation des clubs échangistes réfère à la même problématique. Nous serions en présence d'une gestion conjugale de la polygamie masculine des désirs, d'une forme moins arithmétique de partage."
DWL développe cette hypothèse au chapitre 7: "La femme qui opte de manière volontaire pour les pratiques non conformistes sait qu'elle entre en concurrence avec les autres femmes. Pour garder son conjoint, elle devra faire un travail incessant de séduction: de son conjoint et des autres hommes. Elle va apprendre comment les désirs pour elle réactivent ceux de son conjoint, fier d'avoir une telle monnaie d'échange. Elle a peur de découvrir un jour l'absence de désirs pour elle et ses conséquences néfastes sur ceux de son conjoint. La valeur d'échange est liée à leur capitale érotique. (p. 191)."
Après avoir introduit tous les termes du marché, DWL explicite le mode de séduction dans un chapitre au titre explicite: "De la putain à la salope...". DWL nous explique que le groupe des hommes a toujours établi une division entre les femmes: les "mamans" et les "putains", au point de parler de polygamie entre les unes et les autres. Or la figure de la salope aurait tendance à remplacer celle de la putain dans l'imaginaire érotique masculin. DWL définit la salope comme la femme non vénale qui aime le sexe dans des formes qu'aiment les homes, et qui porte des tenues sexy définies par la pornographie.
"Pour garder leur conjoint, lui plaire, les femmes [échangistes] doivent se comporter en salope [...] Dans notre étude, nous avons rencontré de nombreuses femmes qui disent aimer la fréquentation des lieux non conformistes. Ces femmes reprennent pour partie les stéréotypes de la salope, tout en revendiquant leur propre plaisir dans cette représentation de soi et ces pratiques. Mais très souvent elles n'en adoptent pas le nom, préférant nettement le terme de libertine (p. 197)".
Mesdames et mesdemoiselles les libertines, je suis navré de vous apprendre que DWL vous considère comme les héritières des péripatéticiennes, tout au moins dans l'imaginaire masculin. Force est de constater qu'il n'est malheureusement pas le seul lorsqu'on lit certains commentaires masculins sur les forums de discussion.
C'est à travers ce prisme que sont interprétées toutes les interviews citées dans ce livre. Le libre arbitre féminin proclamé par quelques libertines est relativisé, la domination masculine débusquée entre les mots. "La planète échangiste" donne donc une vision subjective du libertinage, comme l'avoue DWL lui-même dans son introduction "Le point de vue développé ici, le regard qui transparaît dans les mots utilisés, est mon point de vue, mon regard" (p. 10). Cette vision est aussi panoramique. Loin d'être centré sur les pratiques échangistes "classiques" des couples, DWL aborde le voyeurisme, l'urologie, la scatologie, le SM, ainsi que tous les acteurs, des couples aux hommes seuls en passant par les professionnels. On peut donc lire des choses étonnantes. Je suis ainsi très surpris d'apprendre que "La tendance en 2005 est d'ailleurs d'aménager des backs-rooms de rencontre dans les sex-shops." (p. 62), au point de douter de la qualité des personnes interviewées lorsque je lis "Partout, que ce soit en club d'échangistes ou en soirée SM, je n'ai jamais rencontré un autre Noir, jamais [interview d'une femme qui pratique essentiellement le SM]" (p. 132)
DWL avoue aussi volontiers sa difficulté d'appréhender les échangistes, et son livre manque cruellement d'analyses quantitatives. Ainsi, on ne saura pas combien de français pratiquent l'échangisme, et les seules statistiques sont établies à partir des petites annonces de swing! DWL en déduit probablement à juste titre une sur-représentation des hommes seuls (51 %), suivis des couples (39 %) et enfin des femmes seules (3 %), le reste pour les travestis, groupes constitués et autres transsexuels (p. 83).
Les analyses qualitatives de ces annonces sont en revanche nombreuses: "Non seulement, dans l'échangisme les hommes contrôlent le sens des échanges des partenaires, mais en plus ils imposent leurs symboliques érotiques pornographiques" (p. 92). En ce qui concerne l'omniprésence de la pornographie dans les annonces, on ne peut malheureusement pas lui donner tort.
Lire "La Planète échangiste" est probablement un excellent moyen de dégoutter les futurs libertins, avec ces descriptions caricaturales (la description d'une partouze sur la plage au cap d'agde - début du chapitre 17 - est un morceau d'anthologie) et ces commentaires orientés. J'ai certes déjà rencontré certains travers fustigés par l'auteur, mais sa vision détachée ne peut rendre compte des émotions vécues. Dans ce tableau désespérant, DWL semble tout de même esquisser l'amorce d'une féminisation de la sexualité collective, et par conséquent une renégociation d'un échangisme machiste au profit de valeurs plus féminines. J'ose croire que la vision du libertinage véhiculée par des forums tels que E&T, ne serait-ce que par un certain équilibre des populations masculines et féminines, s'inscrit dans ce renouveau.
08:40 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : Livres, échangisme, Welzer-Lang
21 janvier 2007
Libertinage et volage font-ils bon ménage ?
A la lecture des annonces de couples mariés qui ne veulent rencontrer que des couples mariés, et au vu des débats houleux entre couples libertins légitimes et singletons volages, ces deux volants du libertinage apparaissent bien incompatibles, et un couple exemplaire comme Georges & Madeleine semble être l'exception qui confirme la règle.
Je conçois le mépris que peut inspirer la personne volage au couple légitime qui a décidé de tout partager, jusqu’aux désirs que peuvent leur inspirer les autres, et les plaisirs charnels qu’ils peuvent en tirer: mépris pour l’infidélité du cœur (le couple libertin n’ayant renoncé qu’à la fidélité du corps), mépris pour la tromperie et pour les mensonges auxquels ils ont échappé, et peut être un peu de mépris pour l’échec matrimonial que la personne volage représente. Car un comportement volage est l’échec fondamental pour cette conception symbiotique du couple, où il est impensable qu’un de ses membres consomme sa liberté individuelle jusqu’au lit.
Face à ce fonctionnement apparemment aussi bien huilé qu’une morale judéo-chrétienne, le libertin individuel est cependant en droit de se poser quelques questions: la racine étymologique de « libertinage » n’est-elle pas « libertin », caractérisé par la liberté de corps et d’esprit ? Comment peut-on se proclamer libertin et dénier à son conjoint sa liberté individuelle de jouir de son propre corps comme il l’entend ? Le libertinage serait-il un échange de liberté stipulé par le contrat tacite: « Tu peux jouir d’un autre corps si je peux jouir d’un autre corps », et qui donne tout son sens au terme « échangisme », une sorte de liberté surveillée, voire une liberté sous caution lorsqu’elle est assortie d’interdits tels que la pénétration hors couple ?
 Selon Michel Onfray et sa définition du libertin dans sa « théorie du corps amoureux », un vrai libertin doit être célibataire. Cela ne signifie pas qu’il est condamné à papillonner de corps en corps sans échanger plus que quelques étreintes. Cela veut simplement dire que le libertin affranchit ses relations amoureuses du prosaïque quotidien, qu’il noue des liens tout en gardant ses distances vitales, qu’il ne sacrifie pas sa liberté sur l’autel d’une vie commune avec un tiers. La parabole du hérisson exprime bien l’épineux problème de la juste distance : Comment des hérissons peuvent être assez proches pour se réchauffer en hiver, sans pour autant se piquer.
Selon Michel Onfray et sa définition du libertin dans sa « théorie du corps amoureux », un vrai libertin doit être célibataire. Cela ne signifie pas qu’il est condamné à papillonner de corps en corps sans échanger plus que quelques étreintes. Cela veut simplement dire que le libertin affranchit ses relations amoureuses du prosaïque quotidien, qu’il noue des liens tout en gardant ses distances vitales, qu’il ne sacrifie pas sa liberté sur l’autel d’une vie commune avec un tiers. La parabole du hérisson exprime bien l’épineux problème de la juste distance : Comment des hérissons peuvent être assez proches pour se réchauffer en hiver, sans pour autant se piquer.
Il est amusant de constater que ces deux positions bien tranchées sont appelées à se confronter sur l’oreiller du fait d’un comportement sexuel partagé. Si vous êtes un couple libertin pur et dur, quel est votre degré de tolérance pour faire l’amour et pas la guerre ? Demandez-vous le statut matrimonial de l’éphèbe musculeux rencontré au détour d’un coin câlin ? Vous souciez-vous d’un éventuel conjoint abandonné lorsque vous jouissez enfin de la jolie jeune femme accueillie dans votre lit conjugal ? Vilipendez-vous systématiquement les couples illégitimes qui ont le malheur de s’intéresser au votre ?
09:15 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : Blogs, Livres, Onfray, libertinage







