02 novembre 2007
De la morale et de la liberté (2)
Attention. Cette note cite une scène particulièrement violente qui risque de heurter votre sensibilité.
 « L’ouvrage n’étant pas massicoté, il est préférable, pour l’ouvrir, d’user d’un instrument plutôt que de son doigt. » Vendu sous blister avec cet avertissement collé sur sa couverture, Un roman sentimental est une magnifique opération commerciale. Pensez donc : Alain Robbe-Grillet, académicien de 85 ans, laisse à la postérité un sulfureux roman érotique ! Erotique, vraiment ? Si aucun avatar mercantile n’est épargné au lecteur pour aiguillonner son excitation, qu’en reste-t-il après avoir eu le supposé plaisir de démassicoter ce livre ? Voici une des premières scènes qui compose ce fameux roman et qui vous permettra d’apprécier son style si délicat…
« L’ouvrage n’étant pas massicoté, il est préférable, pour l’ouvrir, d’user d’un instrument plutôt que de son doigt. » Vendu sous blister avec cet avertissement collé sur sa couverture, Un roman sentimental est une magnifique opération commerciale. Pensez donc : Alain Robbe-Grillet, académicien de 85 ans, laisse à la postérité un sulfureux roman érotique ! Erotique, vraiment ? Si aucun avatar mercantile n’est épargné au lecteur pour aiguillonner son excitation, qu’en reste-t-il après avoir eu le supposé plaisir de démassicoter ce livre ? Voici une des premières scènes qui compose ce fameux roman et qui vous permettra d’apprécier son style si délicat…
5
Vers le mur du fond, celui sur lequel mes yeux alanguis errent avec le plus de facilité, je distingue, en premier plan d’un dessin dont l’évidence se confirme rapidement, perspective forestière aux troncs verticaux et rectilignes, une sorte de bassin d’eau si claire qu’elle en devient presque immatérielle, élargissement oblong d’une source limpide, aussi profond qu’une baignoire ou même davantage, entre des roches grises aux formes arrondies, douces au toucher, accueillantes. Une jeune fille est assise là, sur la pierre polie par l’usure qui représente pour elle une banquette idéale au ras de l’eau, où ses longues jambes remuent avec abandon dans les remous aux reflets bleus de l’aimable nymphée, naturelle autant que pittoresque, dont la température doit être identique à celle de l’air ambiant, ainsi que des charmes féminins eux-mêmes qui ondulent, déjà liquides, au dessus du miroir mouvant aux frémissements imprévus.
.
C’est après que ça se gâte. Invité chez Taddeï le 24 Octobre dernier pour la présentation de son roman, Alain Robbe-Grillet nous apprend qu’il y raconte les pérégrinations sexuelles de petites filles supplicées à mort dans un français irréprochable, avec un luxe de détails Flaubertien mais aussi la distanciation nécessaire et assez d’invraisemblances pour créer une atmosphère onirique, fantasmagorique, théâtrale qui situerait son roman dans le cadre de la catharsis. Voici quelques extraits de cette interview :
FT : Pensez-vous qu’on était plus tolérant à l’époque [ en 1974 ]
ARG : Oui car de plus en plus on confond le fantasme et la réalisation du fantasme. Or c’est exactement le contraire. Quelqu’un qui écrit, en général, est quelqu’un qui se soigne lui-même, qui soigne sa perversion en l’écrivant.
FT : C’est l’impression que vous avez, vous ?
ARG : Je ne sais pas mais… j’ai Aristote avec moi pour défendre cette thèse, dite de la catharsis. Et néanmoins, il y a quand même à l’heure actuelle un envahissement par le bien pensé. C'est-à-dire que ce soit politiquement correct, sexuellement correct, littérairement correct, racialement correct, etc… Il semble maintenant que quand on écrit quelque chose d’incorrect, c’est comme si on le commettait. C’est une méconnaissance totale de ce que c’est que l’écriture.
[…]
FT: Là vous faites monter, monter les fantasmes, et à partir du moment où il y a des enfants ça devient très différent. Vous vous attendez à quoi ?
ARG : Comme on le disait tout à l’heure, ce sont des écrits intimes, que j’écrivais pour moi, et celui là qui est rédigé avec un très grand soin, qui est quand même fait selon le même souci de représenter ce que j’ai dans la tête, un souci autobiographique pour ainsi dire, et il est évident que depuis que j’ai douze ans, j’ai toujours aimé les petites filles, c'est-à-dire que je pense qu’il y a des quantités de gens qui sont dans la même situation. L’amour pour les jeunes, les petits garçons pour les homosexuels et les petites filles pour les hétéros, c’est quelque chose d’extrêmement répandu, mais qui se domine très facilement, qui ne se réalise pas quoi ! Mais le penser ne fait de mal à personne.
[Reportage présentant les associations de défense de l’enfance qui s’étaient insurgées lors de la parution du livre rose bonbon, parce qu’il véhiculait l’idée que les enfants victimes des crimes pédophiles sont consentants.]
ARG : Ces gens qui se plaignent sont des pervers, visiblement !
FT : Pourquoi ?
ARG : Ils ont lu ça, et ils ont tout de suite gommé le fait que c’est un écrit littéraire, et ils ont réalisé le fantasme eux même dans leur tête ! À ce moment là ils se sont gendarmés contre qui ? Contre eux même ! Ces gens devraient être tous en prison ! Parce que c’est eux qui ont effectué la réalisation dans leurs cerveaux malades !
[…]
ARG : Puisque je parlais d’Aristote tout à l’heure, il a bien précisé dans la poétique que l’effet de catharsis ne jouait que selon certaines règles de distanciation par rapport au sujet. C'est-à-dire que si le fantasme est raconté de façon trop… Il ne parlait pas de fantasmes sexuels, Aristote, mais si l’idée est racontée avec trop de passion sensuelle alors, à ce moment là, on risque de provoquer ce que qu’Aristote appelle la mimésis, c'est-à-dire que le lecteur a tendance à vouloir réaliser lui-même ce qu’il est en train de lire. Alors que au contraire, avec cet effet Brechtien de distanciation, c’est l’effet inverse : la catharsis, c'est-à-dire que le lecteur va être purgé de ses passions, grâce à mon livre !
Voici les passions en question…
229
Quant aux trois plus jeunes des petites filles, Crevette, Nuisette et Lorette, qui ont sept, huit et neuf ans, elles se sont beaucoup amusées pendant leur service. Ramenées à leur dortoir J1, elles en parlent ensemble avec émerveillement. On leur a permis de goûter à toutes les liqueurs qu’elles devaient servir à genoux. Elles ont sucé des messieurs vigoureux et de jeunes dames parfumées. On les a caressées, embrassées, léchées. On a bourré des crèmes excitantes dans leurs orifices trop enfantins, avant de les branler de façon très douce. Elles ont admiré une adolescente qui flambait comme une torche. Elles ont vu couler le sperme et le sang, mais aussi les pleurs des collégiennes que l’on torturait. Vers la fin de la nuit, elles sont descendues dans les caves pour assister au supplice d’une servante de treize ans (vendue par sa famille) qui s’était enivrée. Après l’avoir violée de toutes les façons, des messieurs ont procédé à son écartèlement sur une machine spéciale, pendant qu’ils lui enfonçaient des aiguilles à travers tout le corps, dont les quatre membres se sont désarticulés peu à peu. Pour finir, on lui a arraché complètement l’une des cuisses, en tirant la jambe par le pied, et on l’a laissée se tordre dans un flot de sang pour mourir comme ça sans secours. Oui, c’était vraiment formidable.
J’ai choisi cette scène parce qu’elle est assez représentative de l’ensemble de « l’ouvrage » et assez courte pour être citée. Je vous laisse imaginer les 200 scènes intermédiaires où Robbe-Grillet raconte avec bien plus de détails les démembrements dont il semble si friand. Vous trouvez ça érotique, vous ? Si la catharsis a pour objet de purger le lecteur de pulsions communes, voire même fondamentales dans la construction du psychisme de chacun mais néanmoins réprimées par la loi ou la morale, comme l’interdit de l’inceste mis en scène - et puni – dans Oedipe Roi de Sophocle , qu’en est-il des pulsions criminelles d’Alain Robbe-Grillet ? La majorité de l’humanité partage-t-elle, à l’instar de cet auteur, le fantasme de découper un nouveau né au hachoir sous les yeux de sa mère elle-même torturée à mort ? Qui pourrait donc avoir besoin de lire un tel livre – si tant est que la supposée catharsis soit plus efficace que celle mise en scène dans L’orange mécanique ? De surcroît, Sophocle ne décrit pas les égarements d’Oedipe dans ses détails charnels avec la complaisance de Robbe-Grillet à l’égard de ses bourreaux d’enfants. Chez Sophocle, la mise à distance n’est pas qu’une vague atmosphère onirique : c’est une véritable tragédie qui donne du sens à la pulsion libidinale, qui la « corticalise » en l’inscrivant dans un mythe fondateur.
En vérité, le supposé effet cathartique de Un roman sentimental n’est qu’un misérable cache misère philosophique pour permettre la publication d’abominations qui n’auraient jamais dû franchir les portes d'un cabinet psychiatrique. Il ne s’agit pas de l’éventuelle purge du lecteur mais de celle bien réelle de l’auteur. Que les boyaux de son cortex incontinent défèquent des fantasmes abjects sur un bout de papier, soit. Qu’il les dore au subjonctif, pourquoi pas : c’est bien la moindre des choses de la part d’un académicien. Mais qu’il nous les donne à lire donne envie de vomir. Robbe-Grillet est comme un vieillard sénile qui exhibe son pot de chambre après une nuit de fièvre diarrhéique.
Voilà sa place :

Mais ne tirons pas la chasse trop vite !
Primo, il ne faudrait pas jeter l’anathème contre toute sorte de libertinage comme le fait Thierry Giaccardi chez Stalker, et je ne m’associerai certainement pas à ceux qui militent pour le retour du puritanisme. Je regrette d’ailleurs que l’adjectif « libertin » soit associé aux noms de Sade et de Robbe-Grillet, et je ne suis pas le premier à le faire. En 1798, Restif de la Bretonne, libertin s’il en est, publia Anti-Justine avec pour préface : « Personne n'a été plus indigné que moi des sales ouvrages de l'infâme de Sade [….] Ce scélérat ne présente les délices de l'amour qu'accompagnées de tourments, de la mort même pour les femmes. Mon but est de faire un livre plus savoureux que les siens et que les épouses pourront faire lire à leurs maris, pour en être mieux servies ; un livre où les sens parleront au cœur ; où le libertinage n’ait rien de cruel pour le sexe des grâces, et lui rende plutôt la vie, que de lui causer la mort ; où l’amour ramené à la nature, exempt de scrupules et de préjugés, ne présente que des images riantes et voluptueuses. On adorera les femmes en le lisant ; on les chérira en les enconnant : mais l’on en abhorrera davantage le vivodisséqueur […] »
Secundo, Un roman sentimental a tout de même une vertu, celle de remettre la question de la morale sexuelle au goût du jour. Honnêtement, Robbe-Grillet n’a rien inventé comme le souligne Pierre Assouline : il n’a fait qu’écrire une nouvelle version de Justine, et il va moins loin que Pasolini et son insoutenable Salo , ou les 120 jours de Sodome qui avait osé mettre en images de semblables abominations – avec au moins l’intention (ou le faux prétexte ?) de les dénoncer en les attribuant au fascisme. C’est sans doute au niveau de l’image que devrait se situer aujourd’hui le débat.
Dans un monde où on dispose des moyens techniques pour créer des images de toutes sortes, où la réalité virtuelle permet même d’envisager une seconde vie, rien n’empêche de mettre à la disposition du public des logiciels permettant de réaliser des images pédocriminelles plus vraies que nature. Alors que le fait de détenir des images « pédophiles » est sévèrement puni par la loi, on pourrait gagner « honnêtement » de l’argent en vendant des logiciels permettant de produire des images pédophiles virtuelles réalistes ? La frontière entre la légalité et le crime ne se jouerait alors qu’à quelques pixels près, ou bien il serait interdit de représenter graphiquement des scènes décrites avec tous les détails nauséeux (in)imaginables ? On retrouve curieusement le paradoxe de Robbe-Grillet qui veut enfermer ceux qui imaginent la mise en scène de ce qu’il écrit, et on peut légitimement se demander si l’arsenal législatif est vraiment adapté à ce type de question.
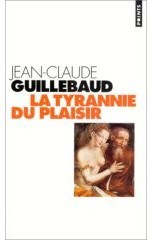 La question de la morale sexuelle, toujours d’actualité, est épineuse mais remarquablement traitée par Jean-Claude Guillebaud dans un de ses essais, La tyrannie du plaisir : N’y aurait-il donc pas d’autres choix possibles qu’entre permissivité claironnante ou moralisme nostalgique ?
La question de la morale sexuelle, toujours d’actualité, est épineuse mais remarquablement traitée par Jean-Claude Guillebaud dans un de ses essais, La tyrannie du plaisir : N’y aurait-il donc pas d’autres choix possibles qu’entre permissivité claironnante ou moralisme nostalgique ?
Dans une tentative de remise à plat, Jean-claude Guillebaud prend d’abord un recul historique qui permet de tordre le cou à bien des idées préconçues dont la liberté sexuelle de l’antiquité, l’austérité du moyen âge ou celle du Christianisme, pour nous rappeler la répétition de l’histoire à laquelle nous croyons avoir échappé du haut de notre courte vue. Il convie au débat historiens, philosophes, sexologues et sociologues pour aborder le sujet sous tous ses aspects, dont l’individualisme à outrance qui appauvrit l’échange qui devrait résulter du rapport sexuel où chacun des acteurs instrumentalise l’autre afin de parvenir à l’autosatisfaction motivée par l’acte en tant que fonction, et non plus en tant que moyen de communication privilégié : Le plaisir devient pure affaire anatomique, marchande et sportive (en attendant d’être cybernétique !) Il est prestation, rassasiement ou performance".
Face à la complexité de ces questions, Jean-Claude Guillebaud examine la démission de la société qui relègue les questions de société aux experts médicaux impuissants et aux juristes partagés entre deux logiques contradictoires de l’individualisme contemporain, celle de la revendication infinie de droits et celle de la demande de protection…
Comment ne serait-on pas troublés, dès qu’on se ressouvient du passé, par cette singulière situation ?
Vers le milieu des années 60, nous avions congédié le prêtre, le moraliste, le politique en charge du bien commun. Nous nous sentions la capacité - historiquement sans précédent - d’accorder à l’individu une primauté définitive sur le groupe. Nous pensions être investis du pouvoir de récuser ces prudences immémoriales, concessions aux contraintes, ruses collectives infinies et transactions de toutes sortes par lesquelles les sociétés humaines conjuguaient tant bien que mal l’aspiration au plaisir et l’impératif communautaire.
Voilà trente-cinq ans, nous fûmes, en matière de sexualité, plus intrépidement constructivistes qu’aucune société ne l’avait jamais été avant nous. L’apothéose de l’individu, son émancipation parachevée figuraient les vraies conquêtes de la modernité occidentale. Nous étions désormais assez riches, assez savants, assez raisonnables pour rejeter les superstitions du passé. Et assez libres, enfin, pour en dénoncer les tyrannies intimes.
La raison ne disqualifiait-elle pas la religion ? La démocratie ne rendait-elle pas inopérante la perpétuation politique des contraintes ? La connaissance ne nous assurait-elle pas la maîtrise des anciennes fatalités de l’espèce ? La science ne nous livrait-elle pas les clés de la procréation elle-même ? La certitude du progrès ne nous dispensait-elle pas de cette fidélité peureuse aux traditions ? La foi en l’universel, enfin, ne nous autorisait-elle pas à toiser le « pathos spécifique » des cultures humaines comme s’il s’agissait d’aimables folklores, avec leurs tabous et leurs précautions holistes ? Ce droit au plaisir, nous nous l’accordions comme une extraordinaire récompense historique. Il l’était en effet. On aurait bien tort de sourire rétrospectivement de cet optimisme.
Si l’on est troublé, aujourd’hui, c’est en voyant ce projet grandiose se heurter finalement aux mêmes obstacles, aux mêmes contradictions, aux mêmes risques mortels, surtout, que toutes les utopies qui l’avaient précédé. Le " climat " du moment, ces périls qui affleurent et ces peurs qui rôdent nous renvoient, au détail près, à des situations déjà vécues dans l’Histoire.
Cette violence polymorphe qu’à tort ou à raison nous sentons autour de nous, ce vertige sécuritaire qui nous empoigne au point de nous pousser à la panique juridique, ce sont précisément - on l’a vu dans les chapitres qui précèdent - ce que s’entêtèrent à conjurer les sociétés du passé. Il faudra nous résoudre à admettre que ces cultures traditionnelles, dont nous voulions orgueilleusement nous démarquer, n’avaient pas si mal compris l’intrication indissociable entre la sexualité et la violence.
J.C. Guillebaud : La tyrannie du plaisir, p. 379-381
Aujourd’hui, l’appareil judiciaire et les dispositifs pénaux nous tiennent lieu de directeur de conscience. Je crois que Un roman sentimental n’est qu’une grotesque provocation à leur endroit : je soupçonne que Robbe-Grillet a pour dernière ambition de se faire censurer afin de siéger aux côtés d’un Sade au panthéon des célébrités sulfureuses, lui qui a toujours méprisé « l’immortalité » bien pensante de l’académie Française. Ce vieillard n’a plus grand-chose à perdre. Nous, nous risquons de perdre encore un peu de liberté d’expression à cause de nouvelles législations réactionnaires qui pourraient être appliquées à tort et à travers. Le mieux que nous puissions faire est bien de laisser Un roman sentimental partir au pilon et de s'en convaincre en lisant La tyrannie du plaisir.
10:25 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (24) | Tags : De la morale et de la liberté, Alain Robbe-Grillet, Un roman sentimental, Jean-claude Guillebaud, La tyrannie du plaisir, Agrafe, Livres
19 septembre 2007
Le jeu
 Il faut atteindre les dernières pages de Hors jeu, le premier roman de Bertrand Guillot alias SecondFlore, pour comprendre véritablement son sujet : Le Jeu. C’était pourtant dans le titre, me direz-vous judicieusement, mais il m’aura fallu du temps pour comprendre combien ce titre a été bien choisi. Car Hors jeu a pour ambition de traiter du jeu sous tous ses aspects : de la cruauté du jeu de la drague à la vacuité du jeu social, de l’aliénation du jeu vidéo à la folie du jeu de casino, en passant par le jeu télévisé qui en synthétise toutes les tares, omniprésent sur nos écrans et dans ce roman où il nous apparaît plus que jamais comme la caricature grossière des jeux sociaux insidieux. Bien des auteurs ont traité divers aspects du jeu, Dostoïevski avec Le joueur bien sûr, mais aussi Houellebecq, Beigbeder, Kundera, et on les perçoit entre les lignes de Hors jeu, que ce soit pour le fond ou sous la forme. Dans l’ombre de ces monuments contemporains, traiter un sujet aussi vaste est probablement une gageure.
Il faut atteindre les dernières pages de Hors jeu, le premier roman de Bertrand Guillot alias SecondFlore, pour comprendre véritablement son sujet : Le Jeu. C’était pourtant dans le titre, me direz-vous judicieusement, mais il m’aura fallu du temps pour comprendre combien ce titre a été bien choisi. Car Hors jeu a pour ambition de traiter du jeu sous tous ses aspects : de la cruauté du jeu de la drague à la vacuité du jeu social, de l’aliénation du jeu vidéo à la folie du jeu de casino, en passant par le jeu télévisé qui en synthétise toutes les tares, omniprésent sur nos écrans et dans ce roman où il nous apparaît plus que jamais comme la caricature grossière des jeux sociaux insidieux. Bien des auteurs ont traité divers aspects du jeu, Dostoïevski avec Le joueur bien sûr, mais aussi Houellebecq, Beigbeder, Kundera, et on les perçoit entre les lignes de Hors jeu, que ce soit pour le fond ou sous la forme. Dans l’ombre de ces monuments contemporains, traiter un sujet aussi vaste est probablement une gageure.
Bertrand s’en sort bien avec un roman accrocheur, au style résolument moderne qui nous entraîne dans les tribulations de Jean-Victor Assalti, héros creux dont le vernis craquelle au point que sa vaniteuse puérilité finit par nous être sympathique. Tombé au chômage après une ascension aussi fulgurante qu’éphémère, il cherche à rebondir dans un jeu télé dont il veut rafler le gros lot avec panache. Il me semble que le tournant du roman se situe à la fin de la troisième partie - lorsque Jean-Victor retrouve une des candidates du jeu - au cours d’un paragraphe que je vous livre in extenso :
Prenant mon courage à une main, ma rose dans l’autre, j’ai avancé. Doucement. En passant, j’ai repéré une table où deux filles lookées Vogue buvaient de grands verres de vin blanc. « Même sur Meetic je ne suis tombée que sur des caves », disait Marie-Claire à Isa.
J’ai tout juste eu le temps de cacher la fleur sous la chaise. Emma a posé son livre, relevé la tête, m’a vu. Sourire d’ange.
- Bonjour !
- Et dire que j’ai cru ne jamais revoir ce sourire…
- On trouve toujours quand on sait chercher, Monsieur le Conseiller…
Ai-je rêvé ou elle avait rapproché sa main sur la table ? J’ai préféré parler de son livre.
- Risibles amours, donc. Tu aimes ?
- Oui. C’est un recueil de nouvelles. Je viens d’en finir une qui m’a fait penser à toi.
- Ah, oui ?
- C’est l’histoire d’un jeune couple. Le Jeu de l’auto-stop. Elle est timide et jalouse, lui est amoureux mais maladroit. L’his…
- Pardon, mais… Tu es timide, toi ?
- Idiot ! Donc l’histoire commence dans la voiture : ils partent en vacances. Ils parlent des auto-stoppeuses frivoles qui courent les routes tchèques, la fille imagine toutes les aventures qu’il a pu avoir, loin d’elle, dans sa voiture. Quand il s’arrête dans une station-service pour faire le plein, elle s’en va toute seule, à pied. Il la retrouve un peu plus loin, pouce levé comme une auto-stoppeuse. Il s’arrête à sa hauteur, la laisse monter…
- Un apéritif peut-être ?
La serveuse était arrivée à notre table, discrète comme une coupure publicitaire. Emma a fini son verre, m’a interrogé du regard.
- Bien sûr, j’ai dit. Tu reprends la même chose ?
- Ah non ! Varions les plaisirs.
Elle a tenté un merlot chilien, le moins cher de la carte, j’ai commencé par un bourgueil. La serveuse m’a demandé si nous voulions des grands verres. Bien sûr, j’ai répondu, et discrètement je lui ai demandé en bonus une chope de bière remplie d’eau.
- Les voilà sur la route, donc…
- Oui. Mais la situation a complètement changé. Un jeu s’est instauré : ils jouent a être deux inconnus qui vont finir la nuit ensemble. Libérée de sa timidité, elle joue la fille facile et y prend goût, elle le provoque et ça l’excite.
- Et alors ?
- Alors, le jeu les dépasse tous les deux. Prisonniers de leur scénario, ils ne peuvent pas éviter l’escalade. Quand ils arrivent à l’hôtel, il finit par la traiter de pute, littéralement je veux dire, il lui fait l’amour comme une brute, elle veut sortir du jeu mais n’y arrive pas, et elle finit par jouir comme jamais, mais en pleurant.
- Et elle le quitte ?
- On ne sait pas. Le garçon essaie de la consoler, sans succès. Tout ce que nous dit Kundera, c’est qu’il leur reste treize jours de vacances. J’aime quand les histoires n’ont pas de fin…
Son émotion était visible. Elle venait de loin, bien plus loin que nous deux. Je me suis retourné pour voir où en étaient nos apéritifs.
- Et quel rapport avec moi ? j’ai demandé.
- Le jeu !
 Risibles amours est, à mon avis aussi, le meilleur livre de Kundera. Loin d’être une œuvre de jeunesse immature, chacune de ses nouvelles préfigure les romans de sa postérité. Ainsi Le jeu de l’auto-stop est une merveille d’engrenage psychologique initié par les règles d’un jeu imbécile qui mène un jeune couple au désastre en révélant la part d’ombre de chacun, la part de l’autre. Le jeu agit comme un révélateur de l’âme en bâillonnant la raison avec ses règles ad-hoc:
Risibles amours est, à mon avis aussi, le meilleur livre de Kundera. Loin d’être une œuvre de jeunesse immature, chacune de ses nouvelles préfigure les romans de sa postérité. Ainsi Le jeu de l’auto-stop est une merveille d’engrenage psychologique initié par les règles d’un jeu imbécile qui mène un jeune couple au désastre en révélant la part d’ombre de chacun, la part de l’autre. Le jeu agit comme un révélateur de l’âme en bâillonnant la raison avec ses règles ad-hoc:
Et il ne servait à rien d’appeler au secours la raison et d’avertir l’âme étourdie d’avoir à garder ses distances et de ne pas prendre le jeu au sérieux. Justement parce que c’était un jeu, l’âme n’avait pas peur, ne se défendait pas et s’abandonnait au jeu comme à une drogue […] dans le jeu, on n’est pas libre, pour le joueur le jeu est un piège.
J’ai plus d’une fois pu constater combien cette phrase est vraie et comment le jeu pouvait exercer son emprise jusqu'à déborder ses protagonistes, comme ce fut le cas ici.
En conclusion, ne choisissez pas un de ces deux livres : ouvrez les deux comme les paupières sur la mécanique des jeux qui nous submergent.
10:00 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Livres, Agrafe, Hors jeu, Bertrand Guillot, Kundera, Risibles amours, Le jeu de l'auto-stop
17 mai 2007
La première gorgée…
 Il faut commencer par La première gorgée de bière. Dans son fameux recueil de nouvelles où il exalte les plaisirs minuscules, Philippe Delerm poursuit: « C’est la seule qui compte. Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu’un empâtement tiédasse, une abondance gâcheuse. La dernière, peut-être, retrouve avec la désillusion de finir un semblant de pouvoir… ». Cette phrase caractérise bien l’œuvre de Delerm placée sous le signe de la parcimonie. Chez lui, le bonheur se cache dans les infimes détails du quotidien qu’il glorifie d’une poésie prosaïque. Delerm encense l’humilité jusqu’à l’ostentatoire. De son regard contemplatif sur son microcosme, Delerm n’évoque pas les trépidances qui secouent le monde en dehors de la sphère de son jardin provincial, mais éclaire le quotidien avec la tendresse bienveillante d’une mamie sirupeuse.
Il faut commencer par La première gorgée de bière. Dans son fameux recueil de nouvelles où il exalte les plaisirs minuscules, Philippe Delerm poursuit: « C’est la seule qui compte. Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu’un empâtement tiédasse, une abondance gâcheuse. La dernière, peut-être, retrouve avec la désillusion de finir un semblant de pouvoir… ». Cette phrase caractérise bien l’œuvre de Delerm placée sous le signe de la parcimonie. Chez lui, le bonheur se cache dans les infimes détails du quotidien qu’il glorifie d’une poésie prosaïque. Delerm encense l’humilité jusqu’à l’ostentatoire. De son regard contemplatif sur son microcosme, Delerm n’évoque pas les trépidances qui secouent le monde en dehors de la sphère de son jardin provincial, mais éclaire le quotidien avec la tendresse bienveillante d’une mamie sirupeuse.
Avec la banana-split au comble de ses excès, inutile de dire que qu’il ne faut pas chercher des délires sexuels chez Delerm. À peine évoquée dans le bonheur avec une petite fable sur les souris anglaises, il faut bien ma perversité pour deviner du sexe entre les lignes de ce recueil : « Une pression du pouce sur la fente de la gousse et elle s’ouvre, docile, offerte. Quelques-unes, moins mûres, sont plus réticentes – une incision de l’ongle de l’index permet alors de déchirer le vert, et de sentir la mouillure et la chair dense, juste sous la peau faussement parcheminée. Après, on fait glisser les boules d’un seul doigt. La dernière est si minuscule. Parfois, on a envie de la croquer […] C’est facile d’écosser les petits pois. »
Avec La première gorgée de sperme, Fellacia Dessert joue le contre-pied. Sous ce pseudonyme facétieux, un écrivain célèbre à la plume acérée à écrit un hilarant pastiche dont on appréciera pleinement la malice en alternant sa lecture avec le recueil de Delerm. La succession des titres croisés est éloquente :
- Le paquet de gâteau du dimanche matin
- Les gâteries du dimanche matin
- Aider à écosser les petits pois
- Aider à exaucer ses petites ouailles
- Apprendre une nouvelle en voiture
- En prendre une nouvelle en voiture
- L’odeur des pommes
- L’odeur des hommes
- On pourrait presque manger dehors
- Pour un peu, on baiserait sur la terrasse
etc…
Un meilleur exemple valant mieux qu’un long discours, voici un extrait d’un texte de Delerm intitulé « Le croissant du trottoir »:
« On s’est réveillé le premier. Avec une prudence de guetteur indien on s’est habillé, faufilé de pièces en pièce. On a ouvert et refermé la porte d’entrée avec une méticulosité d’horloger. Voilà. On est dehors, dans le bleu du matin ourlé de rose : un mariage de mauvais goût s’il n’y avait pas le froid pour tout purifier. […] Il faut ce qu’il faut de buée sur la vitre quand on s’approche, et l’enjouement de ce bonjour que la boulangère réserve aux seuls premiers clients – complicité de l’aube.[…] On le sent bien : La marche du retour ne sera pas la même. Le trottoir est moins libre, un peu embourgeoisé par cette baguette coincée sous un coude, par ce paquet de croissants tenu de l’autre main. Mais on prend un croissant dans le sac. La pâte est tiède, presque molle. Cette petite gourmandise dans le froid, tout en marchant : c’est comme si le matin d’hiver se faisait croissant de l’intérieur, comme si l’on devenait soi-même four, maison, refuge. On avance plus doucement, tout imprégné de blond pour traverser le bleu, le gris, le rose qui s’éteint. Le jour commence, et le meilleur est déjà pris. »
Avec Fellacia Dessert, cela devient « le travelo du trottoir » :
« On a attendu que l’autre s’endorme. En silence on s’est alors levé, on s’est rhabillé, on a traversé l’appartement et on est descendu, sans claquer la porte. Ce ne sera pas long.
Dehors, on est cueilli par le froid, mais on a le sang si chaud qu’on le sent à peine. Pourvu qu’elle soit là. On marche jusqu’au bout du trottoir, le cœur battant, la main dans la poche serrée sur les billets.
Elle est là, juste derrière le mur. En guêpière, bas, talons vertigineux. Plus belle que n’importe quelle vraie femme. Plus belle que celle qui dort, là-haut. Les billets changent de main, les corps s’enfoncent sous la porte cochère. La nuit commence à peine, et le meilleur reste à prendre. »
Mais sous l’apparente plaisanterie se cache l’affrontement de deux visions du monde résumé par les deux dernières phrases de ces extraits, aussi symétriques qu’opposées. Delerm, c’est l’adulte mélancolique, le regret de l’enfance : le meilleur est déjà pris. Il ne reste donc plus qu’à poursuivre mollement sa vie adulte au risque de ne pas l’investir pleinement. Pour le jouisseur au ça bouillonnant, gorgé d’énergie libidinale, excessif par nature, le meilleur reste à prendre, à investir, à conquérir. On ne s’y trompe pas lorsque Fellacia Dessert crache son venin dans « La première gorgée de sperme », véritable pamphlet hédoniste qui oppose ses excès au pusillanime Delerm :
« Un faire-part de décès leur tiendrait lieu de carte de visite. En deuil des jours anciens, de ce qui aurait pu être et même de ce qui sera, en deuil d’eux-mêmes et de leur propre vie, ils poussent en pleurnichant leurs chants aussi exaltants que ceux des messes du dimanche matin.
Ah, vieille et douce France, tout embaumée dans ses plaisirs de retraités ! France des petites joies sans joie, de la délectation morose et du repli sur soi ! Fière France craintive ! Continuons à t’exalter, France routinière, nostalgique, passéiste ! Encore un peu, et tes adeptes des plaisirs minuscules te laisseront glisser vers l’ordre des bons vieux temps, vieux et increvables règnes des pleutres et des conformistes ! Temps du renoncement, et donc de toutes les compromissions ! Continuons à t’exalter, France immobile, débile, ringarde, impuissante, vieille, hypocrite, dégueulasse ! Qui cache sa bêtise crasse et son aigreur sous une modestie de petite-bourgeoise toute boursouflée de vanités ! »
Je ne sais pas ce que vous en pensez, ami lecteur, mais pour moi, ça sent le règlement de comptes !
07:55 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : Agrafe, Livres, Delerm, fellacia Dessert, La première gorgée de bière, La première gorgée de sperme, Littérature
07 mai 2007
Style blog
 Microfictions de Thierry Jauffret a peut-être été encensé par la presse mais moi, je n’ai pas pu le terminer. Ce n’est pas à cause de son épaisseur même s’il fait tout de même plus de 1000 pages, ni de son style à la fois percutant et recherché mais qui reste bien loin des arcanes grammaticales Proustiennes, ni même de sa forme narrative originale, non, ce que je n’ai pas supporté, c’est le fond.
Microfictions de Thierry Jauffret a peut-être été encensé par la presse mais moi, je n’ai pas pu le terminer. Ce n’est pas à cause de son épaisseur même s’il fait tout de même plus de 1000 pages, ni de son style à la fois percutant et recherché mais qui reste bien loin des arcanes grammaticales Proustiennes, ni même de sa forme narrative originale, non, ce que je n’ai pas supporté, c’est le fond.
Microfictions n’est pas un roman puisqu’il n’y pas d’unité de lieu ni d’action, mais un recueil de courtes nouvelles qui pourraient avoir été autant de notes d’un blog exclusivement dédié au cynisme le plus désabusé. Chacune de ces 500 nouvelles classées par ordre alphabétique fait exactement deux pages et elles partagent toutes une identique inhumanité. Jauffret jette un regard bienveillant sur les atrocités du monde, au travers des yeux du protagoniste principal de chacune de ses histoires sordides racontées à la première personne, que ce soit le point de vue de la victime ou celui du bourreau. Ce parti pris récurrent de l’immoralité, non pas au sens pudibond du 19ème siècle mais au sens humaniste actuel, devient rapidement si nauséeux que la lecture de chaque nouvelle nécessite un véritable effort de volonté. Pour illustrer ma pensée, voici la première page de ce livre, c'est-à-dire la moitié de la nouvelle intitulée Albert Londres assez représentative des autres:
Nous avons filmé ces scènes de torture et de meurtre afin d’en dénoncer le caractère intolérable et la barbarie. Vous ne pouvez pas reprocher à une chaîne d’information de montrer la réalité. S’il est bien évident que nous blâmons leur conduite, nous devons aussi rendre hommage à ces tortionnaires de nous avoir permis d’apprécier à sa juste valeur le prix du bien être de la vie. Il est vrai que nous nous sommes rapprochés d’eux peu à peu.
- Ils sont devenus pour ainsi dire des relations de travail.
Et en définitive nous avons noué avec certains des liens d’amitié. Ils nous ont aidé dans notre tâche, évitant par exemple de faire exploser les otages, ce qui se serait traduit à l’image par une épaisse fumée monochrome peu propice à l’accroissement de l’audimat.
- L’exécution des enfants apitoyait les classes supérieures comme les plus mal lotis.
Nous allions jusqu’à drainer plusieurs millions de téléspectateurs en plein milieu de la nuit . Mais ces pratiques déplaisaient aux annonceurs, qui redoutaient notamment une atteinte à l’image de marque de leurs produits pour bébés.
- Nous leur avons donc demandé de les épargner.
Nombre de gamins nous doivent la vie, même s’ils restent toujours détenus dans des caves et des carrières désaffectées dont par déontologie nous refuserons toujours de révéler l’emplacement aux services de police […]
À propos de police, j’ai été faire un tour à la Fnac pour changer d’air et devinez sur qui je suis tombé : Bénédicte en tête de gondole ! Du coup, je l’ai prise sur place, enfin, j’ai pris son bouquin et aussi un génialissime Kundera que je n’avais pas encore lu mais c’est une autre histoire. Comment ? Vous ne connaissez pas Bénédicte, ami lecteur ? Ben moi non plus à vrai dire. Lib m’en avait parlé, j’avais été voir son blog démantelé par nécessité commerciale, et les quelques notes survivantes m’avaient bien plu. Police, le blog d’un flic, n’est donc plus un blog mais un site web promotionnel du premier roman de Bénédicte Desforges, FLIC, dont la forme est similaire à Microfictions : Une succession de nouvelles brèves dont chacune raconte une anecdote issue du quotidien d’un policier, à la première personne du singulier dans un style simple et percutant. Et dans l’horreur, cette réalité là dépasse largement la fiction.
Toute la différence se situe dans le regard de Desforges: le parti pris du narrateur protagoniste est résolument humain. Il ne s’agit pas là d’humanisme institutionnel, ni d’une profusion de bons sentiments, mais de véritable compassion. Et cette compassion passe aussi par le jugement, par le choix du bien contre le mal avec son lot d’arbitraire:
J’ai menotté des gens qui avaient battu, volé ou tué, j’ai menotté des toxicos en manque qui avaient tout cassé dans leur propre maison, pour ne pas qu’ils finissent par se faire mal, j’ai menotté des cambrioleurs en flagrant délit en train de dépouiller plus pauvres qu’eux, j’ai menotté des gens violents pour qu’ils me foutent la paix et pour ne pas m’en prendre une, j’ai menotté un père qui avait violé sa fille, et un collègue a menotté la mère qui ne voulait pas qu’on menotte le père pour « ça », j’ai menotté des gens qui avaient comme seul tort d’être là au mauvais moment, j’ai menotté par erreur, j’ai menotté des vrais cons et des braves cons, j’ai menotté vraiment plein de gens.
Ses récits embrassent toute la palette des couleurs de la vie, du rire aux larmes, loin de l’uniforme gris sinistre de Microfictions. Résultat, j’ai dévoré FLIC en deux jours avec un vif plaisir. Je ne résisterai donc pas a celui de recopier l’hilarante anecdote du jeune policier enthousiaste :
Il était parti passer le week-end chez sa grand-mère, fier de pouvoir exhiber son enthousiasme et son matériel rutilant tout juste sorti de l’emballage. D’un air malin, il avait sorti les menottes de sa poche. « Mémé, je vais te montrer comment ça marche… ». Il l’a menottée, et en même temps qu’il serrait les bracelets sur les poignets de l’ancêtre, il s’est rappelé que la clef était restée dans son placard.[...]
J’espère qu’on ne me passera pas les menottes pour cette petite entorse aux droits d’auteur…
07:00 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : Agrafe, Livres, Microfictions, FLIC, Jauffret, Desforges, Littérature






