21 décembre 2007
Sept
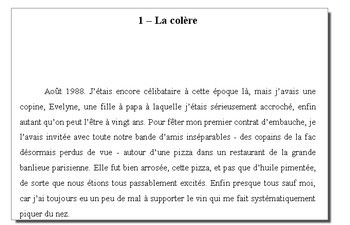 Mes sept péchés capiteux - une longue nouvelle érotique aux accents gargantuesques, à consommer sans modération en cas de grosse faim - rééditée au format pdf.
Mes sept péchés capiteux - une longue nouvelle érotique aux accents gargantuesques, à consommer sans modération en cas de grosse faim - rééditée au format pdf.
07:05 Publié dans histoires érotiques | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Sept, Erotisme, orgie, récit érotique, Histoire Erotique, péchés, évangiles
21 août 2007
Sept : L’avarice
 Je déambulais dans les rues de Bordeaux. Il m’avait fallu quinze jours de plus pour me remettre du dernier assaut de Christelle, quinze jours dans la chambre à fleurs dont j’avais verrouillé la porte. Dès que j’avais été sur pieds, j’avais signifié à Delavigne mon départ imminent. Il m’avait proposé de me conduire à la gare dès le lendemain, après le déjeuner dominical au cours duquel il tenait à me faire découvrir son meilleur cru, c'est-à-dire son premier cru mais aussi son dernier, bref, son seul et unique cru. Après m’être invité plus d’un mois chez lui, il m’avait semblé naturel en une telle occasion de lui offrir un cadeau à la mesure de son hospitalité, mais surtout à la mesure de mon budget.
Je déambulais dans les rues de Bordeaux. Il m’avait fallu quinze jours de plus pour me remettre du dernier assaut de Christelle, quinze jours dans la chambre à fleurs dont j’avais verrouillé la porte. Dès que j’avais été sur pieds, j’avais signifié à Delavigne mon départ imminent. Il m’avait proposé de me conduire à la gare dès le lendemain, après le déjeuner dominical au cours duquel il tenait à me faire découvrir son meilleur cru, c'est-à-dire son premier cru mais aussi son dernier, bref, son seul et unique cru. Après m’être invité plus d’un mois chez lui, il m’avait semblé naturel en une telle occasion de lui offrir un cadeau à la mesure de son hospitalité, mais surtout à la mesure de mon budget.
Je n’ai pas trouvé pas grand-chose. Je venais de passer deux heures harassantes à marchander avec un forain sénégalais - j’hésitais encore entre la tour Eiffel dans sa bulle à neige qui rappellerait à Delavigne ses années parisiennes, ou bien le chapeau parapluie multicolore qui pourrait lui faire office d’ombrelle sous le soleil girondin tout en lui laissant les mains libres pour bien travailler sa vigne - lorsqu’une jeune fille m’a interpellé. Elle m’a dit avoir pour moi une bonne nouvelle. Je l’ai écoutée d’une oreille, le temps de faire mariner le sénégalais pour lui arracher quelques centimes de plus. Trop contente d’avoir trouvé un client pour écouter ses boniments évangélistes, elle me proposait un petit bouquin intitulé Psaumes et Nouveau Testament. J’ai eu un peu de mal à comprendre ce dont il s’agissait – une sorte de recueil de nouvelles écrites par d’obscurs Marc, Luc, Mathieu et autre Jean, avec une longue préface hermétique d’un certain roi David et une postface sentencieuse d’un dénommé Paul – mais ce que j’ai vite compris, c’est que son bouquin était gratuit ! Du coup, je lui en ai pris quatre, un pour chacun pour le prix d’un sermon abscons, et j’ai abandonné le Sénégalais à sa pacotille et ses jurons. J’ai même réussi à négocier un lot de tracts à l’œil pour servir de papier cadeau !
Le lendemain, entre la poire et le fromage et après un fabuleux gigot d’agneau au curry, j’ai distribué mes précieux cadeaux. Agnès a fait bonne figure, Lucienne une moue dubitative, et Christelle a essuyé les larmes qui n’avaient cessé de couler depuis le début du repas. Seul Delavigne a semblé apprécier mes présents à leur juste valeur. Il a pris la parole ou perçait une étrange jubilation : « Christophe, mon cher Christophe, mon fils – si tu me permets cet élan paternaliste – je suis si heureux ! Tiens, je vais vous lire à tous une parabole que j’aime bien, voyons voir… c’est dans l’évangile selon Luc, au chapitre 15 je crois bien… Ah voilà : la parabole du fils prodigue ! »
Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien.
« Je me suis un jour amusé à identifier les fameux péchés capitaux dans cette parabole, nous a dit Delavigne. Voici donc l’envie, la convoitise. Il faut aussi savoir que le fils cadet avait moins de droit mais aussi moins de devoir que le fils aîné selon le droit israélite de l’époque. Le père – qui symbolise Dieu - comprend que le moment est venu où ce fils ne peut plus être guéri que par l'expérience, et il le livre à sa nature hédoniste : paresse et luxure ! » Disant cela avec une moue gourmande, Delavigne comptait sur les doigts de sa main droite. Il en était déjà à trois.
Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche.
Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait.
« Voilà un joli paradoxe amusant à constater, a surenchéri Delavigne : en exerçant sa liberté individuelle jusqu’à ses limites, le fils cadet a fini par perdre toute liberté. À cause de son intempérance, de sa gloutonnerie de plaisirs – le quatrième doigt de Delavigne s’est dressé pour compter la gourmandise – le fils a tout perdu. Affamé, il est devenu l’esclave de son propre ventre ce qui le conduit au comble de la déchéance pour un Juif : garder les pourceaux loin de chez lui, c'est-à-dire loin de Dieu et au service d’un maître païen. »
Étant rentré en lui-même, il se dit : Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai : Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ; traite-moi comme l'un de tes mercenaires.
Delavigne poursuivait sa lecture avec la passion qui le caractérisait déjà dans les amphithéâtres. Tandis que les membres de sa famille réprimaient difficilement leurs bâillements, j’écoutais son exégèse passionnée dans une totale sidération : « Un élément crucial rarement mentionné est l’abandon de l’orgueil – la main droite de Delavigne était levée, ses cinq doigts tendus. Pour entrer en méditation, et par conséquent se présenter humblement devant Dieu le Père, le fils doit abandonner toutes ses prérogatives, tout son orgueil, et se rabaisser au niveau des derniers ouvriers agricoles : les mercenaires payés à la tâche. »
Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit : Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
Mais le père dit à ses serviteurs : Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez ; mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous ; car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir.
« Il y aurait tant à dire sur ces derniers versets, dont chaque mot vibre d'émotion. Imaginez donc la scène : ce père qui n'a pas cessé d'attendre son fils ; l'apercevant de loin, il court au-devant de lui : Dieu discerne le plus faible soupir vers le bien qui se fait jour dans un cœur égaré et dès que ce cœur fait un pas vers lui, il en fait dix à sa rencontre, s'efforçant de lui faire entrevoir quelque chose de son amour. » En disant cela, j’ai bien cru voir une larme au coin de l’œil de Delavigne. Il n’avait pas de fils du tout, lui.
Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce que c'était. Celui-ci lui dit : Ton frère est de retour, et, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Le fils aîné se mit en colère, et ne voulut pas entrer.
« Et voici la colère, celle de l’aîné, motivée par l’absence d’amour et sans doute par l’avarice : non seulement on a tué le veau gras réservé pour les grandes occasions, mais devra-t-il à nouveau partager avec son frère cadet ? »
Son père sortit, et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père : Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras ! Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi ; mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé.
Delavigne n’avait pas levé la main gauche pour compter les deux derniers péchés, mais il m’a regardé humblement : « Christophe, ne veux-tu pas rester quelques jours de plus ? Je te considère un peu comme mon propre fils, et j’aurais besoin d’un peu d’aide en ce moment. Juste quelques jours… »
J’étais dans mes petits chaussons : Après avoir honteusement profité de son hospitalité, après avoir convoité son épouse et ses biens, après m’être roulé dans la luxure avec sa fille et sa bonne, voilà qu’emporté dans sa lecture biblique, Delavigne m’accueillait comme son propre fils. Comment lui refuser ce qu’il me demandait. Christelle me regardait avec des yeux suppliants. J’ai accepté.
Voilà dix-neuf ans que j’habite chez les Delavigne. Deux jours après ce fameux déjeuner, Lucienne m’a appris que Christelle était enceinte. J’ai assuré sur tous les plans. Depuis, j’ai même repris les soixante kilos que Christelle a perdus.
_________________________________________________________
(1) : Dans la rédaction de cette note, je me suis largement inspiré de l’excellente analyse de la parabole du fils prodigue réalisée par Frédéric Godet
(2) : Cette note clos la série Sept, comme sept péchés capiteux et autant d’aveux à produire. Le défi des 7 aveux m’avait été lancé à la fois par Agatha mais aussi par CUI, car je peux aujourd’hui vous l’avouer, juliette Binoche, c’est moi ! D’accord, ces aveux sont purement imaginaires, mais n’en sont-ils pas moins amusants ?
07:25 Publié dans Fictions | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Sept, Histoire Biblique, Péchés Capitaux, parabole du fils prodigue
13 août 2007
Sept : La paresse
 J’étais de retour dans la chambre au papier à fleur, mais alité pour de bon cette fois-ci. La solide Lucienne m’avait fait descendre de la table de la cuisine où j’avais été cloué comme un papillon, ou plutôt écrasé comme une mouche, et elle m’avait transporté clopin-clopant vers ma chambre. Muscles froissés, rachis traumatisé, trois jours de repos avec interdiction formelle de quitter la chambre, « et d’y pratiquer toute activité physique » avait cru bon d’ajouter le médecin en riant, après m’avoir demandé si je n’étais pas passé sous un rouleau compresseur.
J’étais de retour dans la chambre au papier à fleur, mais alité pour de bon cette fois-ci. La solide Lucienne m’avait fait descendre de la table de la cuisine où j’avais été cloué comme un papillon, ou plutôt écrasé comme une mouche, et elle m’avait transporté clopin-clopant vers ma chambre. Muscles froissés, rachis traumatisé, trois jours de repos avec interdiction formelle de quitter la chambre, « et d’y pratiquer toute activité physique » avait cru bon d’ajouter le médecin en riant, après m’avoir demandé si je n’étais pas passé sous un rouleau compresseur.
Le lendemain après-midi, vers trois heures, tandis que je somnolais à demi nu sur mon lit écrasé de chaleur, j’ai entendu la porte de ma chambre s’ouvrir doucement. Couché sur le côté, je lui tournais le dos mais j’ai décidé de ne pas bouger, plus par paresse que pour épargner mon corps douloureux. J’ai juste ouvert une paupière pour contrôler, dans le miroir de l’armoire, qui s’approchait de moi à pas de loup. En l’occurrence, c’étaient des pas de louve. Agnès s’est arrêtée tout près du lit. Son regard était si intense qu’il m’a semblé en sentir le poids se poser sur ma nuque, rouler sur mes épaules où perlaient quelques gouttes de sueur, couler le long de mon flanc où saillaient mes muscles froissés, hésiter à ma taille recouverte du drap blanc, virevolter sur ses plis suggestifs avant de se reposer sur mes cuisses velues. J’observais Agnès dans le miroir sans qu’elle ne s’en doute. Était-elle venue veiller sur mon sommeil comme une mère sur celui de son enfant ? Sa langue est passée sur ses lèvres en guise de démenti, mais elle a fait demi-tour pour ressortir de la chambre aussi discrètement qu’elle y était entrée.
La scène s’est renouvelée le jour suivant. J’étais allongé sur le dos, entièrement nu tant la chaleur était insoutenable, avec un bout de drap sur les hanches pour seul tribut à la pudeur. Cette mise en scène ne devait rien au hasard : Il était trois heures et j’espérais vivement la visite d’Agnès. Je l’attendais même avec une ardeur palpable. Quelques minutes plus tard, la porte s’est ouverte. J’ai gardé les paupières closes pour ne pas effrayer mon invitée tacite, qui avançait vers moi avec la prudence d’un cambrioleur. Comme je m’y attendais, il y eut un bruit de chute et je n’ai pas tressailli. « Zut ! » ai-je entendu, et puis « vous dormez ? ». Je suis resté impassible, bien sûr, je n’allais tout de même pas avouer mon forfait si près du but : J’avais disposé Guerre et Paix en équilibre au bord de ma table de chevet, accroché à un fil imperceptible tendu en travers de la pièce. J’espérais qu’Agnès, convaincue que je dormais profondément, en profiterait pour abuser de mon corps assoupi.
J’ai senti un doigt léger frôler ma peau humide de sueur, là où elle est la plus fine, entre la base du cou et la clavicule. Il glissait jusqu’à mon épaule lorsque j’ai entendu sa voix : « Je voulais vous parler mais… c’est si difficile à dire que c’est aussi bien que vous dormiez. »
Le doigt a souligné le galbe de mes muscles avant de retourner sur mon torse aux pectoraux saillants.
« Vous devez penser que je ne suis pas très maligne, que je ne fais attention à rien, que je peux tout avaler, mais depuis ce qui s’est passé dans la cuisine, avec Lucienne, je n’en dors plus… »
En entendant cela, je ne suis pas parvenu à me maîtriser complètement. J’ai pris une profonde inspiration et j’ai alors senti la pulpe de son doigt s’attarder sur mon téton, en faire le tour, le frôler délicatement. Je me suis alors dit qu’Agnès était une sacrée perverse, prête à braver tous les tabous pour arriver à ses fins, et dont les caresses prometteuses ne cachaient rien de ses desseins lubriques.
« Je sais bien que c’est Lucienne qui vous excitait, mais vous n’avez pas hésité à vous taper la grosse Christelle sans trop vous en soucier n’est-ce pas ? Vous êtes un baiseur sans scrupule ! »
Le doigt poursuivait sa course vers le bas de mon corps avant d’être rejoint par trois autres sur mes abdominaux. Ils les ont passés aussi doucement que des voitures sur un dos d’âne.
« Mais malgré tout, j’ai l’impression que vous êtes un type bien… ou alors je me le suggère pour accepter l’idée que vous m’excitez comme une folle… »
Il n’y avait pas qu’elle à être excité ! Je me suis dit que non seulement elle s’apprêtait à coucher avec l’amant de sa fille, mais qu’il lui fallait en plus avoir l’impression de le pervertir pour prendre son pied ! En attendant, ses doigts étaient aux abords du drap. Ils ont décollé de ma peau lentement, comme à regret, avant que je ne sente le drap glisser sur mon sexe, sur mon phallus gonflé depuis que j’attendais Agnès.
« Folle, je suis folle de vous depuis le premier regard !»
J’ai senti son souffle sur ma verge raide. Le doigt – ce même doigt qui me titillait et dont les égarements me rendaient fou - s’est posé à sa base, juste à la limite de mes couilles, et a glissé tout au long de ma hampe jusqu’à sa pointe vermillon. J’aurais sans doute dû ouvrir les yeux à ce moment là, mais me laisser faire était si bon que je n’avais plus le moindre goût de l’effort.
« Vous m’excitez Christophe ! Je ne rêve plus que de vous, vous et votre grosse bite, je ne rêve plus que de me la prendre partout. Dans la bouche d’abord… »
Elle a joint le geste à la parole et elle m’a gobé le bout du gland, avant que je ne sente sa langue humide prendre le chemin inverse de celui pris par son doigt, du gland jusqu’aux couilles qu’elle a dardées de la pointe de la langue.
« Entre mes seins aussi… »
J’en ai aussitôt senti les pointes sur mes cuisses et mon ventre. J’étais tant excité d’imaginer Agnès me branler avec ses gros seins - ils me semblaient encore plus gros les yeux fermés - que je sentais le plaisir monter, irrémédiablement. J’imaginais son doux visage penché sur mon bas ventre frissonnant, ses lèvres vermillon à quelques centimètres de mon gland turgescent, au bout duquel devait pointer déjà une goutte de sperme menaçante. Je me sentais prêt à jaillir, et à me laisser nettoyer sans esquisser le moindre geste.
« Même dans mon petit trou, si vous voulez ! Il est encore vierge, vous savez, mais je le dilaterai pour vous, je l’ouvrirai pour que vous me le bouchiez, pour que vous m’enfonciez votre dard jusqu’à la garde. Je suis prête à tout pour vous garder, Christophe, même à vous prêter Lucienne si vous voulez, même à faire la gouine avec elle pour vous exciter, même à perdre les soixante kilos que j’ai en trop mais là, ce que je veux, c’est votre queue au fond de ma chatte !»
J’ai à peine eu le temps d’écarquiller les yeux que je l’ai vue s’empaler sur mon sexe d’un grand coup de rein. La douleur s’est réveillée, aussi fulgurante que la jouissance. L’une et l’autre me terrassèrent en me laissant juste assez de conscience pour réaliser que non seulement Christelle avait les yeux de sa mère, mais qu’elle en avait aussi la voix.
07:45 Publié dans Fictions | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : récit érotique, sept, histoire erotique, péchés capitaux, la paresse, femme ronde
27 juillet 2007
Sept: La luxure
 Les mains de Christelle sont parties explorer mon corps, mon buste luisant, mon ventre maculé où elle a dessiné des arabesques de chocolat du bout des doigts, et mes cuisses qu’elle a écartées pour y prendre place. Accroupie entre elles, elle a entrepris de me nettoyer les couilles de la pointe de la langue, lapant comme une petite chienne la glace fondante qui y coulait en gouttes épaisses et sirupeuses.
Les mains de Christelle sont parties explorer mon corps, mon buste luisant, mon ventre maculé où elle a dessiné des arabesques de chocolat du bout des doigts, et mes cuisses qu’elle a écartées pour y prendre place. Accroupie entre elles, elle a entrepris de me nettoyer les couilles de la pointe de la langue, lapant comme une petite chienne la glace fondante qui y coulait en gouttes épaisses et sirupeuses.
« Laisse m’en un peu Christelle ! Petite égoïste, tu n’as même pas pensé à ce qu’allait déguster notre jeune invité ! » gloussa Lucienne derrière moi ! J’ai tourné la tête vers l’opulente antillaise. Elle me jetait des œillades égrillardes par-dessus son épaule. Son dernier vêtement, un string rouge qu’elle s’apprêtait à retirer mais qui disparaissait déjà entre les plis de sa croupe grandiose, donnait l’impression d’entourer en rouge son impudicité. Elle s’est penchée en avant pour le faire glisser tout au long de ses jambes tendues, exhibant son cul sous mes yeux ébahis, ferme et haut placé, dont chaque fesse avait la taille et la rotondité d’un ballon de basket. « Tu veux goûter mes grosses boules au chocolat ? À la chantilly, au coulis de framboise, ou bien nature ?
- Heu… coulis de framboise peut-être ? » suis-je parvenu à articuler les lèvres sèches.
Lucienne a attrapé un pot de confiture sur une étagère, elle est montée debout sur la table tout en se dandinant, et elle a mis un pied de chaque côté de mon visage, m’offrant une vue plongeante sur son obscure entrecuisse. J’avais l’impression d’être allongé entre les colonnes d’un temple en marbre brun de Verone, dont les fesses chapiteau soutenaient un monument de luxure. Soudain, ce fut le tremblement de terre. Sans qu’un seul autre muscle ne bouge, les fesses de Lucienne ont semblé s’animer de leur vie propre, indépendante du reste de son corps, comme un Mapouka luxurieux avant l’heure. Peu à peu, elle a fléchi les jambes tout en ouvrant le pot de confiture, sans que ses fesses ne cessent jamais de trépider. Elle plongea les doigts dans le pot, et lorsque sa croupe cessa enfin de s’agiter à quelques centimètres de mon visage, elle étala généreusement la confiture rouge sang de sa vulve luisante aux confins de la raie du cul. La matière poisseuse collait à ses poils pubiens ras et crépus, luisait sur les lèvres de sa vulve noire ouverte sur ses chairs rosées, au bout desquelles pointait déjà le capuchon brun de son clitoris gros comme un petit pois à écosser. À l’autre bout, les grumeaux de confitures semblaient dessiner une étoile de mer dont son petit trou était le centre. « Bon appétit mon grand ! » Me dit Lucienne en barbouillant mon visage avec sa vulve ruisselante de mouille aromatisée à la framboise, à moins que ce soit l’inverse.
Pendant ce temps là, Christelle m’avait soigneusement nettoyé les testicules, et elle léchait déjà la glace qui fondait irrémédiablement sur mon ventre. « Il était temps que j’arrive ! » dit Lucienne en se s’allongeant tête bêche sur mon corps. Je sentis ses seins s’écraser sur mon abdomen recouvert de glace au chocolat, et mon phallus disparaître entre ses globes charnus comme mon visage s’était déjà perdu au cœur de sa croupe enveloppante. Je baisais, je léchais, je suçais indifféremment tout ce qu’elle me présentait tour à tour, de son clitoris turgescent à son anus palpitant en passant par sa vulve molle et juteuse comme un abricot trop mur. Je ne voyais rien d’autre que sa peau tabac, plus foncée et froncée aux abords de son petit trou, pourpre à l’orée de son calice, et seuls les gloussements, soupirs et suçotements qu’émettaient Lucienne et Christelle me permettaient d’imaginer la lutte homérique qu’elles se livraient pour sucer les reliefs de ma banana split. Privées de tous repères visuels, mes pensées se perdaient dans le gouffre de mon imagination lubrique. Un simple gloussement de Christelle, et j’imaginais Lucienne lui laper une goutte de chocolat fondu à la commissure des lèvres. Il suffisait que le con de Lucienne jute un peu plus dans ma bouche pour que j’imagine Christelle sucer les tétons chocolatés de la voluptueuse antillaise. Un va et vient des lèvres de la jeune fille tout au long de ma hampe, et je rêvais que Lucienne tenait la tête de Christelle entre ses mains pour lui indiquer le rythme et l’ampleur du mouvement, à moins que ce soit l’inverse ! J’ai tendu les mains pour vérifier mes hypothèses. Elles sont égarées dans des chairs molles, entremêlées, lourdes et chaudes, indifférenciées : le corps de la luxure.
En fin de compte, j’ai préféré enfoncer un doigt dans le petit trou noir qui palpitait sous mes yeux. Lucienne s’est redressée, haletante, elle a attrapé quelque chose derrière moi et me l’a mis entre les mains. C’était une énorme banane plantain, encore verte et bien dure, longue d’une bonne trentaine de centimètres : « Mets moi la banane ! Mets la moi profond dans la chatte, j’aime les gros calibres ! » m’a soufflé Lucienne entre deux gémissements. J’ai pointé le bout de la banane recouverte d’un préservatif à l’entrée de sa vulve épanouie, et j’ai poussé doucement. Sa fente s’est ouverte, s’est dilatée pour accueillir le gros fruit oblong qui la pénétrait. Lorsque je faisais mine de la retirer, les chairs roses de Lucienne qui émergeaient de sa chatte brune donnaient l’impression d’aspirer la banane avec laquelle j’ai commencé à la pistonner. Mon poignet bielle lui imprimait un mouvement de va et vient et la banane piston coulissait dans son vagin cylindre. À chaque tour, sa cyprine visqueuse coulait dans ma bouche carter moteur. Avec un doigt dans la culasse et ma langue à l’allumage, Lucienne rugissait toutes soupapes ouvertes, prête au looping. Entre ses cuisses, ailes grandes ouvertes vrombissantes, je la voyais s’agripper à mon manche vertical. Il a disparu sous le ventre en cumulonimbus de Christelle accroupie, dont les cuisses orageuses prenaient ma taille en étau, englouti sous la haute pression de ses chairs humides. J’était pris entre deux sensations opposées : tandis que mon plaisir s’était envolé jusqu’au bord du point de non retour, j’avais l’impression que mes hanches allaient se briser comme une coque de noix contre une table. Christelle poussa un cri aigu en même temps qu’un éclair de douleur me foudroya le nerf sciatique. À la fois excité mais incapable de jouir à cause de la souffrance qui m’avait terrassé, j’avais rejoins les sensations ambiguës de cette jeune femme qui n’était plus qu’ascendant vierge.
A suivre...
07:10 Publié dans Fictions | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : sept, histoire erotique, péchés capitaux, la luxure, femme ronde, femme noire, sex toy
25 juillet 2007
Sept: La gourmandise
 Résumons la situation : J’étais nu comme un ver, allongé dans la pâte à tarte sur une table de cuisine, aux prises avec une Martiniquaise vicieuse qui accommodait mon sexe comme une banana split. Après avoir accueilli sur mon bas ventre une boule de glace au chocolat et une boule à la vanille à côté de mes testicules rétractées par le froid, Lucienne a posé sur ma verge tendue quelques tranches de bananes avant de la recouvrir d’une généreuse couche de crème chantilly, elle-même saupoudrée de noix de coco râpée. Visiblement satisfaite par son œuvre culinaire, elle n’est pas venue se loger entre mes cuisses pour satisfaire sa gourmandise comme je le souhaitais, mais elle a décroché le combiné de l’interphone : « Le goûter de mademoiselle est prêt ! Il vous attend à la cuisine ! »
Résumons la situation : J’étais nu comme un ver, allongé dans la pâte à tarte sur une table de cuisine, aux prises avec une Martiniquaise vicieuse qui accommodait mon sexe comme une banana split. Après avoir accueilli sur mon bas ventre une boule de glace au chocolat et une boule à la vanille à côté de mes testicules rétractées par le froid, Lucienne a posé sur ma verge tendue quelques tranches de bananes avant de la recouvrir d’une généreuse couche de crème chantilly, elle-même saupoudrée de noix de coco râpée. Visiblement satisfaite par son œuvre culinaire, elle n’est pas venue se loger entre mes cuisses pour satisfaire sa gourmandise comme je le souhaitais, mais elle a décroché le combiné de l’interphone : « Le goûter de mademoiselle est prêt ! Il vous attend à la cuisine ! »
Je n’en croyais pas mes oreilles. Voilà donc les perversions auxquelles on se livrait chez ce pauvre Delavigne ! À peine ai-je eu le temps de réaliser cela que j’ai entendu le martèlement d’une lourde course dans le couloir, dont le bruit sourd me fit penser à la charge d’un pachyderme. C’était mademoiselle. Christelle n’avait que 18 ans, mais avec 130 kilos au moins – son poids avait dépassé les graduations de la balance, échappant définitivement à tout contrôle – il était difficile de lui donner un âge. Son visage fin et gracieux épaississait à partir des joues qui se muaient en bajoues à l’orée du cou empâté et tout le reste allait en dilatant comme dans un miroir grossissant qui n’aurait épargné que les extrémités de son corps: les membres coniques s’affinaient jusqu’à ses mains et ses pieds à peine potelés. On avait l’impression qu’elle était recouverte d’une gangue de graisse dont elle émergeait par endroits, comme un joli papillon d’une chrysalide. Dès mon arrivée, Christelle m’avait gratifié de regards plus langoureux les uns que les autres, mais auxquels je n’avais répondu que par une froide indifférence polie. Lorsqu’elle est entrée dans la cuisine vêtue d’un boubou informe, et qu’elle a posé ses grands yeux gourmands – les même yeux verts que sa mère – sur mon corps à déguster, je n’ai pu répliquer qu’un regard affolé malgré la rougeur qui envahissait le visage de cette gentille ogresse encore percluse de timidité. Bien que j’étais offert à Christelle sur un plateau d’argent, Lucienne a compris qu’il faudrait encore lui donner la becquée : « Mademoiselle, voici le dessert dont vous rêviez ! N’attendez pas que la glace fonde ! » a dit Lucienne en lui tendant une petite cuillère, avant de fermer à clef la porte de la cuisine.
La timide jeune fille s’est approchée, elle a tout juste effleuré la chantilly de la pointe de la cuillère par crainte de toucher mon corps, et elle l’a vivement portée à sa bouche dans un geste qui confirmait une gourmandise enfantine : la partie concave épousait sa lèvre inférieure afin que sa langue puisse mieux en laper le contenu, alors que ses paupières se fermaient un instant sur ses yeux révulsés de plaisir. Le second coup de cuillère, plus précis, s’est planté dans la boule de glace à la vanille, à quelques centimètres de mes testicules congestionnées par le froid, m’épargnant ainsi une douloureuse castration involontaire. À la confiance qui s’installait peu à peu dans ses gestes, je comprends rétrospectivement que le plaisir procuré par le sucre désinhibait Christelle, comme l’alcool échauffe parfois les sens. Il restait encore de la crème chantilly à la commissure de ses lèvres lorsque le troisième assaut a glissé sur ma verge toujours dure et en a décollé une tranche de banane, livrant un peu de mon intimité au regard de la jeune gloutonne où j’ai vu jaillir une étincelle de concupiscence. Christelle a poursuivi sa dégustation et sa découverte, autant pour son plaisir gustatif que visuel : Elle a d’abord pris soin de dégager ma hampe, laissant mon gland sous un voile pudique de chantilly ; elle a déplacé à sa guise les boules de glaces qui fondaient sur mon ventre en un onctueux coulis artistique ; du dos de la cuillère, elle tâtait la densité de mon excitation qu’elle prenait peut-être pour du désir à son endroit.
Je comprends aujourd’hui que la gangue de mousse crémeuse qui enveloppait mon phallus, fière incarnation de ma libido, était à l’image de la gangue de graisse à l’intérieur de laquelle Christelle était cachée. En dégageant mon sexe, en le faisant apparaître à ses yeux, elle abandonnait symboliquement sa peau d’adolescente boulimique pour accéder à son essence féminine sexuée et désirante. La transformation physique de Christelle en découlerait quelques mois plus tard comme je pourrai le constater. Lucienne qui venait d’offrir à Christelle une délicieuse psychothérapie, en a porté l’estocade : « C’est meilleur avec les doigts ! »
Christelle a déposé la petite cuillère sur la table et, timidement, elle a prit ma verge entre ses doigts potelés. Elle m’a interrogé du regard, de ce regard timide qui avait jusqu’alors évité la confrontation directe avec le mien. Je lui ai répondu par un sourire confiant. Elle s’est alors penchée sur mon sexe droit comme la tour de pise, ses lèvres se sont ouvertes sur mon gland encore recouvert de chantilly, et ses paupières se sont fermées sur ses yeux révulsés de plaisir. Christelle a sucé, ou plutôt tété mon gland comme un poupon gourmand pendant de longues secondes, que j’ai ressenties comme des minutes tant le plaisir qu’elle me procurait était vif, et il a fini par émerger, rouge et luisant comme une cerise gorgée de sucs, de son gouffre insatiable. C’était sans doute la première fois que l’objet de ses désirs gloutons en ressortait intact, voire même encore plus appétissant ! C’est à ce moment là qu’elle a ouvert les yeux pour plonger son regard dans le mien : ce n’était plus la gourmandise qui y brillait, c’était un brasier de luxure.
07:10 Publié dans Fictions | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : sept, péchés capitaux, la gourmandise, psychologie, fellation à la chantilly, femme ronde
23 juillet 2007
Sept: L’orgueil
 Non seulement Agnès venait de blesser mon orgueil de jeune mâle en me traitant d’enfant, mais elle me laissait en plan en ignorant mon unique argument : ma verge orgueilleusement dressée. J’ai traîné ma rage jusqu’aux cuisines où j’espérais trouver quelque chose à boire pour me rafraîchir les idées. Je suis tombé sur Lucienne qui préparait un énorme gâteau antillais.
Non seulement Agnès venait de blesser mon orgueil de jeune mâle en me traitant d’enfant, mais elle me laissait en plan en ignorant mon unique argument : ma verge orgueilleusement dressée. J’ai traîné ma rage jusqu’aux cuisines où j’espérais trouver quelque chose à boire pour me rafraîchir les idées. Je suis tombé sur Lucienne qui préparait un énorme gâteau antillais.
En héritant du château, Delavigne avait aussi hérité de son personnel qui se limitait à une seule personne, l’incontournable Lucienne. L’infatigable Martiniquaise employée là depuis plus de dix ans s’était révélée indispensable avec tout l’entretien qu’exigeait l’orgueilleuse bâtisse. La trentaine bien sonnée, la grande Lucienne illuminait la vieille demeure de son rire généreux, ainsi que de ses formes qui ne l’étaient pas moins. J’en ai eu un bel aperçu en arrivant dans la cuisine : un rouleau à pâtisserie en main, Lucienne étalait mollement de la pâte à tarte. Penchée en avant, je voyais ballotter ses gros seins libres de toute contrainte dans l’échancrure de son chemisier chamarré, tandis que par derrière, toute l’ampleur de sa croupe remplissait sa courte jupe : « Vous êtes venu me regarder travailler, monsieur Christophe ?
- Laissez tomber le Monsieur, Lucienne, vous me donnez l’impression d’être un souteneur ! Un petit coup de main ? »
Sans attendre sa réponse, je suis venu derrière elle, tout contre, et j’ai posé mes mains sur les siennes qui tenaient le rouleau à pâtisserie. D’abord interdite, Lucienne a continué d’étaler la pâte dans son mouvement langoureux. À chaque fois qu’elle se penchait en avant, mon buste venait frôler son dos, et la bosse qui n’avait pas quitté mon entrecuisse frottait contre ses reins cambrés. Plus la pâte s’étalait, plus les mouvements de Lucienne prenaient de l’ampleur, et plus les frottements de ma verge turgescente s'affirmaient dans la raie de son cul fabuleux. Je n’en étais encore tenu éloigné que par un peu de tissus, juste un voile qui me séparait de l’antre de ses trésors, de sa caverne d’Ali baba que je brûlais d’ouvrir de la pointe du gland. Notre petit jeu a continué jusqu’à ce que la pâte soit étalée sur toute l’étendue du plan de travail, plus fine que du papier à cigarette. « Vous me donnez chaud, Monsieur Christophe ! Je transpire de partout… partout…
- Moi aussi, vous me donnez chaud Lucienne ! » Je n’ai pas jugé bon d’en dire plus. J’ai lâché le rouleau pour attraper ses gros seins au travers de son corsage. Je les sentais peser dans la paume de mes mains comme des melons de Cavaillon. J’avais envie de les triturer comme la pâte à tarte. J’ai détaché quelques boutons pour glisser mes mains dans son chemisier. Sa peau était douce et chaude. De la pointe du doigt, j’ai étalé le filet de sueur qui serpentait entre les ballons de ses seins tel une source en Alsace. Lucienne s’est retournée d’un seul coup. Elle était toute dépoitraillée. Mes yeux admirèrent ses seins lourds et fermes, aux larges aréoles plus sombres que le reste de sa peau tabac, et dont les tétons pointaient fièrement. Contre la vitre de la cuisine vrombissait une abeille prise au piège. « Vous voulez que je vous rafraîchisse ? M’a-t-elle dit avec une lueur vicieuse dans le regard.
- Avec des yeux comme ça, je veux bien tout ce que vous voulez. »
Lucienne a récupéré une dizaine de glaçons à la porte du frigo américain dans un grand verre à coca. D’un geste sûr, elle a dégrafé ma ceinture, et déboutonné mon jean qui est tombé à mes pieds. Sans me quitter des yeux, elle a plongé sa main dans mon slip avec un sourire énigmatique. Ses doigts se sont refermés sur mon phallus tendu à l’extrême, ont agrippé mes couilles ramollies par la chaleur. Enfin, accroupie devant moi, Lucienne a lentement abaissé mon slip tout au long de mes cuisses. « Hmmmm… Jolie petite queue, m’a-t-elle dit. Bien dure en tous cas. Je vais vous faire durcir les couilles aussi, tu vas voir mon garçon ! ». Non seulement mon orgueil n’avait pas fini d’être mis à mal, mais joignant le geste à la parole, Lucienne a pris un glaçon dans le verre pour le plaquer sur mes testicules. J’ai serré les dents. La sensation était à la limite de la douleur, mais pas question de passer pour une chiche molle. Je ne me suis pas dégonflé, dans tous les sens du terme et d’ailleurs, mes couilles se sont vite rétractées pour la plus grande joie de ma tortionnaire. « Je les préfère comme ça, me dit-elle, comme des boules de glaces avec la banana split. D’ailleurs, c’est comme ça qu’elle va te déguster.
- Elle ?
- Allonge toi sur la table, et laisse toi faire ! »
07:25 Publié dans Fictions | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : sept, péchés capitaux, l’orgueil, antillaise, dans la cuisine, littérature
19 juillet 2007
Sept: L’envie
 Voilà 3 jours que j’étais chez les Delavigne, cerné par le papier à fleur, les horloges comtoises et les coucous suisses. Comment peut-on vivre dans une aussi belle maison décorée avec autant de mauvais goût, avec aussi belle femme honorée avec tant de mauvaise grâce, dans une région à la gastronomie aussi renommée et laisser sa propre fille se gaver de bonbons jusqu’à gonfler comme une baudruche ? Après avoir brossé en une seule phrase le tableau - et suggéré l’action - voici les détails où, comme chacun sait, se cache le diable.
Voilà 3 jours que j’étais chez les Delavigne, cerné par le papier à fleur, les horloges comtoises et les coucous suisses. Comment peut-on vivre dans une aussi belle maison décorée avec autant de mauvais goût, avec aussi belle femme honorée avec tant de mauvaise grâce, dans une région à la gastronomie aussi renommée et laisser sa propre fille se gaver de bonbons jusqu’à gonfler comme une baudruche ? Après avoir brossé en une seule phrase le tableau - et suggéré l’action - voici les détails où, comme chacun sait, se cache le diable.
C’est Monsieur Delavigne en personne qui m’avait réveillé après mon arrivée fracassante. Il m’avait trouvé en train de ronfler sur le volant de l’alpha dont le capot avait épousé la forme du tronc du prunier cinquantenaire. Le vieil arbre s’en était tiré avec quelques fruits écrasés, l’alpha était bonne pour la casse et moi pour quelques jours de repos avec un poignet foulé. C’est ainsi que je me suis retrouvé dans une chambre mansardée, aux bons soins de Madame Delavigne, jolie femme à la quarantaine éclatante, infirmière de son état et châtelaine dilettante. Laissez-moi, ami lecteur, dresser le portrait complaisant de ma bienfaitrice, telle qu’elle m’est apparue ce matin là, dans la chambre où Delavigne m’avait installé, ou plutôt telle que je l’ai dévisagée des pieds à la tête lorsqu’elle est apparue au seuil de ma chambre: Des chevilles fines, des mollets musclés nacrés de soie, une robe à fleurs légère qui soulignait la finesse de sa taille et la plénitude de ses hanches, une gorge pulpeuse dont le décolleté suggérait la profondeur du plaisir qu’on pouvait y trouver, des bras minces et dorés, un cou gracile tout au long duquel coulait la cascade noire de ses cheveux de jais qui encadraient son visage triangulaire aux pommettes saillantes, où luisaient le vert de ses yeux et le vermeille de ses lèvres au goût framboise, quoique cela, je ne le savais pas encore : « Bonjour ! Jean-Paul m’a dit que vous étiez un de ses étudiants de passage dans la région ? Je me présente, Agnès Delavigne.
- Enchanté, Christophe Vagant. Oui, je ne pensais pas m’arrêter très longtemps, mais je crains que ma voiture en ait décidé autrement.
- Et bien tant mieux, si vous me permettez mon égoïsme ! Moi, je suis ravie de vous accueillir chez nous. On ne voit jamais personne dans cette grande maison ennuyeuse. Je vais vous remettre sur pied, et vous redonner toute la vigueur de votre jeunesse !
- Je n’en doute pas un instant, Madame.
- Entre nous, appelez-moi Agnès.
- Avec plaisir… Agnès.
- À très bientôt Christophe. »
Si Agnès ne prenait pas son rôle de châtelaine au sérieux, il n’en était pas de même de son époux qui avait décidé de se reconvertir dans la viticulture. C’est ainsi que depuis des mois mon professeur en préretraite courait la campagne sept jours sur sept, de 6 heures du matin à 10 heures du soir. Il n’avait pas encore produit une seule goutte de vin mais le soir venu, notre brave homme était ivre, mais ivre de fatigue et il s’effondrait de sommeil parfois même avant d’avoir atteint son lit. Son comportement tenait-il de la fuite face à l’étreinte conjugale qu’Agnès appelait de tous ses vœux malgré l’inéluctable déclin glandulaire de son époux ? Peut-être bien, me dis-je aujourd’hui avec une sollicitude dont j’étais à l’époque incapable dans ma vingtaine arrogante. Moi, tout ce que je ressentais, c’était de la jalousie, de l’envie pour sa demeure seigneuriale abandonnée au mauvais goût, et pour sa jolie femme abandonnée aux caresses solitaires. Si lui voler la première m’était impossible, prendre la seconde était à ma portée.
L’occasion s’est donc présentée un après-midi particulièrement torride trois jours après mon arrivée. Je déambulais dans les couloirs du « château » à la recherche d’un peu de fraîcheur lorsque j’ai croisé Agnès, les joues rouges d’être surprise dans une tenue quelque peu indécente. Elle revenait de la cuisine avec un grand verre de glaçons à la main. Elle avait dû le passer sur ses bras et sur sa poitrine pour se rafraîchir un peu, mais les gouttes de condensation avaient laissé de larges auréoles transparentes sur sa robe à bretelles en coton blanc, dont une surlignait un téton bien dressé après le passage de la glace dans une zone si sensible. Je l’ai arrêtée au passage sous le prétexte de lui emprunter quelques glaçons. « Vous permettez Agnès ! » ai-je dit en retirant mon tee-shirt, et sans la quitter des yeux, j’ai fait courir un glaçon sur mon torse, insistant bien sur mes pectoraux et mes épaules, jusqu’à ce qu’il fonde complètement, laissant derrière lui une trace luisante et quelques gouttelettes qui perlaient sur ma peau bronzée. Face à moi Agnès, dont le visage virait à l’écarlate, semblait tétanisée. Seuls bougeaient ses yeux verts écarquillés qui couraient sur mon corps d’éphèbe tels deux petites bêtes traquées par un prédateur nommé désir. De temps à autres, la pointe de sa langue rose passait rapidement sur ses lèvres sèches, presque subrepticement comme pour échapper à ma bouche gourmande à quelques centimètres de la sienne. J’ai pris un autre glaçon dans le verre. « Vous permettez Agnès ? » ai-je dit en posant le glaçon sur son épaule sans lui laisser le temps de répondre, et je l’ai lentement fait glisser sur sa nuque. La réaction souhaitée ne s’est pas fait attendre : ses paupières ont vacillé, sa bouche s’est ouverte pour happer l’air qui semblait soudain lui manquer et sa poitrine s’est gonflée, les pointes de ses seins hérissées qui frôlaient ma peau. Mes lèvres sont parties à l’assaut des siennes comme une charge héroïque tandis que je l’étreignais fougueusement, abandonnant le glaçon dans sa robe. Il est tombé jusqu’au creux de ses reins, bloqué par ma main qui lui malaxait les fesses au travers de sa robe mouillée. Les mains d’Agnès, elles s’affolaient sur mon dos, agrippaient mes muscles saillants, griffaient ma peau, me repoussaient et m’attiraient contre elle dans un même mouvement éperdu. Dès que ma bouche abandonnait la sienne, juste le temps de lui laisser reprendre son souffle, la pauvre femme murmurait des « non… non… » avant que ma langue s’emmêle positivement dans la sienne Sa main droite, doigts en éventails et paume plaquée contre ma peau luisante de sueur, glissa tout au long de mon torse jusqu’à tomber sur la bosse outrageuse que formait ma verge gonflée dans mon jean… Soudain, Agnès m’a repoussé violemment contre le mur en criant « Non ! Je ne peux pas ! Pas avec un enfant ! », et elle a couru en larmes jusqu’à la porte de sa chambre qu’elle a claquée derrière elle.
07:15 Publié dans Fictions | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : sept, péchés capitaux, l’envie, femme mure, littérature, adultère
17 juillet 2007
Sept: La colère
 Août 1988. J’étais encore célibataire à cette époque là, mais j’avais une copine, Evelyne, une fille à papa à laquelle j’étais sérieusement accroché, enfin autant qu’on peut l’être à vingt ans. Pour fêter mon premier contrat d’embauche, je l’avais invitée avec toute notre bande d’amis inséparables - des copains de la fac désormais perdus de vue - autour d’une pizza dans un restaurant de la grande banlieue parisienne. Elle fut bien arrosée, cette pizza, et pas que d’huile pimentée, de sorte que nous étions tous passablement excités. Enfin presque tous sauf moi, car j’ai toujours eu un peu de mal à supporter le vin qui me fait systématiquement piquer du nez.
Août 1988. J’étais encore célibataire à cette époque là, mais j’avais une copine, Evelyne, une fille à papa à laquelle j’étais sérieusement accroché, enfin autant qu’on peut l’être à vingt ans. Pour fêter mon premier contrat d’embauche, je l’avais invitée avec toute notre bande d’amis inséparables - des copains de la fac désormais perdus de vue - autour d’une pizza dans un restaurant de la grande banlieue parisienne. Elle fut bien arrosée, cette pizza, et pas que d’huile pimentée, de sorte que nous étions tous passablement excités. Enfin presque tous sauf moi, car j’ai toujours eu un peu de mal à supporter le vin qui me fait systématiquement piquer du nez.
Quand je l’ai relevé de mon assiette, les copains commençaient à lever le camp pour aller investir une boite de nuit : "Où est Evelyne ? Ai-je demandé à Paul face à moi.
- Aux toilettes, je crois, m’a-t-il répondu.
- Tu peux garder un œil sur mes affaires, je crois que je vais y aller aussi !
- Pas de problème Christophe."
Les toilettes étaient mixtes. Il n’y avait que deux cabines dont une seule de libre. Pendant que je m'y soulageais la vessie, j’ai entendu un soupir provenant de celle d’à côté. Ce n’était pas le genre de soupir qu’on lâche au cours des efforts qu’on est censé faire en ces lieux. En tendant l’oreille, j’ai eu la nette impression qu’il n’y avait pas une mais deux voix qui provenaient de cette cabine : une voix d’homme, et une voix de femme. En écoutant avec encore un peu plus d’attention, il m’a bien semblé reconnaître celles d’Alain et de Djamila ! Ah, Djamila ! Elle cachait donc bien son jeu, la coquine, sous ses airs de musulmane effarouchée. Quant à Alain, cela ne m’étonnait pas du tout de lui.
Toujours est-il que leurs murmures explicites qui montaient crescendo commençaient à m’exciter sérieusement, et j’ai eu l’irrépressible envie de me rincer l’œil. J’ai précautionneusement posé mes pieds sur le rebord de la cuvette, je suis monté dessus en prenant garde de ne pas glisser, afin de les mater par-dessus la cloison de séparation à l’aide d’un miroir que j’avais toujours sur moi à cette époque. Oui, je dois l’avouer, ça aussi : j’étais un maniaque de la raie rectiligne, bien au milieu du crâne. Pour avoir une vue plongeante, on peut dire je l’ai eue. Une vue à tomber à la renverse: La fille avait tout de la pornstar dans l’attente du cliché choc : Jambes tendues à la verticale, ouvertes comme un compas sur une carte de marine, elle était penchée en avant, le dos à l’horizontal et les mains accrochés aux les bords de la cuvette pour maintenir sa position. Ses fesses cambrées émergeaient de sa robe bleue troussée jusqu’à la taille, telles deux atolls de sable blanc dans les vagues du Pacifique. Sauf que le clapotis n’était pas celui des vaguelettes qui agonisent sur une plage. C’était celui de sa chatte au mouillage sous les assauts d’une verge, ou plutot une vergue épaisse comme bitte d’amarrage, longue comme le beaupré d’un brick qui lui emboutissait la poupe après lui avoir fendu l’étrave : un shorty pourpre pour ultime entrave, d’un ensemble en dentelle de chez Charmel pour lequel j’avais claqué une bonne partie de ma première paye ! L’image était floue, ma main tremblait. J’ai perçu le sourire béat du corsaire, sabre au clair, son visage renversé en arrière, ravagé par l’orgasme, et j’ai croisé son regard quand il a refait surface. « Merde ! est-il seulement parvenu à articuler en voyant mes yeux fous dans mon miroir de poche.
- Que se passe-t-il Alain ? Tu as encore déchiré le préservatif ? a soupiré Evelyne en se tournant vers lui.
- Non, pire. "
Je n’ai pas écouté la suite de leurs atermoiements. Je me suis rué à l’extérieur des toilettes avec une envie de tuer. De retour à la table, j’ai vidé le contenu du sac à main d’Evelyne sur les restes de la pizza. J’ai récupéré entre deux olives les clefs de son coupé Alfa-Roméo que « papa » venait de lui offrir pour son anniversaire. Quand je l’ai entendue arriver derrière moi en me disant qu’elle allait m’expliquer, je l’ai allongée d’une gifle sur la table, au milieu des assiettes sales. Moi, je n’avais pas d’autre explication à donner alors je suis sorti sur le parking. J’ai visé le coupé Alfa flambant neuf. J’ai démarré en trombe histoire de le roder, et je suis parti n’importe où mais ailleurs. Sur l’autoroute, entre 180 et 200, je me suis souvenu d’un prof de la fac qui avait hérité d’un petit « château » dans le bordelais : Mr Delavigne, un nom prédestiné. Je ne sais pas trop pourquoi il s’était pris d’amitié pour moi, mais il m’avait proposé de venir le voir dans sa propriété viticole si je passais dans la région cet été là. J’y étais au petit matin.
Devant le portail de sa propriété, aussi gironde que girondine, je n’ai pas eu le cœur de réveiller les Delavigne aussi tôt, mais après avoir passé quatre heures dans la voiture d’Evelyne à respirer son parfum – elle portait un parfum très cher qui collait à tout ce qui lui appartenait – je ne pouvais plus la supporter. J’ai repéré un vieux prunier au bord de l’allée de gravillons blancs qui menait au portail. Avec ce qui me restait de lucidité, j’ai évalué la vitesse qu’il me faudrait atteindre pour y planter l’Alfa sans me faire trop mal en sautant en marche. Du coup, il ne m’en restait plus pour penser à détacher ma ceinture de sécurité avant, et j’ai perdu connaissance en m’encastrant dans l’arbre.
À suivre…
07:25 Publié dans Fictions | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : Sept, Histoire Erotique, Péchés Capitaux, la Colère, dans les toilettes d’un restaurant, Littérature, Adultère






