22 avril 2014
Du triolisme
07:13 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : triolisme, aphorisme
10 avril 2014
Mise au point - 2
Estrella Mar
Pluginude
avril 2014
Photographie couleurÀ l’origine de cette série, il y a une véritable volonté de l’artiste de mettre en valeur le nu masculin en évitant tout à la fois la virilité du nu héroïque et le corps dans sa dimension sexuelle voire pornographique. Nous sommes donc loin des clichés habituels de corps musculeux ou asexués tels qu’on peut les voir dans les magazines de mode. Le parti-pris est clair : photographier les hommes, dans leur nudité la plus élémentaire, sans fioritures et sans érotisme sous-jacent.
La forêt offre un décor naturel avec le sol jonché de feuilles au premier plan, tandis que des arbres se dressent à l’arrière-plan. Au centre de la composition, un homme nu git sur deux troncs d’arbres fraichement coupés. Le corps est en tension, voire en torsion comme l’indiquent l’épaule droite légèrement relevée et le muscle de la cuisse, bandé. La pose diffère peu des académies chères aux étudiants des Beaux-arts. Ce corps s’intègre parfaitement aux éléments qui l’entourent ne serait-ce que parce qu’il épouse la ligne d’horizon rythmée par les arbres.
On ne peut regarder cette œuvre sans penser à Rodin et à ses naïades qui se fondent dans le bloc de marbre. Ici, il n’est cependant pas question de volupté. Thanatos ne semble pas plus représenté qu’Éros puisque le gisant n’a rien d’une victime présentant son cou au bourreau. Dans le plus simple appareil, à la fois fort et fragile, l’homme se fait offrande. Ce ne sera ni un bouquet, ni un banquet mais bel et bien son corps nu enté sur le tronc d’arbre. Il s’abandonne dans un élan vitaliste. Ses bras et ses jambes enserrent le tronc telle une étreinte, une caresse où la chair se fait jeune pousse. Loin de s’opposer la rude écorce moussue et la peau quasi marmoréenne de l’homme ne font qu’un. Entre l’homme et la nature, plus de lutte mais un moment de grâce et d’harmonie.
Finalement, n’est-ce pas ici le premier homme qu’on retrouve, un Adam avant la chute dans son home des bois ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~
 Nu, suspendu entre ciel et terre, je voyais les arbres couchés en rangs serrés.
Nu, suspendu entre ciel et terre, je voyais les arbres couchés en rangs serrés.
Nu, branche incongrue d’une souche amputée, poussé là pour elle.
Nu, presque en hiver, elle au printemps.
Dans cette notice de musée facétieuse, Mathilde analyse avec justesse l’objectif de l’artiste et esquisse avec finesse mes motivations profondes de modèle : ces photos sont bien une offrande. À l’orée de la cinquantaine, objectivement sur le déclin, je m’étais dit que cette séance était une des dernières occasions d’avoir une photo de moi de qualité, où mon corps nu ne serait pas grotesque, afin de lui en offrir un tirage en souvenir de moi, en souvenir de nous. En voyant la pose académique, j’ai immédiatement pensé à Rodin et Claudel, et mes souvenirs m’ont projeté sept ans auparavant, au musée d’Orsay le jour de notre premier rendez-vous devant « l’âge mur ». J’avais alors été frappé par les stigmates de l’âge qui caractérisaient la représentation de cet homme, en opposition à la fraicheur de la jeune fille implorante à ses pieds. Une rencontre à l’aune du temps qui passe. Ces stigmates, je les vois aujourd’hui bourgeonner sur cette jambe qui semble pousser sur le tronc malgré la bienveillance de l’artiste qui aura su m’épargner les clichés les moins flatteurs.
Je ne m’embourberai pas davantage dans un apitoiement dramaturgique mais soulignerai la gentillesse et le sérieux de Véronique alias Estrella Mar. Pour poursuivre son projet sur le nu masculin, elle recherche des modèles amateurs, de tout âge et de tout type physique, qui pourront lui accorder quelques heures pour des prises de vue dans la nature en Ile de France. Avec elle, naturisme ne rime pas avec érotisme mais s’attache à la racine du mot pour nous montrer des corps au naturel, et nous affranchir des stéréotypes photoshopés, comme Véronique le dit si bien elle-même : « Toutes ces petites imperfections font toute l'humanité d'un corps, le touchant du vécu, du temps aussi, bien sûr. Ce n'est pas évident de se voir nu à travers le prisme d'une photo, de se confronter à sa propre image mais je trouve qu’il y a quelque chose de sain dans cette confrontation, on finit par arriver à une bienveillance sur son propre corps ». À méditer ; à (se) poser.
22:13 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (23) | Tags : mise au point, photo, mathilde
09 février 2014
Mise au point - 1
Je m’interroge parfois sur la nature de ma liaison avec Mathilde (dont le prénom d’emprunt pourrait changer au gré de ses désirs), et cette interrogation en a dernièrement rejoint une autre relative au sous-titre de ce blog qui, à première vue, pourrait paraitre inadéquat, alors qu’il n’a probablement jamais été aussi approprié.
Faisons le point. En une quinzaine d’années d’infidélité assumée, j’ai connu bien des femmes. J’en ai évoquées quelques-unes sur ce blog: Ninon, Carole, Marianne, Nathalie, Fabienne, Céline, Coralie, Jeanne, Sarah, Catherine, Claire, Justine, Léone, Sylvie, Roxane… liste non exhaustive par ordre vaguement chronologique où l’anecdotique côtoie les relations marquantes. Menais-je alors une double vie ? Oui, dans une certaine mesure, mais pas une double vie accomplie. Plutôt une succession de double vies avortées. Les liaisons que j’ai citées étaient d’abord sensuelles puis amicales et/ou amoureuses. Le sexe était donc au premier plan, comme c’est souvent le cas au début d’une liaison intime. Le désir mène la danse et la danse s’arrête avec la musique, lorsque chacun reprend son rythme. Moi, je vivais dans le rythme effréné des découvertes sensuelles, tout à l’ivresse de la séduction, car je jouissais déjà à la maison du « bonheur conjugal ». Toutes mes partenaires n’avaient toutefois pas les mêmes attentes que moi : toutes n’avaient pas un conjoint, et celles qui en avaient déjà un ne souhaitaient pas forcément le garder. Il faut beaucoup d’amour pour que la musique continue malgré des aspirations désaccordées.
J’avais cité quelques paragraphes de « Double vie », de Pierre Assouline. L’auteur y fait une description dramatique de la liaison adultérine de deux amants qui prennent mille précautions pour ne pas se faire prendre :
Rémi arriva comme convenu à treize heure vingt. Quel que fût le restaurant, ils avaient pris l’habitude de décaler d’une vingtaine de minutes leur rendez-vous sur l’horaire habituel des repas afin que la plupart des clients soient déjà installés. Ainsi, entrant dans l’établissement l’un après l’autre, chacun avait le loisir de balayer la salle d’un regard panoramique pour y repérer un éventuel danger et, le cas échéant, s’en retourner aussitôt. Séparément. Car rien ne les glaçait comme la perspective d’être vus ensemble. Non qu’ils n’aient pas assez d’imagination pour échafauder un scénario cohérent. Mais quelle que fût sa pertinence, leur rencontre hors des cadres habituels de la mondanité instillerait le soupçon de part et d’autre. Le poison du doute rongerait leurs couples. Dans le meilleur des cas, cela passerait une fois, pas deux. Il ne fallait pas gâcher cette carte. Pour futile qu’elle pût paraitre, une telle préoccupation n’était pas moins vitale à leurs yeux. Elle avait suscité de nouveaux réflexes, appelés à devenir naturels par la force des choses. Ainsi, outre ce regard circulaire qui se voulait légèrement scrutateur, ils avaient l’habitude, en pénétrant dans un restaurant, de passer en revue, avec une discrétion éprouvée, les noms inscrits sur la page des réservations du grand agenda. Juste pour voir s’ils se trouvaient en terrain de connaissance. Ce que c’est de s’aimer quand on est mariés, mais pas ensemble.
Je n’ai jamais vécu l’adultère avec de telles angoisses. Ce n’est pas une vie, tout au plus une fraction, la portion congrue. Même auprès de mes anciennes amantes, j’ai bien plus profité de la vie que Rémi et Victoria n’en jouisse dans ce roman. Que dire alors de ce que je vis avec Mathilde ? En sept ans de vie parallèle commune, nous avons connu main dans la main Londres, Copenhague, Amsterdam, Rome, Istanbul, Venise, Bruxelles… liste non exhaustive par ordre vaguement chronologique où nous nous sommes tendrement aimés. Est-ce là une double vie ? Oui, certainement, plus encore qu’auparavant, une double vie accomplie avec des souvenirs qui pourraient appartenir aux petits bonheurs de la conjugalité, comme la découverte de la posada del dragon qui a enchanté nos palais à Madrid.

Toutefois, n’allez pas croire que la salade de tomate, aussi délicieuse fût-elle, soit l’épicentre de notre vie sensuelle. Disons qu’elle en fait aussi partie, tout comme les huitres à la Casanova et d’autres délices amoureux à huis clos… Entre nous, l’idylle renait toujours des cendres de nos sens embrasés.
23:50 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : mathilde, pierre assouline, double vie, littérature, livre, adultère, posada del dragon
03 février 2014
L’homme trophée 3 – le coup de grâce
Assis dans un café à côté de Judith, l’ordinateur portable posé face à eux sur la table, Thomas termine les deux premiers chapitres de cette histoire. Judith avait d’abord été contrariée que Thomas, son vieil amant, s’emparât de sa malheureuse liaison avec Victor, pour décrire une vengeance qui n’aurait jamais lieu. Elle reconnaissait dans cette fable des portions de vérité, mais enchâssées dans une trame romanesque dont elle n’aurait jamais pu tenir le premier rôle. Sa liaison avec Victor était toute fraîche, et elle n’avait pas rompu officiellement avec lui. Comment l’aurait-elle pu alors qu’elle n’était officiellement qu’un sex friend dans le meilleur des cas. « Comment veux-tu que je sorte de ta vie, puisque je n’y suis pas ! » lui aurait-il certainement rétorqué si elle s’était avisée de rompre en bonne et due forme. Ainsi la fable de Thomas était un succédanée de rupture qui permettait à Julie d’éviter un affront de plus, et de prendre un peu de distance vis-à-vis de cette relation nocive. Sans avoir besoin de l’écrire explicitement, Thomas s’était attribué le beau rôle de l’inconnu, et il se vengeait ainsi de son rival qu’il savait bien plus jeune et qu’il imaginait bien plus beau. En partageant ce fantasme avec Judith, il espérait ridiculiser Victor dans l’esprit de son amante afin qu’elle l’oublie définitivement.
En fin de compte, Judith finit par s’amuser de la fable de Thomas, remanie les SMS selon le style lapidaire que Victor avait institué, et rebaptise tous les intervenants : Ludivine fait bonne copine, Victor serait victorieux, et Judith évoque l’héroïne de l’Ancien Testament immortalisée par un tableau du Caravage où elle décapite Holopherne.
 Selon le récit biblique, le général Holopherne, envoyé par Nabuchodonosor II pour massacrer tout le proche Orient, est arrêté à Béthulie. Il assiège la ville qui est sur le point de se rendre, quand une habitante entreprend un acte héroïque. Seule avec sa servante et des cruches de vin, elle pénètre dans le camp d’Holopherne, qui est immédiatement ensorcelé par la beauté et l’intelligence de Judith. Il organise un banquet en l’honneur de cette femme qui, une fois que les domestiques se sont retirés et qu’Holopherne est complètement ivre, le décapite sans autre forme de procès. La Judith biblique s’enfuie alors du camp avec la tête d’Holopherne pour trophée, tout comme la Judith de Thomas quitte l’Overside après avoir tué son désir pour Victor, l’homme trophée.
Selon le récit biblique, le général Holopherne, envoyé par Nabuchodonosor II pour massacrer tout le proche Orient, est arrêté à Béthulie. Il assiège la ville qui est sur le point de se rendre, quand une habitante entreprend un acte héroïque. Seule avec sa servante et des cruches de vin, elle pénètre dans le camp d’Holopherne, qui est immédiatement ensorcelé par la beauté et l’intelligence de Judith. Il organise un banquet en l’honneur de cette femme qui, une fois que les domestiques se sont retirés et qu’Holopherne est complètement ivre, le décapite sans autre forme de procès. La Judith biblique s’enfuie alors du camp avec la tête d’Holopherne pour trophée, tout comme la Judith de Thomas quitte l’Overside après avoir tué son désir pour Victor, l’homme trophée.
Ravis du fruit illégitime de leur union littéraire, Judith propose à Thomas de terminer la soirée dans un club libertin parisien, Le Mask, où ils pourront assouvir leurs désirs depuis trop longtemps frustrés. Quelques couples sont déjà là, accoudés au bar, d’autres sur les banquettes des alcôves du fond, où des tables basses permettent de poser son verre avant de s’abandonner à d’autres douceurs. Après avoir fait le tour du club, Judith et Thomas s’asseyent confortablement dans ces coins câlins de plus en plus bondés qui permettent tous les ébats. Pour eux, ce serait plutôt tous les débats, car l’ombre de Victor qui les a suivis depuis le café est toujours là.
Confortablement blottie dans les bras de Thomas, dont la petite fable a remué de douloureux souvenirs dans l’esprit de Judith, elle évoque ses doutes et ses frustrations, lui explique combien elle a eu besoin de simple tendresse, tandis qu’elle livrait son corps au sexe sans état d’âme avec Victor. Tendrement enlacée à Thomas, dont la position ne lui permet que de toucher les seins de Judith, elle revit intérieurement sa liaison délétère avec Victor, qui fut pour Thomas source de frustration et d’incompréhension puisqu’il n’en avait pas connaissance. Dégoutée du sexe brut avec Victor, elle ne pouvait plus offrir à Thomas qu’un amour épuré de la sexualité, qu’elle réduisait avec lui à sa plus simple expression quand elle ne fuyait pas dans le sommeil dès qu’ils étaient enlacés. Ainsi les corps alanguis qui se vautrent tout autour d’eux dans la luxure illustrent cette baise dégoûtante tandis qu’elle s’assoupit dans les bras de son tendre amant. À force de céder sur les mots, on finit par céder sur la chose. Pour ce crétin de Thomas à la verge désespérément dressée, la réalité a rejoint la fiction, sauf qu’au lieu d’être l’artisan d’une vengeance, il en est la victime face à Victor le bien nommé. Judith l’a bel et bien attiré dans un club libertin pour le frustrer dans les bras d’un vieux rival : Morphée !
La morale de cette histoire, à l’usage des machos soucieux d’arriver à leurs fins avec les femmes, c’est Kundera qui nous la donne dans Le livre du rire et de l’oubli :
Le regard de l’homme a déjà été souvent décrit. Il se pose froidement sur la femme, paraît-il, comme s’il la mesurait, la pesait, l’évaluait, la choisissait, autrement dit comme s’il la changeait en chose.
Ce qu’on sait moins, c’est que la femme n’est pas tout à fait désarmée contre ce regard. Si elle est changée en chose, elle observe donc l’homme avec le regard d’une chose. C’est comme si le marteau avait soudain des yeux et observait fixement le maçon qui s’en sert pour enfoncer un clou. Le maçon voit le regard mauvais du marteau, il perd son assurance et se donne un coup sur le pouce.
Le maçon est le maitre du marteau, pourtant c’est le marteau qui a l’avantage sur le maçon, parce que l’outil sait exactement comment il doit être manié, tandis que celui qui le manie ne peut le savoir qu’à peu près.
Le pouvoir de regarder change le marteau en être vivant, mais le brave maçon doit soutenir son regard insolent et, d’une main ferme, le changer de nouveau en chose. On dit que la femme vit ainsi un mouvement cosmique vers le haut puis vers le bas : l’essor d’une chose se muant en créature et la chute d’une créature se muant en chose.
08:06 Publié dans Fictions, Réflexions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : homme trophée, libertinage, mask, kundera
15 août 2008
Mon plus secret conseil…
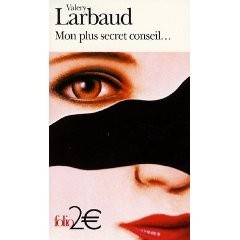 Ce titre est épatant, n’est-ce pas ? Moi en tous cas, c’est épaté que je me suis fait appâter par ce roman de Valéry Larbaud publié aux éditions folio, d’autant plus qu’il ne coûtait que deux petits euros. Le prix d’un café. Je croyais ne faire qu’une gorgée de sa centaine de pages, mais j’ai eu bien du mal à avaler cette prose décousue qui serpente au fil des pensées de Lucas Letheil, jeune héritier prétentieux jusqu’aux prétentions littéraires. Il envisage de quitter sa maîtresse colérique. Il ne sait pas que c’est imminent lorsqu’il s’éloigne de leur résidence Napolitaine au cours de sa promenade matinale, qu’il pousse jusqu’à sauter dans le premier train venu. Larbaud y embarque aussi le pauvre lecteur contraint de passer du Français à l’Italien dans cette aventure intérieure. On ne sait d’ailleurs pas trop si l’auteur parle de lui ou de son anti-héros puisqu’il utilise tantôt « je », tantôt « il » et parfois « nous ». Nous en sommes d’ailleurs là dans cet extrait plus que représentatif puisque c’est, à mon humble avis, la meilleure page :
Ce titre est épatant, n’est-ce pas ? Moi en tous cas, c’est épaté que je me suis fait appâter par ce roman de Valéry Larbaud publié aux éditions folio, d’autant plus qu’il ne coûtait que deux petits euros. Le prix d’un café. Je croyais ne faire qu’une gorgée de sa centaine de pages, mais j’ai eu bien du mal à avaler cette prose décousue qui serpente au fil des pensées de Lucas Letheil, jeune héritier prétentieux jusqu’aux prétentions littéraires. Il envisage de quitter sa maîtresse colérique. Il ne sait pas que c’est imminent lorsqu’il s’éloigne de leur résidence Napolitaine au cours de sa promenade matinale, qu’il pousse jusqu’à sauter dans le premier train venu. Larbaud y embarque aussi le pauvre lecteur contraint de passer du Français à l’Italien dans cette aventure intérieure. On ne sait d’ailleurs pas trop si l’auteur parle de lui ou de son anti-héros puisqu’il utilise tantôt « je », tantôt « il » et parfois « nous ». Nous en sommes d’ailleurs là dans cet extrait plus que représentatif puisque c’est, à mon humble avis, la meilleure page :
On dira que nous sommes bien difficile ; mais c’est que, si nous sommes repu de scènes de ménage et de tempêtes domestiques, nous sommes aussi repu
Persano.
d’amour. Onze heure moins dix. On va s’arrêter partout maintenant. La ligne monte. Il n’y a plus que de petites gares jusqu’à Potenza ; pas de voyageurs de première. Et les monts de la Lucanie en vue. Des arrêts de trois secondes ; le temps de dire pronti et partenza. – Oui, repu d’amour, malgré l’insensibilité croissante. Et c’est cela qui retarde la rupture, qui nous fait espérer, contre toute espérance, que la dernière crise sera vraiment la dernière. Nous sommes fidèle, aussi. Voici une bien jolie femme ; sans doute, mais nous avons mieux, ou aussi bien à la maison. Des Challettes, lui, court toujours ; il a une liste de formules d’abordage, pour la rue, le théâtre, la plate-forme du tramway… ; a des cartes de visite, avec cette anticipation : « Avocat à la Cour », qu’il glisse, pliées en quatre, dans les mains des jeunes filles et des jeunes femmes accompagnées. J’ai fait ça, autrefois, par esprit d’imitation, quand je sortais avec… Chose… de Louis-Le-Grand. Nous avions l’air de deux agents matrimoniaux, de deux délégués à l’amour. Les premiers venus offrant leurs services aux premières venues. Quelle fatigue !... Quel ennui !... Pourtant si on m’avait demandé ce que je cherchais pendant mes promenades du matin dans Naples, une fois le contact bien établi avec les aspects intimes de la ville, j’aurais – paresse, peur de paraître compliqué – répondu : des femmes.
Enfin, lorsque ce roman s'achève sur l’assoupissement de Lucas, on comprend que sa vocation était sans doute d’être un livre de chevet.
23:09 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Mon plus secret conseil, Larbaud, Livres, Littérature, rupture
10 juillet 2008
Dieu dans la tête de Voltaire

- Que vois-tu ?
- Deux religieuses. Elles passent sous la voûte d’une porte qui se découpe à l’horizon. Et puis des femmes.
- Rien d’autre ?
- Tu sais, moi et l’art, ça fait deux. Surtout le surréalisme, je n’y comprends rien…
- Fais un effort ! Tu ne vois rien d’autre dans la voûte ?
- Non !
- Mais si regarde ! ici les yeux ! là le nez ! C’est la tête de Voltaire !
- Ah oui ! C’est rigolo, maintenant je ne vois plus que lui. J’ai même du mal à distinguer les têtes des religieuses dans ses yeux.
- Et bien tu vois, la main de Dieu, c’est pareil.
- Pardon ?
- Une fois qu’on a perçu Sa main, on ne voit plus qu’elle. Rien n’est plus anodin, tout participe à une œuvre aussi imperceptible qu’omniprésente. Dieu est partout, dans les plus petites choses comme dans les plus grande. Même la religion, cette religion représentée par les deux religieuses, s’efface tout en composant Son œuvre…
- Tu racontes vraiment n’importe quoi Vagant. Tu vois Dieu dans la tête d’un athée notoire maintenant ? Mais c’est grotesque mon vieux. Regarde-moi là au lieu de divaguer. J’ai dit là !
- C’est toi qui es grotesque d’obscénité avec tes cuisses écartées !
- En tous cas, tu as tout de suite vu ce qu’il y avait à voir entre mes cuisses : non pas l’innocente nudité mais l’obscénité sexuelle. Allez, ne fait pas ton Tartuffe, serait-ce encore ton Dieu que tu as vu là, dans ce… calice ?
- Tais-toi !
- « On façonne l’argile pour en faire des vases, mais c’est du vide interne que dépend leur usage. L’Être donne des possibilités, c’est par le Non-Être qu’on les utilise. » Oh ce n’est pas de moi, c’est de Lao-tseu. Après t’être vautré dans la luxure, tu es désormais condamné à ne plus jamais voir dans les femmes que des trous à combler. Allez, viens me baiser maintenant !
- Arrière Satan !
15:30 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : Dali, Dieu, Voltaire, Lao-tseu, Foi
11 avril 2008
Un vague amant (7)
Gatwick, Vendredi après midi. Londres n'intéresse plus Ninon. Faute de chambre pour abriter nos ébats, nous décidons de passer la journée à surfer dans un cyber café de l’aéroport, comme deux drogués au net. Nous finissons par dévoiler quelques secrets d’alcôve virtuelle. En vérité, je n’ai presque rien à cacher, et je ne lui montre qu’un bout de correspondance avec une relation épistolaire qui sait tout de cette escapade londonienne. Cela semble l’amuser, mais pas autant que de m’ouvrir sa messagerie, de me dévoiler son carnet d’adresse caramail en direct, histoire de me montrer ce qu’une fille décidée peut faire. À peine s’est elle connectée, qu’une cascade de fenêtres de dialogue s’ouvre à l’écran. Je suis sidéré de la voir draguer sous mes yeux, et sélectionner sans état d’âme ses camarades de jeu pour son prochain week-end.
Entre deux dialogues, elle me demande si je ne pourrais pas lui établir une fausse facture, ce qui lui permettrait de passer ses dépenses Londoniennes en note de frais. Notre liaison vient de passer par pertes et profits. Je ne suis plus qu’une affaire classée à son passif. J’ai compris, amer mais fair play, que je n'aurai guère été que l'amant d'une soirée. Un one shot qui n’offre plus d’intérêt après l'excitation de la découverte. Elle est avide de reprendre son exploration, exploration des sens tous azimuts et des êtres en tous genres, exploration à coeur et corps perdus. Un périple où je n’aurai été qu'une escale.
Je plaisante pour faire bonne figure et cacher mon vague à l’âme. Ce n’est certainement pas un chagrin d’amour, non, juste une blessure d’amour propre. Après tout, qu'avais-je bien osé espérer ? Je ne suis pas le grand et beau jeune libertin qu'elle recherche pour la guider dans ses errances sexuelles. Elle a d’ailleurs bien plus d’expérience que moi dans ce domaine. De l’expérience, moi, je n’ai que l’âge. Pourtant, malgré tous mes efforts pour rationaliser, j’ai un pincement au cœur, et un peu peur pour elle.
06:30 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (18) | Tags : Un vague amant, ninon, Adultère, Expériences, Littérature
09 avril 2008
Un vague amant (6)
Gatwick au petit matin. Ninon est encore endormie. Ma main flotte sur son pubis, s'enfonce dans sa forêt soyeuse, explore son intimité tranquille. Mon doigt glisse sur sa vulve, entre ses lèvres, tout doucement, dans un lent va et vient. Chaque phalange de mon doigt effleure son clitoris quand il plonge en elle. Dans son demi sommeil, Ninon soupire d'aise, ouvre les cuisses à ma caresse. Mais ma main continue patiemment, sans s'affoler, confiante de détenir enfin la clef de son plaisir. Ma caresse se fait plus profonde, plus pénétrante, mais toujours aussi légère quand, au reflux, mon doigt mouillé titille son clitoris incrusté entre les plis de ses chairs. Ses gémissements de plaisir confirment mon intuition. Réveillée pour de bon, elle m'attire entre ses cuisses. Je caresse son visage, elle suce mon doigt, j'ai compris le message : à ma langue de poursuivre. Elle décharge son orgasme dans ma bouche avide de jouissance.
Si ma bouche est gourmande, la sienne est savante : c’est avec ses lèvres qu’elle enfile mon préservatif. Elle me demande de la prendre tout de suite, en levrette. Je m’apprête à la pénétrer doucement quand elle s'empale d'un coup de reins. C’est elle qui mène la danse en me guidant par la verge, balançant ses hanches au rythme de son plaisir, un coup à droite, un coup à gauche. Elle a le cul rock’n’roll. Elle me baise gaiement, c'est délicieux et j’en ris, d'un rire enfantin en découvrant comment elle me fait l'amour. C’est si ludique, avec une sensualité si différente de celle à laquelle j’ai trop l’habitude. En changeant de femme, j’ai l’impression de perdre un nouveau pucelage.
Je reprends la main d’une claque sur ses fesses. Je glisse un doigt dans son anus, pour sentir mon phallus à travers elle. Pour la première fois, je touche du doigt les sensations que peuvent procurer le va et vient de mon sexe, de plus en plus rapide, de plus en plus profond, là où j'explose.
06:15 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (18) | Tags : Un vague amant, Erotisme, ninon, Adultère, levrette, récit érotique, Expériences
07 avril 2008
Un vague amant (5)
Gatwick, en pleine nuit. Nous rentrons enfin au Bed & Breakfast après une épuisante odyssée ferroviaire. Arrivés dans la chambre à la fois kitch et cosy, en un mot british, nous décidons qu’un petit massage nous fera le plus grand bien.
Quand je sors de la douche, vêtu d'une simple serviette autour de la taille, Ninon est déjà étendue sur le ventre dans la même tenue. Elle me propose d'abord de "faire la crêpe", selon son expression, et puis nous inverserons les rôles. J'étale l'huile de massage parfumée sur son dos. Elle soupire au contact du liquide froid, soupirs d'aise lorsque je commence à étreindre ses épaules, sa nuque, massant systématiquement chaque vertèbre, descendant de plus en plus bas, jusqu'au coccyx, avant de remonter le long de ses flancs, pour recommencer encore et encore. Ensuite je masse langoureusement ses jambes, ses mollets, ses cuisses, toujours plus haut. Je finis par ôter la serviette pour masser ses fesses rondes et fermes. Je les malaxe à pleines mains, découvrant à l’envie son oeillet rosacé à chaque fois que j’ouvre sa croupe. Je me demande si je vais y connaître pour la première fois les joies de la sodomie. Comme elle se cambre, je vois même sa petite forêt grise qui envahit son intimité lippue. Je n'irai pas plus loin.
Rétrospectivement, je réalise en écrivant ces lignes que j'aurais dû masser la vulve qu'elle me tendait. Mes gestes n'ont pas coulé comme ils auraient dû, dans le tempo du désir.
Comme convenu, elle me prodigue un délicieux massage où elle étale autant d’huile que de talent. À sa demande je lui masse longuement les pieds, et finalement, ma langue maladroite s’aventure dans son intimité.
- Tu connais la rape à fromage ? me demande-t-elle en rigolant.
- C’est une position du kamasoutra ?
- Non, c’est l’impression que me donnent tes poils de barbe contre ma vulve.
- Ah ! Désolé… il est tard, ça a poussé depuis ce matin…
- Tu ne veux pas te raser ?
- Si… j’y vais.
Quand je reviens de la salle de bain, l’ambiance est un poil retombée. Nous nous caressons mutuellement et je finis par la prendre, bêtement, en missionnaire. Je jouis tout seul, comme un con. Elle s'endormira dans mes bras sans que j’aie su lui donner le plaisir attendu.
07:00 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : Un vague amant, Erotisme, ninon, Adultère, massage, récit érotique, Expériences
05 avril 2008
Un vague amant (4)
Shoreditch, 21h. La devanture du Metropolis plaquée sur une terne façade de brique rouge me fait penser à un string à paillettes sur les fesses d’une vieille dame. Immanquable. À peine avons-nous franchi le sas d'entrée de cette boîte de strip-tease, que nos yeux sont captivés par une rousse sculpturale dont la nudité est offerte à des dizaines de regards blasés.
Ninon, subjuguée, prend ses quartiers devant la scène pour ne plus en bouger, pendant que je lutte parmi des yuppies en costume pour récupérer deux bières. Je la rejoins pour contempler les effeuillages dont la variété me laisse pantois : lascifs ou acrobatiques, érotiques ou esthétiques, aussi variés que les beautés qui se succèdent sans répit, ils suscitent nos commentaires goguenards ou admiratifs, qualifiant la courbe d'un sein, le galbe d'une cuisse, le grain d'une peau, la souplesse des reins ou les poses suggestives. Ces numéros confortent Ninon dans sa bisexualité, d'autant plus que toutes les artistes la gratifient d'un sourire dont l’apparente complicité masque bien leurs attentes commerciales.
Nous sommes particulièrement impressionnés par une métisse au corps de liane, qui effectue un strip-tease acrobatique digne d'un programme de gymnastique, virevoltant autour d'une barre verticale promue au rang d'agrès, mais qui me suggère plus d'émotions esthétiques qu'érotiques, et davantage d'admiration que d'excitation. Nous ne la quittons pas des yeux alors qu'elle quitte la scène dans l'indifférence générale. Quelques instants plus tard, elle vient nous saluer et nous propose une séance de table dance. « OH YES ! » s'écrie Ninon avec un enthousiasme surprenant .
Nous suivons la danseuse dans une salle à l’écart. Sur une scène miniature, une jeune blonde s'exhibe face à un homme d'affaires bien mûr. Notre belle métisse monte sur la scène qui jouxte notre banquette. J'avoue ne plus avoir d'yeux que pour cette jeune femme à la peau tabac, qui se dénude avec sensualité, exhibant ses charmes les plus intimes dans des postures acrobatiques à quelques pouces de nos visages vermillons d’émotion. Elle conclue son chaud show par sa spécialité : tout en nous regardant entre ses jambes écartées, elle parvient à faire cliqueter comme des clochettes les piercing qui ornent ses lèvres intimes. L’originalité vient de basculer dans le grotesque.
Nous quittons la boîte quelques minutes plus tard. Ninon me prend par le bras, ravie du spectacle, mais toutefois déçue de ne pas avoir revu la belle rousse. Son contact me fait plus bander que toutes les créatures que nous venons de croiser.
06:50 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Un vague amant, Erotisme, ninon, Adultère, strip tease, récit érotique, Expériences
02 avril 2008
Un vague amant (3)
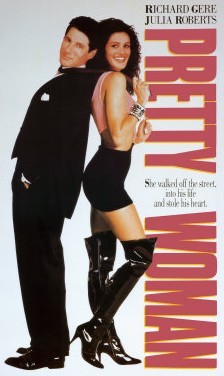 Knightsbridge, 17h. Après avoir fait quelques boutiques à la recherche de je ne sais quel accessoire de mode, Ninon me dit avoir envie de jouer à la pretty woman. Elle joint le geste à la parole en s’engouffrant aussitôt dans une boutique où je la suis comme un mari improbable. Sur les cintres, des robes de soirée clinquantes en côtoient d’autres d’un mauvais goût extravagant. Elle finit par en choisir quelques-unes. J’espère que c’est pour le seul plaisir de m’entraîner vers les cabines d’essayage. À peine a-t-elle fermé le rideau de la cabine que je m’effondre dans un fauteuil club, sans doute installé là pour éviter que les hommes ne se blessent en tombant à la renverse devant les étiquettes. Dans cette boutique, tout est bien au-delà de mes moyens.
Knightsbridge, 17h. Après avoir fait quelques boutiques à la recherche de je ne sais quel accessoire de mode, Ninon me dit avoir envie de jouer à la pretty woman. Elle joint le geste à la parole en s’engouffrant aussitôt dans une boutique où je la suis comme un mari improbable. Sur les cintres, des robes de soirée clinquantes en côtoient d’autres d’un mauvais goût extravagant. Elle finit par en choisir quelques-unes. J’espère que c’est pour le seul plaisir de m’entraîner vers les cabines d’essayage. À peine a-t-elle fermé le rideau de la cabine que je m’effondre dans un fauteuil club, sans doute installé là pour éviter que les hommes ne se blessent en tombant à la renverse devant les étiquettes. Dans cette boutique, tout est bien au-delà de mes moyens.
Ninon m’interpelle. Je m’approche du rideau que j’écarte d’une main. Elle tient devant elle une robe scintillante encore sur son cintre, que je regarde à peine. Derrière Ninon, dans le reflet du miroir, la peau blanche de son dos nu est barrée par les bretelles de son soutien gorge, couleur crème. Plus bas, sa petite culotte assortie souligne la rondeur de ses fesses et la pâleur de ses cuisses jusqu’aux mi-bas de nylon. « Je commence par celle-ci ? » me demande-t-elle avec une lueur coquine dans le regard, tout en écartant la robe avec une fausse ingénuité. Aux commissures de ses cuisses, de part et d’autre du triangle de satin, dépassent deux belles touffes de poils.
07:45 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : Un vague amant, Erotisme, ninon, Adultère, cabine d'essayage, récit érotique, Expériences
29 mars 2008
Un vague amant (2)
Oxford Street, 15h. Le froid glacial nous jette dans un bus bien anglais, rouge et à deux étages. Animée par la curiosité, Ninon monte au premier étage où nous avons l'heureuse surprise de ne trouver qu'un passager distrait. Nous nous asseyons au premier rang avec vue panoramique sur cette avenue commerçante. Nous nous en fichons éperdument.
Je la prends enfin par les épaules pour l’embrasser langoureusement. Elle n'attendait que ça. Je sens sa langue glisser entre mes lèvres. J'y échappe pour perdre ma bouche dans son cou, lui mordiller l'oreille au passage, caresser son visage d’une main. L’autre remonte entre ses cuisses, jusqu'à son entrejambe. Je la masse au travers de son jean. Mes doigts s'attaquent au tissu épais, y ouvrent une brèche, et s'aventurent sur son ventre. Là, ils contournent l'ultime rempart de dentelle, et explorent sa petite forêt. Elle est bien plus touffue que je ne l’imaginais. Ninon soupire d'aise, elle écarte les cuisses, elle tente de s'ouvrir à ma caresse. Mais je n'ai pas les clefs de son plaisir. Le trousseau en main, j’ai beau fouiller, je ne parviens qu'à l'exciter. Notre pittoresque situation, à la vue de tous et de personne à la fois n’est sans doute pas étrangère à ce demi échec.
Un autre bus nous croise en sens inverse. À l’étage, une vielle dame perdue dans ses pensées. Elle passe à quelques pieds de nous, sans nous voir. « Hello ! » dis-je en levant la main. Ninon sursaute, s'inquiète, rit à ma plaisanterie et s'abandonne à nouveau. Plus pour longtemps : le bus a atteint son terminus bien avant que Ninon atteigne celui de son plaisir. Nous sortons du bus encore plus rapidement que nous y sommes montés. Ninon finit de se rhabiller dans la rue.
07:25 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Un vague amant, Erotisme, ninon, Adultère, bus, récit érotique, Expériences
27 mars 2008
Un vague amant (1)
 Gare de Waterloo, un Jeudi de l’hiver 2001 à onze heure du matin. Je regarde défiler des visages inconnus. Surtout ceux des femmes. La plupart sont fermés mais certains s’éclairent en voyant un parent, une amie, un fiancé venu les attendre à l’arrivée de l’Eurostar.
Gare de Waterloo, un Jeudi de l’hiver 2001 à onze heure du matin. Je regarde défiler des visages inconnus. Surtout ceux des femmes. La plupart sont fermés mais certains s’éclairent en voyant un parent, une amie, un fiancé venu les attendre à l’arrivée de l’Eurostar.
Officiellement, je n’ai rien à faire là. Pour mon employeur je suis rentré à Paris prendre une journée de congés, et pour ma femme je suis encore en mission à Londres. En réalité, je suis dans le no man’s land du mensonge, réfugié dans l’interstice entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. J’y éprouve la sensation grisante d’échapper à toute contrainte pendant quelques heures, à toute convention, à toute promesse. Un plaisir qui vaut bien le prix de la duplicité et de la tromperie. En voyant soudainement apparaître le visage de Ninon coiffé d’un drôle de chapeau rond, je me demande si je ne me suis pas trompé aussi.
J’ai rencontré Ninon sur internet quelques semaines auparavant. J’ai eu l’occasion de l’inviter à déjeuner deux ou trois fois, l’occasion de retrouver le plaisir du flirt avec une jeune femme après tant d’années de conjugalité. Elle a 23 ans. Moi, j’ai une quinzaine d’années de plus, et probablement de trop. Je l’ai invitée à passer deux jours avec moi à Londres, essentiellement parce que j’ai vu en elle une complice potentielle pour mon premier adultère. Je l’embrasse sur la joue comme une bonne amie.
07:00 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : Un vague amant, Littérature, ninon, Adultère, londres, Expériences
21 février 2008
Copenhague
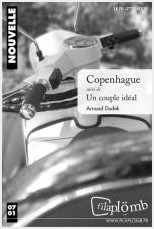 Non, je ne vais pas vous ennuyer avec une note touristique sur cette ville ennuyeuse qui ne peut faire rêver que ceux qui n’y sont jamais allés ( si vous tenez vraiment à partir dans le coin, traversez le pont et visitez Malmö qui est tout aussi bien et beaucoup moins cher ), mais avec une note sur une nouvelle intitulée Copenhague publiée aux éditions filaplomb.
Non, je ne vais pas vous ennuyer avec une note touristique sur cette ville ennuyeuse qui ne peut faire rêver que ceux qui n’y sont jamais allés ( si vous tenez vraiment à partir dans le coin, traversez le pont et visitez Malmö qui est tout aussi bien et beaucoup moins cher ), mais avec une note sur une nouvelle intitulée Copenhague publiée aux éditions filaplomb.
Après avoir sciemment massacré le petit suspens que j’escomptais vous servir aujourd’hui, je n’insisterai pas trop sur mon étonnement lorsque j’ai reçu dans ma boite au lettre en fer et qui couine, une enveloppe manuscrite à la vraie main et à mon nom bien réel. Il faut dire que pour le monde commun et trivial, je ne suis qu’un patronyme imprimé à la chaîne pour le compte d’une banque, d’une assurance ou d’une caisse de retraite, et les seules enveloppes manuscrites qu’il m’arrive d’ouvrir contiennent des faire part de mariage ( de moins en moins) de naissance ( le pic est passé aussi ) et plus rarement de décès ( mais c’est en croissance ), c’est-à-dire le lot commun de la boite aux lettres du cadre moyen déjà plus tout jeune…
Bref, il y a quelques semaines, je reçois une enveloppe manuscrite que ma femme n’a pas osée ouvrir. « Tu es sur que ce n’est pas une lettre piégée » qu’elle me dit sans rire. « Mais qui pourrait bien m’en vouloir ? » que je réponds en décachetant l’enveloppe sans penser aux quelques cocus qui pourraient me trucider s’ils retrouvaient ma trace. Et là, qu’est-ce que je trouve ? Vous le savez déjà : Copenhague suivi de Un couple idéal d’Arnaud Dudek, un recueil de deux nouvelles de 10 pages chacune au format 10 x 15. Le papier - recyclé avec des encres végétales sans solvant - est de bonne qualité ainsi que l’impression et la mise en page, même si on aurait apprécié une couverture un petit peu plus épaisse. Mais pour 4,20 € frais de port compris - le prix d’un café sur une terrasse parisienne - je n’ai pas boudé le quart d’heure de plaisir que la lecture de ces nouvelles m’a procuré. Je connaissais déjà Dudek pour son excellent blog littéraire, mais le lire allongé dans son lit, c’est tout de même mieux qu’assis devant un écran.
Cela suffit pour la forme, venons en au fond : deux nouvelles sur les solitudes qui s’ajoutent pour composer un couple. J’ai toujours pensé qu’un texte devait se défendre tout seul, alors je vous en livre un petit extrait :
Il aimerait découvrir l’Europe du Nord, il ne connaît pas. Copenhague, pourquoi pas ? Ce sera difficile d’imposer cette idée. Sylvia voudra de la chaleur. Siroter des cocktails à base de jus d’ananas en regardant des bellâtres transpirer autour d’un filet de volley-ball. Allongée sur une serviette de plage à fleurs, vêtue d’un maillot de bain une pièce assez terne, à compléter les cases d’un Sudoku.
Au poignet, un bout de plastique jaune digne des meilleurs Clubs Mickey indiquera son rattachement à un club de vacances situé à Hammamet.
Son visage outrageusement bronzé fera pâlir les collègues de jalousie lors du premier café de septembre, celui où l’on montre des vestiges de coups de soleil soignés à la Biafine comme autant de blessures de guerre.
Copenhague, ça risque de la mettre en rogne.
J’espère vous avoir donné envie de découvrir Arnaud Dudek auquel je souhaite le succès qu’il mérite. Quant à son éditeur, je lui souhaite d’attraper une bonne crampe à écrire les noms des lecteurs auxquels il envoie un peu de bonheur.
07:00 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : Livres, Arnaud Dudek, Copenhague, Filaplomb, Littérature
24 janvier 2008
La nuit de Valognes
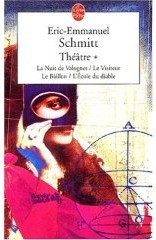 Dans un château perdu de Normandie, plusieurs femmes attendent un homme. Elles l'ont aimé ; elles le haïssent. Il les a trahies, elles vont le punir. Cet homme, c'est Don Juan... Mais grand sera leur étonnement lorsque le séducteur arrivera au rendez-vous. Pourront-elles lui pardonner de ne plus être celui qu'elles ont tant aimé ?
Dans un château perdu de Normandie, plusieurs femmes attendent un homme. Elles l'ont aimé ; elles le haïssent. Il les a trahies, elles vont le punir. Cet homme, c'est Don Juan... Mais grand sera leur étonnement lorsque le séducteur arrivera au rendez-vous. Pourront-elles lui pardonner de ne plus être celui qu'elles ont tant aimé ?
Après Le bal des mots dits et Le libertin réconcilié, voici mon analyse de « La nuit de Valognes » d’Eric-Emmanuel Schmitt, et c’est chez Ysé…
PS: Je viens de découvrir une note brillante sur le Don Juan de Molière, qui éclaire le mythe sous un jour bien moins agnostique que ne le font les analyses habituelles... décapant !
09:25 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : La nuit de Valognes, Livres, Eric Emmanuel Schmitt, Don Juan, Théâtre, Littérature
13 décembre 2007
Le bal des mots dits... (par Ysé)
Tout commence par un coup de foudre. Un coup de foudre, ça s'abat sur des coeurs prompts à aimer aussi violemment que ça libère les relents de vengeance et de haine. Mais il n'y a pas que le ciel qui déchaîne son courroux...
Cinq femmes se retrouvent une nuit dans le manoir de la duchesse de Vaubricourt. Un lourd secret, une question de vie ou de mort, voilà ce qui pouvait les réunir.
Qu'ont en commun une châtelaine rancunière, une comtesse frivole, une religieuse gentiment sotte, une intello revêche se piquant d'écrire des bluettes et une jeune mariée ? Rien, si ce n'est que jadis, elles ont été séduites et abandonnées par Don Juan. Mais ces victimes n'ont rien à voir avec les mille e tre espagnoles que le "vil séducteur" connut au sens biblique du terme. Ces femmes-là ont résisté, et ont ainsi offert à Don Juan ses plus éclatantes conquêtes, tout au moins à en croire le carnet tenu par Sganarelle oscillant entre le livre de comptes et le récit des amours de son maître.
Bien vite, les victimes, vêtues de blanc et non de candeur, vont troquer leur tunique de martyr contre la robe de juge, et elles sortiront si besoin est, la hâche du bourreau. Ce soir, elles vont sceller le destin du séducteur qui devra épouser et être fidèle à sa dernière conquête en date, Angélique, qui n'est autre que la nièce de la comtesse. S'il refuse, c'est une affaire de duel qui mènera le plus célèbre des sentimenteurs en prison. Lui qui croyait se rendre à un bal, ne sera pas le seul à mener la danse.
 On rit, jaune parfois, on se laisse toucher par les escarmouches et l'on se laisse prendre par ce qui est représenté sur scène. Le spectateur ne peut demeurer passif tant la première pièce d'Eric-Emmanuel Schmitt regorge de joutes verbales et autres stichomythies enlevées. Bref, cette pièce nous interpelle, bouscule valeurs moralistes et idées préconçues tandis qu'elle pose les questions les plus audacieuses avec un cynisme résolument provocant. Si le public ne fait pas de catharsis, du moins voit-il les passions, qu'il s'efforce de museler, se déchaîner : amour égoïste propre aux enfants, vengeance, trahison, jalousie, tout y est ! Chacun détient une part de vérité, nul n'a entièrement tort. Qui pourrait se vanter de ne s'être jamais trompé ? Don Juan lui-même, n'a pas su reconnaître l'amour véritable qui ne saute pas toujours aux yeux quand il prend une forme inattendue.
On rit, jaune parfois, on se laisse toucher par les escarmouches et l'on se laisse prendre par ce qui est représenté sur scène. Le spectateur ne peut demeurer passif tant la première pièce d'Eric-Emmanuel Schmitt regorge de joutes verbales et autres stichomythies enlevées. Bref, cette pièce nous interpelle, bouscule valeurs moralistes et idées préconçues tandis qu'elle pose les questions les plus audacieuses avec un cynisme résolument provocant. Si le public ne fait pas de catharsis, du moins voit-il les passions, qu'il s'efforce de museler, se déchaîner : amour égoïste propre aux enfants, vengeance, trahison, jalousie, tout y est ! Chacun détient une part de vérité, nul n'a entièrement tort. Qui pourrait se vanter de ne s'être jamais trompé ? Don Juan lui-même, n'a pas su reconnaître l'amour véritable qui ne saute pas toujours aux yeux quand il prend une forme inattendue.
La mise en scène de Régis Santon est magistrale de simplicité et d'efficacité. Le procès de Don Juan se tient à huit clos entre les murs étouffants du château de la duchesse de Vaubricourt. A n'en pas douter, l'auteur de la pièce n'aurait pas renié la scénographie, ni même la musique accompagnant la perte de Don Juan ; car qui mieux que Mozart et son Requiem aurait pu illustrer la force de ce destin ?
Quant aux acteurs, ils ont campé avec conviction des personnages pouvant paraître, à première vue, caricaturaux. Mais derrière les masques, restent égratignures et plaies loin d'être refermées.
Le Don Juan d'Eric-Emmanuel Schmitt, tout en étant caustique, toujours aussi libre envers Dieu et les choses de l'amour, accepte son destin, et en cela, il est radicalement différent de celui de Molière qui toisait la statue du Commandeur, avec une effronterie presque puérile. Ici, Don Juan a gagné en sagesse et il lève enfin le voile sur le mystère de sa vie : qu'est-ce qui faisait courir Don Juan ? Fuyait-il ou cherchait-il quelque chose ? Vous aurez la réponse en lisant la pièce ou en allant voir la représentation au théâtre Silvia Monfort, ce que je vous recommande.
Tout a une fin et le malheur des uns fait le bonheur des autres, et ce n'est pas Sganarelle qui démentirait, lui qui perçoit enfin ses gages !
_________________________________________
note : Une stichomythie est une partie de dialogue d'une pièce de théâtre versifiée où se succèdent de courtes répliques, de longueur à peu près égale, n'excédant pas un vers, produisant un effet de rapidité, qui contribue au rythme du dialogue.
07:10 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : Don Juan, Théâtre, La nuit de Valognes, Livres, Eric Emmanuel Schmitt, Ysé, Littérature
30 novembre 2007
La marche du monde
FEMME 1 : Je n'ai pas mis les bonnes chaussures ce matin. Avec ces grèves, ce que j’ai mal aux pieds !
FEMME 2 : Moi, j’ai fait l’impasse sur l’élégance au boulot. Avec mes tennis, je peux même courir. Regarde !
FEMME 1 : Attention !
La seconde femme trébuche sur Diogène assis par terre, avant que toutes deux ne prennent la fuite devant ses furieuses invectives.
DIOGENE : Pouvez pas regarder où vous mettez les pieds, non ? C’est incroyable ça ! Qu’est-ce que les gens ont à toujours cavaler ! Ils ne savent même pas où ils vont, mais ils y courent. Et ceux qui ont peur de se perdre, ils courent sur place sur des tapis roulant dans leur salle de gym ! Avant, c’était autre chose. Ce qui comptait, c’était l’être, qu’il soit individuel ou collectif. Soit on était de naissance, comme Louis XIV le disait : « L’état, c’est moi ! ». Soit on naissait pas grand-chose et il suffisait d’y penser comme Descartes : « Je pense, donc je suis. ». C’est le capitalisme qui a tout bouleversé avec l’avoir. Pour être il n'est capital que d’avoir du capital, au point de ne même plus avoir besoin d’exister pour être une « personne morale ». Mais maintenant, il ne suffit plus d’avoir : on est passé à l’âge du faire. Faire croire qu’on fait ce qu’on a dit, et dire ce qu’on va faire croire. Faut s’agiter, se montrer partout, s’oublier dans l’action quand on ne se supporte plus ; paraître ce qu’on ne parvient pas à être. Tout ça pour réaliser, en fin de compte, qu’on s’est fait avoir. Le bougisme, voilà le mal du siècle ! Moi je vous le dis : Il est urgent de ne rien faire ! Il faut réapprendre les vertus de la méditation pour contempler la marche du monde. Qui peut observer la danse des rayons du soleil levant dans la brume, la lumière dans le prisme du givre qui fond lentement, et qui s’écoule en rosée délicate ? Qui sait s’oublier dans le souffle de l’être suprême, virevolter en esprit et en vérité, comme une poussière parmi les poussières…
Une autre femme approche à pas vifs.
DIOGENE : À votre bon cœur m’dame ! Ayez pitié d’un cul-de-jatte philosophe !
07:00 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : coumarine, Littérature
02 novembre 2007
De la morale et de la liberté (2)
Attention. Cette note cite une scène particulièrement violente qui risque de heurter votre sensibilité.
 « L’ouvrage n’étant pas massicoté, il est préférable, pour l’ouvrir, d’user d’un instrument plutôt que de son doigt. » Vendu sous blister avec cet avertissement collé sur sa couverture, Un roman sentimental est une magnifique opération commerciale. Pensez donc : Alain Robbe-Grillet, académicien de 85 ans, laisse à la postérité un sulfureux roman érotique ! Erotique, vraiment ? Si aucun avatar mercantile n’est épargné au lecteur pour aiguillonner son excitation, qu’en reste-t-il après avoir eu le supposé plaisir de démassicoter ce livre ? Voici une des premières scènes qui compose ce fameux roman et qui vous permettra d’apprécier son style si délicat…
« L’ouvrage n’étant pas massicoté, il est préférable, pour l’ouvrir, d’user d’un instrument plutôt que de son doigt. » Vendu sous blister avec cet avertissement collé sur sa couverture, Un roman sentimental est une magnifique opération commerciale. Pensez donc : Alain Robbe-Grillet, académicien de 85 ans, laisse à la postérité un sulfureux roman érotique ! Erotique, vraiment ? Si aucun avatar mercantile n’est épargné au lecteur pour aiguillonner son excitation, qu’en reste-t-il après avoir eu le supposé plaisir de démassicoter ce livre ? Voici une des premières scènes qui compose ce fameux roman et qui vous permettra d’apprécier son style si délicat…
5
Vers le mur du fond, celui sur lequel mes yeux alanguis errent avec le plus de facilité, je distingue, en premier plan d’un dessin dont l’évidence se confirme rapidement, perspective forestière aux troncs verticaux et rectilignes, une sorte de bassin d’eau si claire qu’elle en devient presque immatérielle, élargissement oblong d’une source limpide, aussi profond qu’une baignoire ou même davantage, entre des roches grises aux formes arrondies, douces au toucher, accueillantes. Une jeune fille est assise là, sur la pierre polie par l’usure qui représente pour elle une banquette idéale au ras de l’eau, où ses longues jambes remuent avec abandon dans les remous aux reflets bleus de l’aimable nymphée, naturelle autant que pittoresque, dont la température doit être identique à celle de l’air ambiant, ainsi que des charmes féminins eux-mêmes qui ondulent, déjà liquides, au dessus du miroir mouvant aux frémissements imprévus.
.
C’est après que ça se gâte. Invité chez Taddeï le 24 Octobre dernier pour la présentation de son roman, Alain Robbe-Grillet nous apprend qu’il y raconte les pérégrinations sexuelles de petites filles supplicées à mort dans un français irréprochable, avec un luxe de détails Flaubertien mais aussi la distanciation nécessaire et assez d’invraisemblances pour créer une atmosphère onirique, fantasmagorique, théâtrale qui situerait son roman dans le cadre de la catharsis. Voici quelques extraits de cette interview :
FT : Pensez-vous qu’on était plus tolérant à l’époque [ en 1974 ]
ARG : Oui car de plus en plus on confond le fantasme et la réalisation du fantasme. Or c’est exactement le contraire. Quelqu’un qui écrit, en général, est quelqu’un qui se soigne lui-même, qui soigne sa perversion en l’écrivant.
FT : C’est l’impression que vous avez, vous ?
ARG : Je ne sais pas mais… j’ai Aristote avec moi pour défendre cette thèse, dite de la catharsis. Et néanmoins, il y a quand même à l’heure actuelle un envahissement par le bien pensé. C'est-à-dire que ce soit politiquement correct, sexuellement correct, littérairement correct, racialement correct, etc… Il semble maintenant que quand on écrit quelque chose d’incorrect, c’est comme si on le commettait. C’est une méconnaissance totale de ce que c’est que l’écriture.
[…]
FT: Là vous faites monter, monter les fantasmes, et à partir du moment où il y a des enfants ça devient très différent. Vous vous attendez à quoi ?
ARG : Comme on le disait tout à l’heure, ce sont des écrits intimes, que j’écrivais pour moi, et celui là qui est rédigé avec un très grand soin, qui est quand même fait selon le même souci de représenter ce que j’ai dans la tête, un souci autobiographique pour ainsi dire, et il est évident que depuis que j’ai douze ans, j’ai toujours aimé les petites filles, c'est-à-dire que je pense qu’il y a des quantités de gens qui sont dans la même situation. L’amour pour les jeunes, les petits garçons pour les homosexuels et les petites filles pour les hétéros, c’est quelque chose d’extrêmement répandu, mais qui se domine très facilement, qui ne se réalise pas quoi ! Mais le penser ne fait de mal à personne.
[Reportage présentant les associations de défense de l’enfance qui s’étaient insurgées lors de la parution du livre rose bonbon, parce qu’il véhiculait l’idée que les enfants victimes des crimes pédophiles sont consentants.]
ARG : Ces gens qui se plaignent sont des pervers, visiblement !
FT : Pourquoi ?
ARG : Ils ont lu ça, et ils ont tout de suite gommé le fait que c’est un écrit littéraire, et ils ont réalisé le fantasme eux même dans leur tête ! À ce moment là ils se sont gendarmés contre qui ? Contre eux même ! Ces gens devraient être tous en prison ! Parce que c’est eux qui ont effectué la réalisation dans leurs cerveaux malades !
[…]
ARG : Puisque je parlais d’Aristote tout à l’heure, il a bien précisé dans la poétique que l’effet de catharsis ne jouait que selon certaines règles de distanciation par rapport au sujet. C'est-à-dire que si le fantasme est raconté de façon trop… Il ne parlait pas de fantasmes sexuels, Aristote, mais si l’idée est racontée avec trop de passion sensuelle alors, à ce moment là, on risque de provoquer ce que qu’Aristote appelle la mimésis, c'est-à-dire que le lecteur a tendance à vouloir réaliser lui-même ce qu’il est en train de lire. Alors que au contraire, avec cet effet Brechtien de distanciation, c’est l’effet inverse : la catharsis, c'est-à-dire que le lecteur va être purgé de ses passions, grâce à mon livre !
Voici les passions en question…
229
Quant aux trois plus jeunes des petites filles, Crevette, Nuisette et Lorette, qui ont sept, huit et neuf ans, elles se sont beaucoup amusées pendant leur service. Ramenées à leur dortoir J1, elles en parlent ensemble avec émerveillement. On leur a permis de goûter à toutes les liqueurs qu’elles devaient servir à genoux. Elles ont sucé des messieurs vigoureux et de jeunes dames parfumées. On les a caressées, embrassées, léchées. On a bourré des crèmes excitantes dans leurs orifices trop enfantins, avant de les branler de façon très douce. Elles ont admiré une adolescente qui flambait comme une torche. Elles ont vu couler le sperme et le sang, mais aussi les pleurs des collégiennes que l’on torturait. Vers la fin de la nuit, elles sont descendues dans les caves pour assister au supplice d’une servante de treize ans (vendue par sa famille) qui s’était enivrée. Après l’avoir violée de toutes les façons, des messieurs ont procédé à son écartèlement sur une machine spéciale, pendant qu’ils lui enfonçaient des aiguilles à travers tout le corps, dont les quatre membres se sont désarticulés peu à peu. Pour finir, on lui a arraché complètement l’une des cuisses, en tirant la jambe par le pied, et on l’a laissée se tordre dans un flot de sang pour mourir comme ça sans secours. Oui, c’était vraiment formidable.
J’ai choisi cette scène parce qu’elle est assez représentative de l’ensemble de « l’ouvrage » et assez courte pour être citée. Je vous laisse imaginer les 200 scènes intermédiaires où Robbe-Grillet raconte avec bien plus de détails les démembrements dont il semble si friand. Vous trouvez ça érotique, vous ? Si la catharsis a pour objet de purger le lecteur de pulsions communes, voire même fondamentales dans la construction du psychisme de chacun mais néanmoins réprimées par la loi ou la morale, comme l’interdit de l’inceste mis en scène - et puni – dans Oedipe Roi de Sophocle , qu’en est-il des pulsions criminelles d’Alain Robbe-Grillet ? La majorité de l’humanité partage-t-elle, à l’instar de cet auteur, le fantasme de découper un nouveau né au hachoir sous les yeux de sa mère elle-même torturée à mort ? Qui pourrait donc avoir besoin de lire un tel livre – si tant est que la supposée catharsis soit plus efficace que celle mise en scène dans L’orange mécanique ? De surcroît, Sophocle ne décrit pas les égarements d’Oedipe dans ses détails charnels avec la complaisance de Robbe-Grillet à l’égard de ses bourreaux d’enfants. Chez Sophocle, la mise à distance n’est pas qu’une vague atmosphère onirique : c’est une véritable tragédie qui donne du sens à la pulsion libidinale, qui la « corticalise » en l’inscrivant dans un mythe fondateur.
En vérité, le supposé effet cathartique de Un roman sentimental n’est qu’un misérable cache misère philosophique pour permettre la publication d’abominations qui n’auraient jamais dû franchir les portes d'un cabinet psychiatrique. Il ne s’agit pas de l’éventuelle purge du lecteur mais de celle bien réelle de l’auteur. Que les boyaux de son cortex incontinent défèquent des fantasmes abjects sur un bout de papier, soit. Qu’il les dore au subjonctif, pourquoi pas : c’est bien la moindre des choses de la part d’un académicien. Mais qu’il nous les donne à lire donne envie de vomir. Robbe-Grillet est comme un vieillard sénile qui exhibe son pot de chambre après une nuit de fièvre diarrhéique.
Voilà sa place :

Mais ne tirons pas la chasse trop vite !
Primo, il ne faudrait pas jeter l’anathème contre toute sorte de libertinage comme le fait Thierry Giaccardi chez Stalker, et je ne m’associerai certainement pas à ceux qui militent pour le retour du puritanisme. Je regrette d’ailleurs que l’adjectif « libertin » soit associé aux noms de Sade et de Robbe-Grillet, et je ne suis pas le premier à le faire. En 1798, Restif de la Bretonne, libertin s’il en est, publia Anti-Justine avec pour préface : « Personne n'a été plus indigné que moi des sales ouvrages de l'infâme de Sade [….] Ce scélérat ne présente les délices de l'amour qu'accompagnées de tourments, de la mort même pour les femmes. Mon but est de faire un livre plus savoureux que les siens et que les épouses pourront faire lire à leurs maris, pour en être mieux servies ; un livre où les sens parleront au cœur ; où le libertinage n’ait rien de cruel pour le sexe des grâces, et lui rende plutôt la vie, que de lui causer la mort ; où l’amour ramené à la nature, exempt de scrupules et de préjugés, ne présente que des images riantes et voluptueuses. On adorera les femmes en le lisant ; on les chérira en les enconnant : mais l’on en abhorrera davantage le vivodisséqueur […] »
Secundo, Un roman sentimental a tout de même une vertu, celle de remettre la question de la morale sexuelle au goût du jour. Honnêtement, Robbe-Grillet n’a rien inventé comme le souligne Pierre Assouline : il n’a fait qu’écrire une nouvelle version de Justine, et il va moins loin que Pasolini et son insoutenable Salo , ou les 120 jours de Sodome qui avait osé mettre en images de semblables abominations – avec au moins l’intention (ou le faux prétexte ?) de les dénoncer en les attribuant au fascisme. C’est sans doute au niveau de l’image que devrait se situer aujourd’hui le débat.
Dans un monde où on dispose des moyens techniques pour créer des images de toutes sortes, où la réalité virtuelle permet même d’envisager une seconde vie, rien n’empêche de mettre à la disposition du public des logiciels permettant de réaliser des images pédocriminelles plus vraies que nature. Alors que le fait de détenir des images « pédophiles » est sévèrement puni par la loi, on pourrait gagner « honnêtement » de l’argent en vendant des logiciels permettant de produire des images pédophiles virtuelles réalistes ? La frontière entre la légalité et le crime ne se jouerait alors qu’à quelques pixels près, ou bien il serait interdit de représenter graphiquement des scènes décrites avec tous les détails nauséeux (in)imaginables ? On retrouve curieusement le paradoxe de Robbe-Grillet qui veut enfermer ceux qui imaginent la mise en scène de ce qu’il écrit, et on peut légitimement se demander si l’arsenal législatif est vraiment adapté à ce type de question.
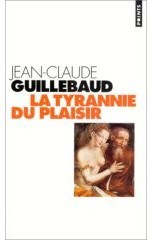 La question de la morale sexuelle, toujours d’actualité, est épineuse mais remarquablement traitée par Jean-Claude Guillebaud dans un de ses essais, La tyrannie du plaisir : N’y aurait-il donc pas d’autres choix possibles qu’entre permissivité claironnante ou moralisme nostalgique ?
La question de la morale sexuelle, toujours d’actualité, est épineuse mais remarquablement traitée par Jean-Claude Guillebaud dans un de ses essais, La tyrannie du plaisir : N’y aurait-il donc pas d’autres choix possibles qu’entre permissivité claironnante ou moralisme nostalgique ?
Dans une tentative de remise à plat, Jean-claude Guillebaud prend d’abord un recul historique qui permet de tordre le cou à bien des idées préconçues dont la liberté sexuelle de l’antiquité, l’austérité du moyen âge ou celle du Christianisme, pour nous rappeler la répétition de l’histoire à laquelle nous croyons avoir échappé du haut de notre courte vue. Il convie au débat historiens, philosophes, sexologues et sociologues pour aborder le sujet sous tous ses aspects, dont l’individualisme à outrance qui appauvrit l’échange qui devrait résulter du rapport sexuel où chacun des acteurs instrumentalise l’autre afin de parvenir à l’autosatisfaction motivée par l’acte en tant que fonction, et non plus en tant que moyen de communication privilégié : Le plaisir devient pure affaire anatomique, marchande et sportive (en attendant d’être cybernétique !) Il est prestation, rassasiement ou performance".
Face à la complexité de ces questions, Jean-Claude Guillebaud examine la démission de la société qui relègue les questions de société aux experts médicaux impuissants et aux juristes partagés entre deux logiques contradictoires de l’individualisme contemporain, celle de la revendication infinie de droits et celle de la demande de protection…
Comment ne serait-on pas troublés, dès qu’on se ressouvient du passé, par cette singulière situation ?
Vers le milieu des années 60, nous avions congédié le prêtre, le moraliste, le politique en charge du bien commun. Nous nous sentions la capacité - historiquement sans précédent - d’accorder à l’individu une primauté définitive sur le groupe. Nous pensions être investis du pouvoir de récuser ces prudences immémoriales, concessions aux contraintes, ruses collectives infinies et transactions de toutes sortes par lesquelles les sociétés humaines conjuguaient tant bien que mal l’aspiration au plaisir et l’impératif communautaire.
Voilà trente-cinq ans, nous fûmes, en matière de sexualité, plus intrépidement constructivistes qu’aucune société ne l’avait jamais été avant nous. L’apothéose de l’individu, son émancipation parachevée figuraient les vraies conquêtes de la modernité occidentale. Nous étions désormais assez riches, assez savants, assez raisonnables pour rejeter les superstitions du passé. Et assez libres, enfin, pour en dénoncer les tyrannies intimes.
La raison ne disqualifiait-elle pas la religion ? La démocratie ne rendait-elle pas inopérante la perpétuation politique des contraintes ? La connaissance ne nous assurait-elle pas la maîtrise des anciennes fatalités de l’espèce ? La science ne nous livrait-elle pas les clés de la procréation elle-même ? La certitude du progrès ne nous dispensait-elle pas de cette fidélité peureuse aux traditions ? La foi en l’universel, enfin, ne nous autorisait-elle pas à toiser le « pathos spécifique » des cultures humaines comme s’il s’agissait d’aimables folklores, avec leurs tabous et leurs précautions holistes ? Ce droit au plaisir, nous nous l’accordions comme une extraordinaire récompense historique. Il l’était en effet. On aurait bien tort de sourire rétrospectivement de cet optimisme.
Si l’on est troublé, aujourd’hui, c’est en voyant ce projet grandiose se heurter finalement aux mêmes obstacles, aux mêmes contradictions, aux mêmes risques mortels, surtout, que toutes les utopies qui l’avaient précédé. Le " climat " du moment, ces périls qui affleurent et ces peurs qui rôdent nous renvoient, au détail près, à des situations déjà vécues dans l’Histoire.
Cette violence polymorphe qu’à tort ou à raison nous sentons autour de nous, ce vertige sécuritaire qui nous empoigne au point de nous pousser à la panique juridique, ce sont précisément - on l’a vu dans les chapitres qui précèdent - ce que s’entêtèrent à conjurer les sociétés du passé. Il faudra nous résoudre à admettre que ces cultures traditionnelles, dont nous voulions orgueilleusement nous démarquer, n’avaient pas si mal compris l’intrication indissociable entre la sexualité et la violence.
J.C. Guillebaud : La tyrannie du plaisir, p. 379-381
Aujourd’hui, l’appareil judiciaire et les dispositifs pénaux nous tiennent lieu de directeur de conscience. Je crois que Un roman sentimental n’est qu’une grotesque provocation à leur endroit : je soupçonne que Robbe-Grillet a pour dernière ambition de se faire censurer afin de siéger aux côtés d’un Sade au panthéon des célébrités sulfureuses, lui qui a toujours méprisé « l’immortalité » bien pensante de l’académie Française. Ce vieillard n’a plus grand-chose à perdre. Nous, nous risquons de perdre encore un peu de liberté d’expression à cause de nouvelles législations réactionnaires qui pourraient être appliquées à tort et à travers. Le mieux que nous puissions faire est bien de laisser Un roman sentimental partir au pilon et de s'en convaincre en lisant La tyrannie du plaisir.
10:25 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (24) | Tags : De la morale et de la liberté, Alain Robbe-Grillet, Un roman sentimental, Jean-claude Guillebaud, La tyrannie du plaisir, Agrafe, Livres
01 novembre 2007
De la morale et de la liberté (1)
MME THERBOUCHE. Ne vous compromettez pas. N’écrivez pas sur la morale. Tout le monde attend de vous que vous affirmiez le règne de la liberté, que vous nous libériez de la tutelle des prêtres, des censeurs, des puissants, on attend de vous des lumières, pas des dogmes. Surtout, n’écrivez pas sur la morale.
DIDEROT. Mais si, il le faut.
MME THERBOUCHE. Non, s’il vous plaît. Au nom de la liberté.
DIDEROT. C’est que je ne sais pas si j’y crois, moi, à la liberté ! Je me demande si nous ne sommes pas simplement des automates réglés par la nature. Regardez tout à l’heure : je croyais venir ici me livrer à une séance de peinture, mais je suis un homme, vous êtes une femme, la nudité s’en est mêlée, et voilà que nos mécanismes ont eu un irrésistible besoin de se joindre.
MME THERBOUCHE. Ainsi, vous prétendez que tout serait mécanique entre nous ?
DIDEROT. En quelque sorte. Suis-je libre ? Mon orgueil répond oui mais ce que j’appelle volonté, n’est-ce pas simplement le dernier de mes désirs ? Et ce désir, d’où vient-il ? De ma machine, de la vôtre, de la situation créée par la présence trop rapprochée de nos deux machines. Je ne suis donc pas libre.
MME THERBOUCHE. C’est vrai.
DIDEROT. Donc je ne suis pas moral.
MME THERBOUCHE. C’est encore plus vrai.
DIDEROT. Car pour être moral, il faudrait être libre, oui, il faudrait pouvoir choisir, décider de faire ceci plutôt que cela… La responsabilité suppose que l’on aurait pu faire autrement. Va-t-on reprocher à une tuile de tomber ? Va-t-on estimer l’eau coupable du verglas ? Bref, je ne peux être que moi. Et, en étant moi et seulement moi, puis-je faire autrement que moi ?
MME THERBOUCHE. Que la plupart des hommes soient ainsi, je vous l’accorde. Vous êtes persuadés de vous gouverner par le cerveau alors que c’est votre queue qui vous mène. Mais nous, les femmes, nous sommes beaucoup plus complexes, raffinées.
DIDEROT. Je parle des hommes et des femmes.
MME THERBOUCHE. Ce n’est pas possible.
DIDEROT. Mais si.
MME THERBOUCHE. Vous ne connaissez rien aux femmes.
DIDEROT. Vous êtes des animaux comme les autres. Un peu plus charmants que les autres, je vous l’accorde, mais animaux quand même.
MME THERBOUCHE. Quelle sottise ! Savez-vous seulement ce qu’une femme éprouve pendant l’amour ?
DIDEROT. Oui. Euh… non. Mais qu’importe ?
MME THERBOUCHE. Savez-vous ce qu’une femme ressent lorsqu’elle s’approche d’un homme ? Ainsi, par exemple, moi, en ce moment, qu’est-ce que je peux sentir ? Oui, et si moi, en ce moment, je feignais…
DIDEROT. Pardon ?
MME THERBOUCHE. Si je n’avais pas de désir pour vous ? Si je mimais la tentation ? Si je tombais dans vos bras avec tout autre intention que celle que vous imaginez ?
DIDEROT. Et laquelle, s’il vous plaît ?
MME THERBOUCHE. Hypothèse d’école, nous discutons. Supposons que je n’aie pas de désir pour vous mais que j’essaie simplement d’obtenir quelque chose de vous.
DIDEROT. Et quoi donc ?
MME THERBOUCHE. Hypothèse, vous dis-je. Imaginez que je sois perverse. Il faut bien être libre pour se montrer pervers. Le vice ne serait-il pas la démonstration de notre liberté ?
DIDEROT. Non, car vous seriez une machine perverse, naturellement, physiologiquement perverse, mais une machine.
MME THERBOUCHE. Passionnant. Et tellement judicieux.
DIDEROT. Bref, votre objection ne change absolument rien à ma théorie. S’il n’y a point de liberté, il n’y a point d’action qui mérite la louange ou le blâme. Il n’y a ni vice ni vertu, rien dont il faille récompenser ou punir.
MME THERBOUCHE. Bravo ! Mais alors, comment édifier une morale ? Je me demande bien ce que vous allez pouvoir écrire.
_____________________________________
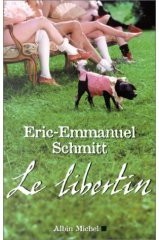 Cette note clôt ma série sur Diderot selon Eric Emmanuel Schmitt dans « Le libertin », et introduit la question de la morale sexuelle. C’est un sujet qui m’a longtemps travaillé, et qui est même au cœur de mon existence puisqu’il stigmatise mon pêché « mignon » : la luxure ! Je l’avais esquissé avec une note humoristique il y a près d’un an, mais il me va bien falloir l’aborder de front d’autant plus que l’actualité littéraire s’y prête merveilleusement bien !
Cette note clôt ma série sur Diderot selon Eric Emmanuel Schmitt dans « Le libertin », et introduit la question de la morale sexuelle. C’est un sujet qui m’a longtemps travaillé, et qui est même au cœur de mon existence puisqu’il stigmatise mon pêché « mignon » : la luxure ! Je l’avais esquissé avec une note humoristique il y a près d’un an, mais il me va bien falloir l’aborder de front d’autant plus que l’actualité littéraire s’y prête merveilleusement bien !
07:05 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Le libertin, Livres, Eric Emmanuel Schmitt, morale, liberté, Diderot, Littérature
27 octobre 2007
De la débauche et de la volupté
Moi : la Débauche / Elle : la Volupté
Devinez qui a gagné ? La volupté bien sûr !
11:30 Publié dans Réflexions | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : débauche, Livres, volupté, diderot, le libertin, Ysé, Littérature














